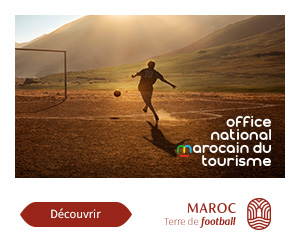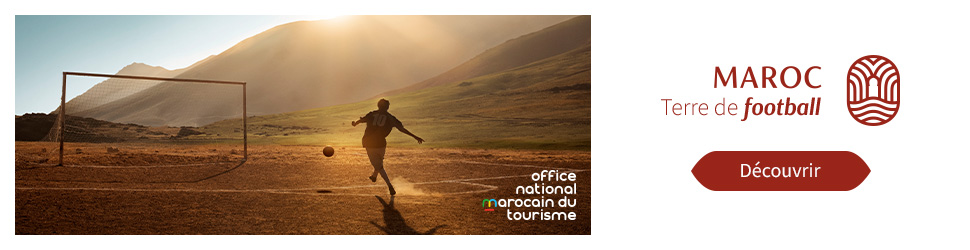« Une amende de 1.500 à 3.000 dirhams pour toute personne qui nourrit ou soigne un animal errant sans autorisation préalable ». Depuis l’adoption du projet de loi n°19.25 relatif à la protection des animaux errants et à la prévention des dangers qu’ils peuvent engendrer, cette disposition provoque un tollé. Le texte suscite non seulement l’indignation sur les réseaux sociaux, mais également des critiques virulentes dans les médias nationaux et internationaux.
De son côté, le gouvernement justifie cette loi par la prolifération anarchique d’animaux dans l’espace public, perçus comme une source potentielle de transmission de maladies infectieuses graves, et par les incidents qu’ils pourraient causer. Mais pour une large partie de l’opinion publique, il s’agit d’une décision « absurde », dans un pays où, culturellement, nourrir un animal est considéré comme une « sadaqa » (un acte de charité accompli pour Dieu).
Il est vrai que les lacunes juridiques, combinées aux gabegies administratives, ont longtemps empêché le Maroc de se conformer aux standards internationaux en matière de protection animale, exigeant une réglementation plus rigoureuse. Mais encore faut-il que la réforme soit pensée du haut vers le bas, en créant d’abord des infrastructures et des structures compétentes capables de prendre en charge les millions d’animaux errants, avant d’interdire aux citoyens de leur venir en aide.
Pourtant, les modèles inspirants ne manquent pas ! En Turquie, chaque grande ville dispose de refuges municipaux financés par les collectivités, où les animaux errants sont identifiés, soignés, stérilisés, puis replacés dans leur environnement ou proposés à l’adoption. Chez nos voisins ibériques, des lois régionales imposent aux municipalités de prendre en charge tout animal errant trouvé sur la voie publique, avec un délai légal pour le soigner et lui trouver une solution pérenne. Au Canada, le modèle repose sur un réseau coordonné de refuges publics et privés, avec des partenariats associatifs et des campagnes nationales de stérilisation financées par l’État. Des mesures qui témoignent du fait que la protection animale n’est pas qu’une affaire de sanctions, mais repose plutôt sur des moyens concrets, des compétences spécialisées et une véritable politique publique.
La protection animalière c’est aussi une question de culture. Tant que le bien-être animal ne sera pas perçu comme une valeur importante et prioritaire, les lois resteront en décalage avec la réalité. C’est ce principe que les députés devraient garder en tête lors de la prochaine rentrée parlementaire, lorsque ce texte hautement polémique passera au crible.
De son côté, le gouvernement justifie cette loi par la prolifération anarchique d’animaux dans l’espace public, perçus comme une source potentielle de transmission de maladies infectieuses graves, et par les incidents qu’ils pourraient causer. Mais pour une large partie de l’opinion publique, il s’agit d’une décision « absurde », dans un pays où, culturellement, nourrir un animal est considéré comme une « sadaqa » (un acte de charité accompli pour Dieu).
Il est vrai que les lacunes juridiques, combinées aux gabegies administratives, ont longtemps empêché le Maroc de se conformer aux standards internationaux en matière de protection animale, exigeant une réglementation plus rigoureuse. Mais encore faut-il que la réforme soit pensée du haut vers le bas, en créant d’abord des infrastructures et des structures compétentes capables de prendre en charge les millions d’animaux errants, avant d’interdire aux citoyens de leur venir en aide.
Pourtant, les modèles inspirants ne manquent pas ! En Turquie, chaque grande ville dispose de refuges municipaux financés par les collectivités, où les animaux errants sont identifiés, soignés, stérilisés, puis replacés dans leur environnement ou proposés à l’adoption. Chez nos voisins ibériques, des lois régionales imposent aux municipalités de prendre en charge tout animal errant trouvé sur la voie publique, avec un délai légal pour le soigner et lui trouver une solution pérenne. Au Canada, le modèle repose sur un réseau coordonné de refuges publics et privés, avec des partenariats associatifs et des campagnes nationales de stérilisation financées par l’État. Des mesures qui témoignent du fait que la protection animale n’est pas qu’une affaire de sanctions, mais repose plutôt sur des moyens concrets, des compétences spécialisées et une véritable politique publique.
La protection animalière c’est aussi une question de culture. Tant que le bien-être animal ne sera pas perçu comme une valeur importante et prioritaire, les lois resteront en décalage avec la réalité. C’est ce principe que les députés devraient garder en tête lors de la prochaine rentrée parlementaire, lorsque ce texte hautement polémique passera au crible.