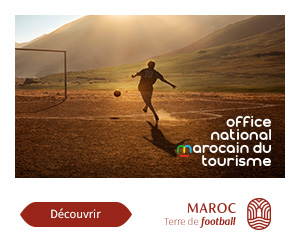Depuis quelques jours, en zappant entre les trois chaînes publiques - Al Oula, 2M et Medi1TV - ou en écoutant les radios nationales, un même sujet domine les débats, celui des manifestations et des revendications de la génération GenZ. Responsables gouvernementaux et figures politiques se succèdent sur les plateaux pour débattre avec ces jeunes descendus dans la rue exprimer leur mécontentement, ou pour répondre aux questions des journalistes. Ils tentent ainsi de justifier leurs bilans, de reconnaître les échecs constatés et d’exposer leurs perspectives pour un Maroc meilleur. Ces débats, certes salutaires, offrent une véritable bouffée d’oxygène à une génération qui se sentait étouffée dans son droit d’exprimer sa colère, de faire entendre sa voix et de prendre part à la vie publique. Une revendication légitime qui a réussi à entrer, presque par effraction, dans la sphère médiatique, et à se créer un espace dans un univers qui lui était jusque-là fermé.
Toutefois, la réaction des médias a été davantage réactive que proactive. Il a fallu attendre la vague de contestation portée par la GenZ212, et les débordements qui l’ont accompagnée, pour que nos médias s’emparent enfin des questions soulevées par cette jeunesse, au premier rang desquelles la santé et l’éducation.
Avant cela, et même durant les premiers jours qui ont suivi le déclenchement des manifestations, cette génération née entre 1997 et 2012 n’était même pas un sujet pour les Rédactions nationales, ou alors abordée sous des angles très restreints, comme celui des NEET (ni en éducation, ni en emploi, ni en formation). Cette absence de regard médiatique a nourri un sentiment de frustration chez ces jeunes, dans un paysage dominé par les grands projets d’infrastructures et les stratégies sectorielles dont ils ne perçoivent aucun impact concret sur leur vie quotidienne.
Cette parenthèse historique devrait être l’occasion pour les médias de faire leur autocritique. Car au-delà du malaise exprimé par la GenZ, combien d’autres angles morts persistent encore dans le traitement de l’actualité ? Cette remise en question est nécessaire si nous voulons vraiment une société apaisée, où chacune de ses composantes se sent écoutée et représentée.
Toutefois, la réaction des médias a été davantage réactive que proactive. Il a fallu attendre la vague de contestation portée par la GenZ212, et les débordements qui l’ont accompagnée, pour que nos médias s’emparent enfin des questions soulevées par cette jeunesse, au premier rang desquelles la santé et l’éducation.
Avant cela, et même durant les premiers jours qui ont suivi le déclenchement des manifestations, cette génération née entre 1997 et 2012 n’était même pas un sujet pour les Rédactions nationales, ou alors abordée sous des angles très restreints, comme celui des NEET (ni en éducation, ni en emploi, ni en formation). Cette absence de regard médiatique a nourri un sentiment de frustration chez ces jeunes, dans un paysage dominé par les grands projets d’infrastructures et les stratégies sectorielles dont ils ne perçoivent aucun impact concret sur leur vie quotidienne.
Cette parenthèse historique devrait être l’occasion pour les médias de faire leur autocritique. Car au-delà du malaise exprimé par la GenZ, combien d’autres angles morts persistent encore dans le traitement de l’actualité ? Cette remise en question est nécessaire si nous voulons vraiment une société apaisée, où chacune de ses composantes se sent écoutée et représentée.