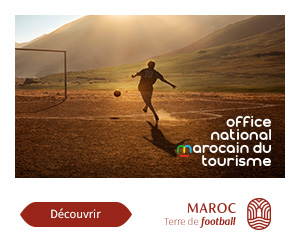En tant qu’acteur engagé depuis plus de 40 ans dans le domaine du numérique, aussi bien dans les milieux académiques que professionnels, au Maroc et à l’international, je tiens à saluer cette initiative structurante portée par Mme la Ministre, et à la féliciter pour la réussite des premières Assises nationales de l’IA, qui ont marqué un tournant historique pour notre pays. Ces assises ont permis de rassembler un large éventail d’experts, de décideurs, d’universitaires et de jeunes talents autour d’une ambition partagée : faire de l’intelligence artificielle un levier de souveraineté, d’inclusion et d’innovation.
Madame la Ministre a présenté les grands axes de la stratégie : modernisation administrative, économie budgétaire, inclusion numérique, et souveraineté. Si cette orientation traduit une prise de conscience politique réelle, elle reste encore ancrée dans une logique sectorielle. Or, comme je l’ai démontré dans mes travaux, une véritable transformation nationale par l’intelligence artificielle exige une vision systémique : l’IA ne transforme pas seulement les secteurs, elle transforme les interconnexions entre eux. Gouvernance, compétences, infrastructure et modèle économique doivent être repensés comme un tout.
L’IA ne transforme pas uniquement les secteurs, elle transforme les liens entre eux.
L’article évoque les coopérations internationales avec enthousiasme. Pourtant, il faut rester lucide : la majorité des solutions IA déployées au Maroc reposent encore sur des plateformes étrangères (GAFAM, BATX), souvent hébergées hors du territoire national. Cette dépendance technologique nuit à la souveraineté numérique. Il est temps de développer des modèles d’IA linguistiquement, culturellement et juridiquement ancrés dans le contexte marocain et africain, hébergés localement, et régulés selon des standards éthiques nationaux.
Le discours dominant mis en avant dans l’article repose sur les promesses techniques : automatisation, simplification, optimisation. Mais cette approche techno-solutionniste oublie les effets sociaux, politiques et culturels des systèmes IA. Surveillance, discrimination algorithmique, fracture numérique… Ce sont des enjeux majeurs. L’IA ne peut être un outil neutre. Elle doit être conçue comme un objet politique, nécessitant une éthique située et co-construite avec les chercheurs, les citoyens, et les territoires.
L’IA ne doit pas être un substitut à la politique publique, mais un levier de justice sociale et d’intelligence collective.
L’article mentionne la mobilisation des experts, chercheurs, startups, étudiants. Mais l’enjeu éducatif reste abordé de manière marginale. Or, une véritable stratégie nationale suppose une révolution éducative. Il faut penser une alphabétisation à l’IA dès le primaire, une formation éthique des enseignants, le développement de cursus hybrides, et la valorisation de la recherche en IA éthique. Former à l’IA ne signifie pas apprendre à l’utiliser, mais à la comprendre, l’interroger, et la piloter.
Le ton du reportage est volontaire et fédérateur. Il souligne l’élan patriotique et la mobilisation des acteurs. Mais la gouvernance reste descendante. Il faut aller plus loin en impliquant les territoires, les associations, les collectivités locales, les écoles, les familles. C’est ce que propose le modèle MrabaData, que j’ai développé pour une gouvernance distribuée de la donnée et de l’IA, plaçant les citoyens au cœur des processus décisionnels.
L’initiative portée par Mme El Fallah Seghrouchni constitue une avancée notable dans la structuration du débat national sur l’intelligence artificielle. Pour aller plus loin, il faudra, en plus de la logique événementielle, inscrire cette ambition dans une vision structurelle, systémique et souveraine de l’intelligence artificielle, fondée sur l’inclusion sociale, la maîtrise technologique et l’autonomie décisionnelle.
L’IA est aujourd’hui un révélateur. Elle révèle nos dépendances, mais aussi nos potentiels. Elle impose un choix : subir l’innovation, ou la gouverner.
Madame la Ministre a présenté les grands axes de la stratégie : modernisation administrative, économie budgétaire, inclusion numérique, et souveraineté. Si cette orientation traduit une prise de conscience politique réelle, elle reste encore ancrée dans une logique sectorielle. Or, comme je l’ai démontré dans mes travaux, une véritable transformation nationale par l’intelligence artificielle exige une vision systémique : l’IA ne transforme pas seulement les secteurs, elle transforme les interconnexions entre eux. Gouvernance, compétences, infrastructure et modèle économique doivent être repensés comme un tout.
L’IA ne transforme pas uniquement les secteurs, elle transforme les liens entre eux.
L’article évoque les coopérations internationales avec enthousiasme. Pourtant, il faut rester lucide : la majorité des solutions IA déployées au Maroc reposent encore sur des plateformes étrangères (GAFAM, BATX), souvent hébergées hors du territoire national. Cette dépendance technologique nuit à la souveraineté numérique. Il est temps de développer des modèles d’IA linguistiquement, culturellement et juridiquement ancrés dans le contexte marocain et africain, hébergés localement, et régulés selon des standards éthiques nationaux.
Le discours dominant mis en avant dans l’article repose sur les promesses techniques : automatisation, simplification, optimisation. Mais cette approche techno-solutionniste oublie les effets sociaux, politiques et culturels des systèmes IA. Surveillance, discrimination algorithmique, fracture numérique… Ce sont des enjeux majeurs. L’IA ne peut être un outil neutre. Elle doit être conçue comme un objet politique, nécessitant une éthique située et co-construite avec les chercheurs, les citoyens, et les territoires.
L’IA ne doit pas être un substitut à la politique publique, mais un levier de justice sociale et d’intelligence collective.
L’article mentionne la mobilisation des experts, chercheurs, startups, étudiants. Mais l’enjeu éducatif reste abordé de manière marginale. Or, une véritable stratégie nationale suppose une révolution éducative. Il faut penser une alphabétisation à l’IA dès le primaire, une formation éthique des enseignants, le développement de cursus hybrides, et la valorisation de la recherche en IA éthique. Former à l’IA ne signifie pas apprendre à l’utiliser, mais à la comprendre, l’interroger, et la piloter.
Le ton du reportage est volontaire et fédérateur. Il souligne l’élan patriotique et la mobilisation des acteurs. Mais la gouvernance reste descendante. Il faut aller plus loin en impliquant les territoires, les associations, les collectivités locales, les écoles, les familles. C’est ce que propose le modèle MrabaData, que j’ai développé pour une gouvernance distribuée de la donnée et de l’IA, plaçant les citoyens au cœur des processus décisionnels.
L’initiative portée par Mme El Fallah Seghrouchni constitue une avancée notable dans la structuration du débat national sur l’intelligence artificielle. Pour aller plus loin, il faudra, en plus de la logique événementielle, inscrire cette ambition dans une vision structurelle, systémique et souveraine de l’intelligence artificielle, fondée sur l’inclusion sociale, la maîtrise technologique et l’autonomie décisionnelle.
L’IA est aujourd’hui un révélateur. Elle révèle nos dépendances, mais aussi nos potentiels. Elle impose un choix : subir l’innovation, ou la gouverner.