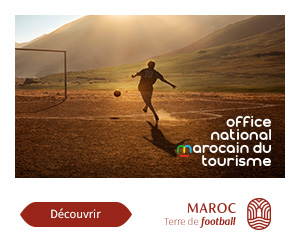Dans les soirées mondaines, la consommation de l’bayda, terme couramment employé pour désigner la cocaïne, s’est peu à peu installée dans les habitudes, jusqu’à devenir aussi incontournable que l’alcool. On n’hésite plus à aligner les rails à la table des invités, ou encore à s’éclipser dans les toilettes des boîtes de nuit pour en consommer discrètement.
Réservée auparavant à une certaine élite, en raison de son prix élevé et de la difficulté à y avoir accès, cette poudre s’est peu à peu démocratisée, au point d’être diffusée au sein des classes moyennes urbaines, tous âges confondus. “Cela reste moins addictif et plus festif que d’autres drogues plus fortes comme l’ecsta”, nous confie un consommateur régulier.
S’en procurer est devenu aussi facile que d’acheter du cannabis, tant l’offre est abondante et les fournisseurs nombreux. “En général, on se passe entre nous les numéros des dealers, qui nous livrent à domicile et en quantité souhaitée”, nous révèle-t-il.
Quant aux prix, ils n’ont cessé de baisser, passant de plus de 2.000 dirhams le gramme au début des années 2000, à environ 800 dirhams aujourd’hui, et jusqu’à 1.000 pour de la “pure”. Pour les clients fidèles, le “prix d’ami” peut tomber à 600 dirhams.
Réservée auparavant à une certaine élite, en raison de son prix élevé et de la difficulté à y avoir accès, cette poudre s’est peu à peu démocratisée, au point d’être diffusée au sein des classes moyennes urbaines, tous âges confondus. “Cela reste moins addictif et plus festif que d’autres drogues plus fortes comme l’ecsta”, nous confie un consommateur régulier.
S’en procurer est devenu aussi facile que d’acheter du cannabis, tant l’offre est abondante et les fournisseurs nombreux. “En général, on se passe entre nous les numéros des dealers, qui nous livrent à domicile et en quantité souhaitée”, nous révèle-t-il.
Quant aux prix, ils n’ont cessé de baisser, passant de plus de 2.000 dirhams le gramme au début des années 2000, à environ 800 dirhams aujourd’hui, et jusqu’à 1.000 pour de la “pure”. Pour les clients fidèles, le “prix d’ami” peut tomber à 600 dirhams.
Routes de la cocaïne
De par sa position géographique, le Maroc se trouve à l’intersection de plusieurs routes de trafic. D’un côté, ses côtes atlantiques le placent à proximité des zones de transbordement des navires venus d’Amérique du Sud, en particulier au large des îles Canaries. De l’autre, le pays est exposé sur son flanc Sud, où l’instabilité chronique de la région sahélo-saharienne a transformé ce vaste territoire en l’une des principales plaques tournantes mondiales du narcotrafic. Dans cet espace de non-droit, plusieurs groupes armés se sont reconvertis dans l’acheminement de stupéfiants. Les cargaisons en provenance des pays producteurs sont d’abord débarquées par voie maritime sur les côtes ouest-africaines, avant d’être récupérées par ces organisations criminelles pour les faire remonter vers le Nord.
Par la force des choses, le Maroc est passé d’un simple territoire de transit à un pays de consommation. Et ce, malgré la veille constante des autorités. En témoignent des saisies record, parfois de plusieurs tonnes, réalisées aussi bien au passage frontalier de Guerguerate qu’au port de Tanger Med.
“Les réseaux de trafic sont très résilients et redoublent d’ingéniosité pour faire entrer leur marchandise”, nous explique Dr Adil Loubbardi, commissaire divisionnaire et ex-chef du service ADN du laboratoire de police scientifique de la DGSN.
Des mules et des drones
Ils peuvent ainsi faire entrer leur marchandise dissimulée dans des conteneurs, cachée dans des voitures de particuliers, ou encore avoir recours à des mules, c’est-à-dire des personnes chargées de transporter la drogue sur elles ou dans leur corps. Par exemple, certains ingèrent une dizaine d’ovules de cocaïne, totalisant 500 à 600 grammes, voire davantage, afin de déjouer les contrôles dans les aéroports. “Il est très difficile de détecter ce genre de pratiques, sauf si, en cours de transit, l’un de ces ovules éclate dans l’estomac ou dans l’intestin, ce qui provoque des douleurs violentes. Ou encore si les autorités disposent d’informations précises sur l’opération”, détaille Dr Adil Loubbardi.
D’autres méthodes, bien plus discrètes, peuvent être adoptées. Notre interlocuteur relate le cas de femmes recrutées par des narcotrafiquants pour 20.000 dirhams, qui servaient de mules effectuant des allers-retours sur le vol Casablanca-Rio de Janeiro. Elles revenaient avec des objets en apparence banals, comme des fourrures ou des tableaux, dans lesquels on avait séché puis dispersé de la cocaïne.
Enfin, l’usage des drones s’est largement banalisé dans le trafic. Ces petits appareils, qui peuvent passer sous les radars, transportent jusqu’à 200 kg, qu’ils soient envoyés depuis des embarcations stationnées à quelques encablures des côtes marocaines, ou utilisés pour traverser le détroit de Gibraltar.
Mafias mondialisées
Malheureusement, “l’augmentation de la circulation de drogue est l’effet pervers de l’ouverture du Maroc au commerce et au tourisme mondiaux”, constate Dr Loubbardi. En effet, la mondialisation a facilité l’expansion de mafias de narcotrafic à l’échelle mondiale, et le Maroc n’y échappe pas.
Les plateformes portuaires internationales, en particulier Tanger Med, deviennent ainsi des points de transit pour d’importantes quantités de cocaïne, très difficiles à détecter malgré des dispositifs de plus en plus sophistiqués, qu’il s’agisse de scanners ou de chiens renifleurs.
Même chose pour les aéroports, dont la fréquentation en hausse tend à compliquer davantage les contrôles. Avec l’approche de la CAN et surtout de la Coupe du Monde, les autorités cherchent à éviter de créer des files interminables. “L’annulation du double contrôle, l’un à l’entrée de l’aéroport et l’autre à l’embarquement, va certes fluidifier le passage des voyageurs, mais présente aussi le risque de laisser se glisser du trafic entre les mailles du filet”, fait remarquer notre expert.
La première découverte
Pourtant, le Royaume est longtemps demeuré relativement épargné par la vague de cocaïne qui a submergé les États-Unis et l’Europe dans les années 1970 et 1980. “Les interpellations restaient très rares, et les personnes arrêtées ne détenaient généralement que deux ou trois grammes sur elles”, nous raconte Dr Adil Loubbardi.
Mais tout bascule en 1997, lorsque le “Duanas”, une embarcation battant pavillon du Belize, tombe en panne de moteur après avoir transbordé au large de Las Palmas plusieurs tonnes de cocaïne depuis un bateau colombien non identifié. Pris de panique, l’équipage jette par-dessus bord des centaines de colis, qui vont déferler sur les côtes marocaines, de Safi jusqu’à Sidi Rahal.
Malgré une vaste opération de ratissage menée par la police et la gendarmerie, qui a permis la saisie de 6 tonnes de cocaïne pure, d’une valeur estimée à 1,5 milliard de dollars, cette substance a réussi à pénétrer la société marocaine. D’abord présente dans des soirées discrètes à Dar Bouazza, elle s’est ensuite invitée dans les boîtes de nuit casablancaises, avant de se diffuser dans tout le pays.
Les consommateurs étant déjà accros, les réseaux criminels implantés sur le territoire n’avaient plus qu’à prendre le relais en alimentant continuellement le marché. Ils se sont d’abord approvisionnés auprès des mafias espagnoles, notamment galiciennes, avant de diversifier progressivement leurs canaux.
3 questions au Dr Adil Loubbardi : “Le Maroc fait face à un trafic en constante évolution”

Commissaire divisionnaire et ex-chef du service ADN du laboratoire de police scientifique de la DGSN, Dr Adil Loubbardi a répondu à nos questions.
- Comment ce trafic s’est-il mondialisé ?
Pendant longtemps, la cocaïne est restée un marché presque entièrement centré sur le continent américain. Le produit partait d’Amérique du Sud, principalement de Colombie, de Bolivie et du Pérou, à destination des États-Unis. Quand ce marché s’est saturé, les organisations criminelles ont cherché de nouveaux débouchés et se sont tournées vers l’Europe occidentale, où la consommation progressait. Cette bascule a ouvert la voie à une véritable mondialisation du trafic. Tous les continents sont désormais touchés, y compris l’Afrique, qui s’intègre de plus en plus aux routes permettant d’atteindre le marché européen en contournant les contrôles aux frontières du continent.
- Quelles sont les principales routes de la cocaïne vers l’Europe ?
Il existe essentiellement trois routes. La première relie les Caraïbes aux grands ports du Nord de l’Europe, comme Rotterdam ou Anvers, en passant par les Açores. La deuxième part d’Amérique du Sud, notamment du Venezuela, puis file vers le Cap-Vert, Madère et les Canaries avant de remonter vers l’Europe. La troisième, plus récente, est la voie africaine qui traverse l’Afrique de l’Ouest puis l’Afrique du Nord, dont le Maroc. Cette route africaine s’est imposée au fil des années pour contourner les contrôles européens. Elle combine transport maritime, aérien et terrestre, et repose sur la façade atlantique du Maroc et son réseau routier, ce qui en fait un maillon central dans ce parcours.
- Pourquoi les autorités marocaines n’arrivent-elles pas à maîtriser ce flux ?
D’abord, le pays possède une longue façade atlantique, avec de vastes zones difficiles à surveiller en permanence. Les trafiquants en profitent pour organiser des transbordements rapides, souvent en s’appuyant sur des flottilles de pêche. Le phénomène est aussi porté par des organisations criminelles internationales très agiles, capables de changer de route ou de méthode dès qu’un contrôle se renforce. Elles utilisent la mer, la route et parfois l’avion, ce qui multiplie les points de passage possibles. Les flux commerciaux importants facilitent également la dissimulation d’une cargaison illicite au milieu des échanges légaux. Le Maroc fait face à un trafic en constante évolution, qui reste difficile à contenir totalement.
ONUDC : Un marché en pleine explosion
Le rapport 2025 de l’agence onusienne ONUDC (Office des Nations Unies contre la drogue et le crime) confirme l’explosion du marché mondial de la cocaïne. “La cocaïne est le marché des drogues illicites qui connaît la plus forte croissance au monde”, souligne cette instance basée à Vienne, en Autriche.
En 2023, la production a atteint 3.708 tonnes de produit pur, soit une hausse spectaculaire de 34% en un an, portée par l’expansion des cultures de coca en Colombie, au Pérou et en Bolivie, tandis que les saisies mondiales ont progressé de 68% entre 2019 et 2023.
Le nombre d’usagers est passé de 17 à 25 millions entre 2013 et 2023. Cette dynamique s’inscrit dans un contexte où la demande se banalise dans les milieux aisés, alimentant un “cercle vicieux” de consommation plus régulière, parfois quotidienne, observe l’ONUDC.
La concurrence féroce de ce marché pesant “des centaines de milliards de dollars chaque année” entretient une violence endémique qui dépasse désormais les frontières des Amériques, principal marché avec l’Europe occidentale et centrale. En 2023, 6% de la population mondiale âgée de 15 à 64 ans avait consommé une drogue, contre 5,2% en 2013.
En 2023, la production a atteint 3.708 tonnes de produit pur, soit une hausse spectaculaire de 34% en un an, portée par l’expansion des cultures de coca en Colombie, au Pérou et en Bolivie, tandis que les saisies mondiales ont progressé de 68% entre 2019 et 2023.
Le nombre d’usagers est passé de 17 à 25 millions entre 2013 et 2023. Cette dynamique s’inscrit dans un contexte où la demande se banalise dans les milieux aisés, alimentant un “cercle vicieux” de consommation plus régulière, parfois quotidienne, observe l’ONUDC.
La concurrence féroce de ce marché pesant “des centaines de milliards de dollars chaque année” entretient une violence endémique qui dépasse désormais les frontières des Amériques, principal marché avec l’Europe occidentale et centrale. En 2023, 6% de la population mondiale âgée de 15 à 64 ans avait consommé une drogue, contre 5,2% en 2013.
Afrique de l’Ouest : Balkan Connection
Depuis 2019, plusieurs groupes criminels originaires des Balkans, considérés parmi les plus structurés du marché européen, ont étendu leurs activités vers l’Afrique de l’Ouest. Ils y acheminent par voie maritime des cargaisons de cocaïne de plusieurs tonnes en provenance du Brésil et d’autres pays d’Amérique latine.
Cette région est devenue pour eux une plateforme stratégique qui sert à la fois de zone de transit, d’entreposage et de redistribution vers l’Europe.
Ce positionnement s’explique par la hausse de la demande européenne, par le renforcement des contrôles sur les routes directes vers le continent et par la capacité de ces groupes à nouer des alliances étroites avec des cartels latino-américains tels que le Primeiro Comando da Capital brésilien.
Leur présence repose sur des intermédiaires locaux chargés de la logistique et des relations avec les réseaux ouest-africains, une fonction devenue centrale dans la chaîne du trafic.
Il s’agit en particulier du clan monténégrin Kavač, son rival Škaljari ainsi que plusieurs réseaux albanais installés au Sénégal et en Gambie. Ces groupes tendent d’ailleurs à renforcer leur autonomie en investissant directement dans des infrastructures locales, des mécanismes de protection et de nouveaux circuits de distribution.
Cette cocaïne peut être acheminée par bateau vers l’Europe en transitant par les îles du Cap-Vert puis par les Canaries. Elle peut aussi emprunter des routes terrestres en traversant la région sahélo-saharienne, notamment la Mauritanie, le Mali ou le Niger, avant de remonter vers le Nord de l’Afrique, à travers le Maroc, l’Algérie ou la Libye.
Cette région est devenue pour eux une plateforme stratégique qui sert à la fois de zone de transit, d’entreposage et de redistribution vers l’Europe.
Ce positionnement s’explique par la hausse de la demande européenne, par le renforcement des contrôles sur les routes directes vers le continent et par la capacité de ces groupes à nouer des alliances étroites avec des cartels latino-américains tels que le Primeiro Comando da Capital brésilien.
Leur présence repose sur des intermédiaires locaux chargés de la logistique et des relations avec les réseaux ouest-africains, une fonction devenue centrale dans la chaîne du trafic.
Il s’agit en particulier du clan monténégrin Kavač, son rival Škaljari ainsi que plusieurs réseaux albanais installés au Sénégal et en Gambie. Ces groupes tendent d’ailleurs à renforcer leur autonomie en investissant directement dans des infrastructures locales, des mécanismes de protection et de nouveaux circuits de distribution.
Cette cocaïne peut être acheminée par bateau vers l’Europe en transitant par les îles du Cap-Vert puis par les Canaries. Elle peut aussi emprunter des routes terrestres en traversant la région sahélo-saharienne, notamment la Mauritanie, le Mali ou le Niger, avant de remonter vers le Nord de l’Afrique, à travers le Maroc, l’Algérie ou la Libye.











![Narcotrafic : Aux origines de la déferlante de cocaïne sur le Royaume [INTÉGRAL] Narcotrafic : Aux origines de la déferlante de cocaïne sur le Royaume [INTÉGRAL]](https://www.lopinion.ma/photo/art/grande/92810967-64980256.jpg?v=1764064296)
![Narcotrafic : Aux origines de la déferlante de cocaïne sur le Royaume [INTÉGRAL] Narcotrafic : Aux origines de la déferlante de cocaïne sur le Royaume [INTÉGRAL]](https://www.lopinion.ma/photo/art/default/92810967-64980256.jpg?v=1764064296)

![Narcotrafic : Aux origines de la déferlante de cocaïne sur le Royaume [INTÉGRAL] Narcotrafic : Aux origines de la déferlante de cocaïne sur le Royaume [INTÉGRAL]](https://www.lopinion.ma/photo/art/grande/92810967-64980296.jpg?v=1764064929)
![Narcotrafic : Aux origines de la déferlante de cocaïne sur le Royaume [INTÉGRAL] Narcotrafic : Aux origines de la déferlante de cocaïne sur le Royaume [INTÉGRAL]](https://www.lopinion.ma/photo/art/default/92810967-64980296.jpg?v=1764064932)
![Narcotrafic : Aux origines de la déferlante de cocaïne sur le Royaume [INTÉGRAL] Narcotrafic : Aux origines de la déferlante de cocaïne sur le Royaume [INTÉGRAL]](https://www.lopinion.ma/photo/art/grande/92810967-64980340.jpg?v=1764064766)
![Narcotrafic : Aux origines de la déferlante de cocaïne sur le Royaume [INTÉGRAL] Narcotrafic : Aux origines de la déferlante de cocaïne sur le Royaume [INTÉGRAL]](https://www.lopinion.ma/photo/art/default/92810967-64980340.jpg?v=1764064767)