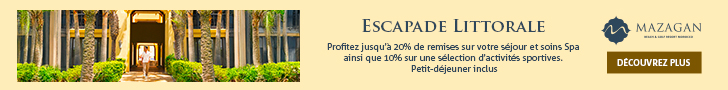Des Marocains se sont soudain échangé des regards interloqués : « Pardon ? Mais de quoi elle parle, celle-là ? » Dans l’imaginaire collectif, les grand-mères marocaines ne se vengent pas. Elles pardonnent, prient, préparent du couscous pour tout le quartier et, si elles doivent régler un différend, c’est à coups de bénédictions et de dattes, jamais de rancune. Bref, la grand-mère Slimani ressemble davantage à un personnage de roman : fascinante, imprévisible, mais pas nécessairement représentative de toutes les grand-mères marocaines. Issue d’une classe plutôt bourgeoise, ne parlant pas l’arabe et ayant vécu en France, Slimani porte un regard quelque peu distant sur son pays d’origine, un pays qu’elle continue d’interroger et d’explorer à travers ses écrits.
Le problème, par ailleurs, c’est qu’au Maroc, dès qu’un artiste ou un écrivain devient célèbre, on exige de lui de cesser d’être lui-même : il devient ambassadeur. Et à ce moment-là, chaque mot prononcé à la télévision devient une affaire d’État. Si Slimani avait dit que sa grand-mère aimait le foot, on aurait réclamé une interview à BeIN Sports ; mais là, parler de vengeance, c’était trop. La vengeance, ce n’est pas très exotique, pas très carte postale. On aurait préféré « bien prier, bien aimer, pardonner et faire le couscous du vendredi ». Ça, au moins, ça passe mieux à la télé.
Mais enfin, soyons sérieux, ou plutôt, restons drôles. Ce n’est pas un discours politique, c’est une phrase littéraire. Slimani ne décrit pas le Maroc : elle raconte une émotion, un souvenir, une légende familiale peut-être inventée à moitié, comme on le fait tous quand on brode nos histoires autour du thé. Le mot « vengeance » n’est pas un plan d’action, c’est un trait d’esprit, peut-être une métaphore. Et puis, entre nous, si une grand-mère a vraiment dit ça, elle mérite un roman à elle seule, voire un One women show.
Alors à tous ceux qui se sont sentis offensés, respirez un bon coup et souriez. On peut aimer le Maroc et rire d’une phrase. On peut admirer Leïla Slimani et reconnaître qu’elle a parfois le sens du drame, a t-elle pêché par excès de généralisation? Ce n’est pas un crime : c’est de la littérature. Et la littérature, ce n’est pas fait pour flatter l’ego national, c’est fait pour déranger un peu, piquer là où ça gratte, provoquer des conversations.
Au fond, la vraie question n’est pas de savoir si la grand-mère de Slimani est « vraiment marocaine ». Elle l’est peut-être autant que les vôtres, avec ses contradictions, ses colères, sa sagesse et ses prières, dont le but secret était peut-être de se venger d’un destin pas toujours juste avec les femmes.
Ce qui compte, c’est que sa petite-fille écrit bien. Et ça, on ne peut pas lui enlever. Alors, qu’elle parle de vengeance, de vin ou de littérature, qu’importe, tant qu’elle continue à écrire des livres qu’on lit jusqu’à la dernière page. Mieux vaut reconnaître qu’elle est, elle, une écrivaine marocaine du monde, libre, parfois provocante, toujours sincère dans sa quête d’histoires et de sens.
Et pour le reste, on peut toujours lever notre verre de thé à la menthe et dire, avec un sourire : « Santé, bon appétit, et… surtout, pas de rancune. Allah ysameh ».
Mohamed Lotfi
24 Octobre 2025
Le thé, la vengeance et les malentendus!
« Dans la vie, il faut bien boire, bien manger et se venger. » La phrase a fait sursauter plus d’un spectateur, comme si une grand-mère venait de jeter une grenade dans la théière. Et pourtant, quel charme dans cette maxime ! Elle a le goût d’un dicton transmis entre deux gorgées de thé brûlant, avec ce sourire qui dit tout à la fois : je plaisante et je sais de quoi je parle.
Mais Leila Slimani, auteure de la phrase, sait-elle vraiment de quoi elle parle ? Tout Marocain ayant connu sa grand-mère aurait envie de répondre : non, pas tout à fait. Dans l’imaginaire collectif marocain, la grand-mère n’est pas synonyme de vengeance, mais plutôt de douceur, de patience et de couscous du vendredi. Seulement voilà, Slimani n’est pas ethnographe. Elle n’inventorie pas les coutumes : elle écrit, elle invente. C’est une romancière, pas une archiviste du réel. Elle façonne son univers, comme Boris Vian dans L’Écume des jours ou Romain Gary dans La Vie devant soi.
Boire, manger, se venger : Slimani en a fait les trois piliers d’une philosophie presque gastronomique. Dans certaines maisons, la vengeance se mijote doucement, à feu doux, entre la harira et les confidences. Elle n’est pas haineuse, mais mémorielle : la revanche tranquille de celles qu’on n’a pas écoutées. Chez les grand-mères marocaines, la vengeance n’est pas un crime, c’est une épice.
Mais voilà que Slimani, sur un plateau québécois, lâche sa phrase. Et aussitôt, le ban et l’arrière-ban des réseaux s’enflamment. On la traite de profiteuse, de vendeuse, d’ingrate, bref, beaucoup lui refusent la moindre goutte de thé à la table de sa propre histoire. Certains la réduisent à une « pseudo-Française », d’autres à une « pseudo-Marocaine ». Et pour faire savant, quelques-uns citent Edward Said ou Frantz Fanon à la rescousse de leur indignation. Les réactions, il faut bien le dire, ont parfois eu un petit goût de vengeance elles aussi. Comme si chacun, soudain, se découvrait une grand-mère marocaine à défendre, un honneur familial, voire national, à laver à coups de likes.
Or, au lieu de lui prêter de mauvaises intentions, on pourrait simplement se souvenir qu’elle est écrivaine. Pas sociologue, pas porte-parole, encore moins prophétesse. Si elle avait été infirmière ou architecte, sa phrase aurait paru incongrue, voire inquiétante. Mais une romancière a le droit à la métaphore, à la malice, à la provocation poétique. Elle travaille avec les ombres, les souvenirs, les glissements de sens, tout ce que la vie, justement, ne laisse pas dire.
Et Slimani, surtout, parle depuis un lieu incertain : ni tout à fait ici, ni tout à fait là-bas. Étrangère au Maroc dont elle ne parle pas la langue, étrangère en France où l’on scrute son prénom comme une preuve à charge, elle habite ce nulle part qu’on appelle littérature. C’est peut-être de cet exil doux-amer que naît sa phrase : la sagesse d’une grand-mère revisitée par une petite-fille qui ne sait jamais où poser sa tasse.
On pourrait même y voir une allégorie de son œuvre : boire, pour supporter le réel ; manger, pour lui donner forme ; se venger, pour ne pas disparaître sous le regard des autres.
Et si, finalement, cette vengeance-là n’était qu’un autre mot pour dire : écrire ? Il y a des phrases qui blessent et d’autres qui chatouillent. Celle-ci fait les deux. Elle pique les sérieux, réchauffe les lucides, amuse le public d’un plateau québécois. Et c’est sans doute ce qui confirme le statut de Slimani : ni tout à fait marocaine, ni complètement française, mais, par sa quête obstinée de soi, universelle.
Le problème, par ailleurs, c’est qu’au Maroc, dès qu’un artiste ou un écrivain devient célèbre, on exige de lui de cesser d’être lui-même : il devient ambassadeur. Et à ce moment-là, chaque mot prononcé à la télévision devient une affaire d’État. Si Slimani avait dit que sa grand-mère aimait le foot, on aurait réclamé une interview à BeIN Sports ; mais là, parler de vengeance, c’était trop. La vengeance, ce n’est pas très exotique, pas très carte postale. On aurait préféré « bien prier, bien aimer, pardonner et faire le couscous du vendredi ». Ça, au moins, ça passe mieux à la télé.
Mais enfin, soyons sérieux, ou plutôt, restons drôles. Ce n’est pas un discours politique, c’est une phrase littéraire. Slimani ne décrit pas le Maroc : elle raconte une émotion, un souvenir, une légende familiale peut-être inventée à moitié, comme on le fait tous quand on brode nos histoires autour du thé. Le mot « vengeance » n’est pas un plan d’action, c’est un trait d’esprit, peut-être une métaphore. Et puis, entre nous, si une grand-mère a vraiment dit ça, elle mérite un roman à elle seule, voire un One women show.
Alors à tous ceux qui se sont sentis offensés, respirez un bon coup et souriez. On peut aimer le Maroc et rire d’une phrase. On peut admirer Leïla Slimani et reconnaître qu’elle a parfois le sens du drame, a t-elle pêché par excès de généralisation? Ce n’est pas un crime : c’est de la littérature. Et la littérature, ce n’est pas fait pour flatter l’ego national, c’est fait pour déranger un peu, piquer là où ça gratte, provoquer des conversations.
Au fond, la vraie question n’est pas de savoir si la grand-mère de Slimani est « vraiment marocaine ». Elle l’est peut-être autant que les vôtres, avec ses contradictions, ses colères, sa sagesse et ses prières, dont le but secret était peut-être de se venger d’un destin pas toujours juste avec les femmes.
Ce qui compte, c’est que sa petite-fille écrit bien. Et ça, on ne peut pas lui enlever. Alors, qu’elle parle de vengeance, de vin ou de littérature, qu’importe, tant qu’elle continue à écrire des livres qu’on lit jusqu’à la dernière page. Mieux vaut reconnaître qu’elle est, elle, une écrivaine marocaine du monde, libre, parfois provocante, toujours sincère dans sa quête d’histoires et de sens.
Et pour le reste, on peut toujours lever notre verre de thé à la menthe et dire, avec un sourire : « Santé, bon appétit, et… surtout, pas de rancune. Allah ysameh ».
Mohamed Lotfi
24 Octobre 2025
Le thé, la vengeance et les malentendus!
« Dans la vie, il faut bien boire, bien manger et se venger. » La phrase a fait sursauter plus d’un spectateur, comme si une grand-mère venait de jeter une grenade dans la théière. Et pourtant, quel charme dans cette maxime ! Elle a le goût d’un dicton transmis entre deux gorgées de thé brûlant, avec ce sourire qui dit tout à la fois : je plaisante et je sais de quoi je parle.
Mais Leila Slimani, auteure de la phrase, sait-elle vraiment de quoi elle parle ? Tout Marocain ayant connu sa grand-mère aurait envie de répondre : non, pas tout à fait. Dans l’imaginaire collectif marocain, la grand-mère n’est pas synonyme de vengeance, mais plutôt de douceur, de patience et de couscous du vendredi. Seulement voilà, Slimani n’est pas ethnographe. Elle n’inventorie pas les coutumes : elle écrit, elle invente. C’est une romancière, pas une archiviste du réel. Elle façonne son univers, comme Boris Vian dans L’Écume des jours ou Romain Gary dans La Vie devant soi.
Boire, manger, se venger : Slimani en a fait les trois piliers d’une philosophie presque gastronomique. Dans certaines maisons, la vengeance se mijote doucement, à feu doux, entre la harira et les confidences. Elle n’est pas haineuse, mais mémorielle : la revanche tranquille de celles qu’on n’a pas écoutées. Chez les grand-mères marocaines, la vengeance n’est pas un crime, c’est une épice.
Mais voilà que Slimani, sur un plateau québécois, lâche sa phrase. Et aussitôt, le ban et l’arrière-ban des réseaux s’enflamment. On la traite de profiteuse, de vendeuse, d’ingrate, bref, beaucoup lui refusent la moindre goutte de thé à la table de sa propre histoire. Certains la réduisent à une « pseudo-Française », d’autres à une « pseudo-Marocaine ». Et pour faire savant, quelques-uns citent Edward Said ou Frantz Fanon à la rescousse de leur indignation. Les réactions, il faut bien le dire, ont parfois eu un petit goût de vengeance elles aussi. Comme si chacun, soudain, se découvrait une grand-mère marocaine à défendre, un honneur familial, voire national, à laver à coups de likes.
Or, au lieu de lui prêter de mauvaises intentions, on pourrait simplement se souvenir qu’elle est écrivaine. Pas sociologue, pas porte-parole, encore moins prophétesse. Si elle avait été infirmière ou architecte, sa phrase aurait paru incongrue, voire inquiétante. Mais une romancière a le droit à la métaphore, à la malice, à la provocation poétique. Elle travaille avec les ombres, les souvenirs, les glissements de sens, tout ce que la vie, justement, ne laisse pas dire.
Et Slimani, surtout, parle depuis un lieu incertain : ni tout à fait ici, ni tout à fait là-bas. Étrangère au Maroc dont elle ne parle pas la langue, étrangère en France où l’on scrute son prénom comme une preuve à charge, elle habite ce nulle part qu’on appelle littérature. C’est peut-être de cet exil doux-amer que naît sa phrase : la sagesse d’une grand-mère revisitée par une petite-fille qui ne sait jamais où poser sa tasse.
On pourrait même y voir une allégorie de son œuvre : boire, pour supporter le réel ; manger, pour lui donner forme ; se venger, pour ne pas disparaître sous le regard des autres.
Et si, finalement, cette vengeance-là n’était qu’un autre mot pour dire : écrire ? Il y a des phrases qui blessent et d’autres qui chatouillent. Celle-ci fait les deux. Elle pique les sérieux, réchauffe les lucides, amuse le public d’un plateau québécois. Et c’est sans doute ce qui confirme le statut de Slimani : ni tout à fait marocaine, ni complètement française, mais, par sa quête obstinée de soi, universelle.