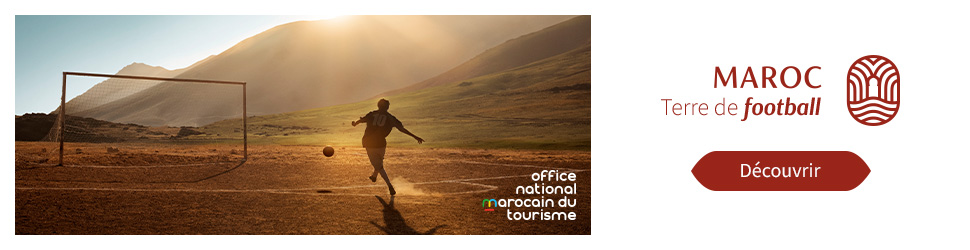Ce livre m’a accompagné jusqu’à la mer. Sur la plage d’Old Orchard, entre la rumeur des vagues et la lumière salée du soir, les voix de la Résidence Séquoia se mêlaient au vent, comme si le roman lui-même respirait au rythme du large. C’est dire à quel point Résidence Séquoia n’est pas un simple récit : c’est une présence, un souffle collectif, une polyphonie humaine qui transcende les murs d’un établissement pour personnes âgées afin d’embrasser, avec tendresse et lucidité, le Québec d’aujourd’hui.
Rachida M’Faddel ne signe pas ici un roman social au sens strict, ni une enquête sur les conditions de vie en CHSLD. Elle écrit une fresque du vivre-ensemble, une exploration sensible des rapports humains dans leur complexité, leur rugosité, leur beauté. Ce que les commissions parlementaires, les débats médiatiques et les slogans politiques n’ont pas su accomplir, elle le réalise par la littérature : réinventer la possibilité d’un dialogue entre les différences, créer un espace commun où la parole se libère, où les identités cessent d’être des frontières.
Dans cette Résidence Séquoia, les cultures, les langues, les croyances et les orientations se croisent, se frottent, se heurtent, mais surtout, elles s’apprivoisent. Chacun des personnages, qu’il soit originaire du Liban, d’Haïti, de la Chine ou du quartier Villeray, porte avec lui le poids de son histoire, la mémoire de ses blessures et la lumière de ses espérances. Ce sont des êtres à la fois ordinaires et immenses, parce qu’ils incarnent la condition humaine dans toute sa diversité.
Le roman devient alors une sorte de laboratoire d’humanité : on y observe comment la proximité, parfois forcée, parfois choisie, transforme les rapports entre les êtres. Ici, la curiosité de l’autre n’est pas un danger, mais une ouverture. On apprend que l’écoute véritable suppose le risque du choc : celui d’être bousculé dans ses certitudes, d’être dérangé par la vérité nue d’autrui. Mais chez M’Faddel, le choc n’est jamais stérile. Il devient un ferment, une étincelle de compréhension. Les disputes, les rires, les maladresses et les tendresses forment la trame d’un dialogue ininterrompu où la franchise n’exclut jamais la bienveillance.
Et il y a cette phrase, lancée par Paula, la plus truculente des résidentes, à Shiraz la nouvelle venue : « Ma fille, tu vas avoir le temps de te reposer quand tu vas être morte. Profite donc des jours qui te restent avec nous. » Cette réplique, à la fois drôle et bouleversante, condense tout le message du roman : vivre, c’est participer, raconter, transmettre. Se retirer, se taire, c’est déjà mourir un peu.
Chez M’Faddel, raconter n’est jamais anodin. Chaque personnage est convié à remonter le fil de sa vie, à exhumer les souvenirs enfouis, à dire l’indicible. Ce travail de mémoire devient un acte de libération. Il ne s’agit pas d’une nostalgie figée, mais d’une réconciliation avec soi-même. En redonnant la parole à ces voix longtemps tues, celles des femmes, des immigrés, des vieillards, des oubliés, l’auteure redonne aussi une jeunesse à leurs âmes.
Ainsi, Marguerite, centenaire née au Liban, voit sa vie racontée à la fois par son fils, qui en glorifie les exploits, et par Esther, l’amie fidèle, qui en révèle les zones d’ombre. Deux récits, deux vérités, mais un même besoin : que la vie soit dite dans toute sa complexité, sans censure, sans fard. Car à la Résidence Séquoia, on ne cache rien, ni de soi ni des autres. Même les secrets les plus enfouis trouvent leur place dans ce grand tissu de confidences.
Difficile de parler de Résidence Séquoia sans évoquer Paula, ce moulin à paroles inépuisable, ce personnage haut en couleur qui semble tout droit sorti d’une pièce de Michel Tremblay. Elle a la gouaille du peuple, l’esprit vif et la générosité de cœur qui désarment tout cynisme. À elle seule, elle incarne la dimension théâtrale du roman. On l’imagine volontiers sur scène, interprétée par une Louise Latraverse habitée, tant son monologue est savoureux, oscillant entre humour caustique et émotion pure.
Ce qui fait la force du livre, c’est sa justesse. M’Faddel ne tombe jamais dans le didactisme. Elle n’oppose pas les cultures, elle les met en dialogue. Elle ne prêche pas la tolérance : elle la montre à l’œuvre, dans ses élans et ses maladresses, dans la parole qui trébuche, dans le rire qui désamorce, dans l’écoute qui console. Résidence Séquoia nous rappelle que le vivre-ensemble n’est pas un concept abstrait ni une formule politique : c’est un exercice quotidien de générosité et de courage, un art fragile qui s’apprend dans les gestes ordinaires, autour d’une table de cuisine, d’un jeu de cartes, d’un souvenir partagé.
Rachida M’Faddel signe ici un roman lumineux, porté par une langue claire, sensible, parfois ironique, toujours profondément humaine. Six années de travail ont donné naissance à une œuvre qui nous ressemble, qui nous interroge et nous console à la fois. Il y a, dans Résidence Séquoia, une matière dramatique assez riche pour inspirer un film ou une série, tant ses personnages, ses dialogues et ses situations débordent de vie et de vérité.
Mais avant qu’il ne prenne vie sur scène ou à l’écran, offrez-vous le plaisir de le lire. Et si, comme moi, vous l’aimez, laissez-vous gagner par son humanité et par cette joie simple de se sentir un peu moins seul au monde.
Mohamed Lotfi
Résidence Séquoia, publié chez Fidès.
Rachida M’Faddel ne signe pas ici un roman social au sens strict, ni une enquête sur les conditions de vie en CHSLD. Elle écrit une fresque du vivre-ensemble, une exploration sensible des rapports humains dans leur complexité, leur rugosité, leur beauté. Ce que les commissions parlementaires, les débats médiatiques et les slogans politiques n’ont pas su accomplir, elle le réalise par la littérature : réinventer la possibilité d’un dialogue entre les différences, créer un espace commun où la parole se libère, où les identités cessent d’être des frontières.
Dans cette Résidence Séquoia, les cultures, les langues, les croyances et les orientations se croisent, se frottent, se heurtent, mais surtout, elles s’apprivoisent. Chacun des personnages, qu’il soit originaire du Liban, d’Haïti, de la Chine ou du quartier Villeray, porte avec lui le poids de son histoire, la mémoire de ses blessures et la lumière de ses espérances. Ce sont des êtres à la fois ordinaires et immenses, parce qu’ils incarnent la condition humaine dans toute sa diversité.
Le roman devient alors une sorte de laboratoire d’humanité : on y observe comment la proximité, parfois forcée, parfois choisie, transforme les rapports entre les êtres. Ici, la curiosité de l’autre n’est pas un danger, mais une ouverture. On apprend que l’écoute véritable suppose le risque du choc : celui d’être bousculé dans ses certitudes, d’être dérangé par la vérité nue d’autrui. Mais chez M’Faddel, le choc n’est jamais stérile. Il devient un ferment, une étincelle de compréhension. Les disputes, les rires, les maladresses et les tendresses forment la trame d’un dialogue ininterrompu où la franchise n’exclut jamais la bienveillance.
Et il y a cette phrase, lancée par Paula, la plus truculente des résidentes, à Shiraz la nouvelle venue : « Ma fille, tu vas avoir le temps de te reposer quand tu vas être morte. Profite donc des jours qui te restent avec nous. » Cette réplique, à la fois drôle et bouleversante, condense tout le message du roman : vivre, c’est participer, raconter, transmettre. Se retirer, se taire, c’est déjà mourir un peu.
Chez M’Faddel, raconter n’est jamais anodin. Chaque personnage est convié à remonter le fil de sa vie, à exhumer les souvenirs enfouis, à dire l’indicible. Ce travail de mémoire devient un acte de libération. Il ne s’agit pas d’une nostalgie figée, mais d’une réconciliation avec soi-même. En redonnant la parole à ces voix longtemps tues, celles des femmes, des immigrés, des vieillards, des oubliés, l’auteure redonne aussi une jeunesse à leurs âmes.
Ainsi, Marguerite, centenaire née au Liban, voit sa vie racontée à la fois par son fils, qui en glorifie les exploits, et par Esther, l’amie fidèle, qui en révèle les zones d’ombre. Deux récits, deux vérités, mais un même besoin : que la vie soit dite dans toute sa complexité, sans censure, sans fard. Car à la Résidence Séquoia, on ne cache rien, ni de soi ni des autres. Même les secrets les plus enfouis trouvent leur place dans ce grand tissu de confidences.
Difficile de parler de Résidence Séquoia sans évoquer Paula, ce moulin à paroles inépuisable, ce personnage haut en couleur qui semble tout droit sorti d’une pièce de Michel Tremblay. Elle a la gouaille du peuple, l’esprit vif et la générosité de cœur qui désarment tout cynisme. À elle seule, elle incarne la dimension théâtrale du roman. On l’imagine volontiers sur scène, interprétée par une Louise Latraverse habitée, tant son monologue est savoureux, oscillant entre humour caustique et émotion pure.
Ce qui fait la force du livre, c’est sa justesse. M’Faddel ne tombe jamais dans le didactisme. Elle n’oppose pas les cultures, elle les met en dialogue. Elle ne prêche pas la tolérance : elle la montre à l’œuvre, dans ses élans et ses maladresses, dans la parole qui trébuche, dans le rire qui désamorce, dans l’écoute qui console. Résidence Séquoia nous rappelle que le vivre-ensemble n’est pas un concept abstrait ni une formule politique : c’est un exercice quotidien de générosité et de courage, un art fragile qui s’apprend dans les gestes ordinaires, autour d’une table de cuisine, d’un jeu de cartes, d’un souvenir partagé.
Rachida M’Faddel signe ici un roman lumineux, porté par une langue claire, sensible, parfois ironique, toujours profondément humaine. Six années de travail ont donné naissance à une œuvre qui nous ressemble, qui nous interroge et nous console à la fois. Il y a, dans Résidence Séquoia, une matière dramatique assez riche pour inspirer un film ou une série, tant ses personnages, ses dialogues et ses situations débordent de vie et de vérité.
Mais avant qu’il ne prenne vie sur scène ou à l’écran, offrez-vous le plaisir de le lire. Et si, comme moi, vous l’aimez, laissez-vous gagner par son humanité et par cette joie simple de se sentir un peu moins seul au monde.
Mohamed Lotfi
Résidence Séquoia, publié chez Fidès.