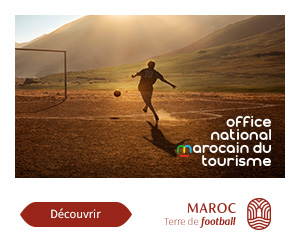Le Maroc continue d’afficher une forte préférence pour le modèle parlementaire, même si des évolutions notables traduisent une complexité grandissante dans les attentes citoyennes. D’après les résultats d’un sondage publié par le Baromètre arabe sous le titre « L’opinion publique face aux systèmes politiques au Moyen-Orient et en Afrique du Nord », 68 % des Marocains interrogés estiment que le système parlementaire, où toutes les familles politiques – nationalistes, islamistes, progressistes ou libérales – peuvent concourir dans un cadre électoral, demeure le plus pertinent pour leur pays.
L’étude souligne que ce soutien s’inscrit dans un contexte de croissance économique relative, perçue comme un facteur renforçant l’adhésion au modèle pluraliste. Mais derrière cette stabilité apparente se dessine une tendance plus nuancée : une partie non négligeable de la population se dit prête à envisager des alternatives moins démocratiques si elles garantissent efficacité et résultats tangibles.
Ainsi, 23 % des sondés déclarent préférer un régime dominé par une autorité forte, capable de trancher sans égard pour l’opinion de l’opposition ou l’issue des élections. De même, 39 % des répondants affirment privilégier un modèle dans lequel l’État assure les besoins fondamentaux des citoyens, mais sans leur octroyer de véritable rôle dans le processus décisionnel.
L’étude souligne que ce soutien s’inscrit dans un contexte de croissance économique relative, perçue comme un facteur renforçant l’adhésion au modèle pluraliste. Mais derrière cette stabilité apparente se dessine une tendance plus nuancée : une partie non négligeable de la population se dit prête à envisager des alternatives moins démocratiques si elles garantissent efficacité et résultats tangibles.
Ainsi, 23 % des sondés déclarent préférer un régime dominé par une autorité forte, capable de trancher sans égard pour l’opinion de l’opposition ou l’issue des élections. De même, 39 % des répondants affirment privilégier un modèle dans lequel l’État assure les besoins fondamentaux des citoyens, mais sans leur octroyer de véritable rôle dans le processus décisionnel.
Une évolution en dix ans
Comparé aux vagues précédentes du Baromètre (2012-2014), les résultats montrent une relative continuité mais avec certaines inflexions. En effet, à l’époque, 73 % des Marocains soutenaient l’option parlementaire, soit cinq points de plus qu’aujourd’hui. Dans le même temps, l’attrait pour « l’homme fort » au pouvoir, limité à 9 % des répondants il y a dix ans, a progressé pour atteindre 14 %. Cette dynamique traduit une lente mais réelle montée en puissance de la tentation autoritaire, dans un contexte régional marqué par les désillusions de l’après-Printemps arabe.
Le rapport rappelle par ailleurs que ce basculement n’est pas propre au Maroc. Dans plusieurs pays de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), le soutien à des modèles démocratiques parlementaires libéraux a décliné au cours de la dernière décennie. Les aspirations initiales à une représentation élargie se heurtent de plus en plus à la demande de gouvernance « efficace », quitte à rogner sur les libertés politiques.
Le rapport rappelle par ailleurs que ce basculement n’est pas propre au Maroc. Dans plusieurs pays de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), le soutien à des modèles démocratiques parlementaires libéraux a décliné au cours de la dernière décennie. Les aspirations initiales à une représentation élargie se heurtent de plus en plus à la demande de gouvernance « efficace », quitte à rogner sur les libertés politiques.
Des aspirations contradictoires
Les données recueillies révèlent également une progression de ce que les chercheurs appellent la « dictature juste » : un régime perçu comme capable de répondre aux besoins matériels et de garantir un minimum de justice sociale, même au prix de sacrifices démocratiques. En 2016 déjà, près d’un tiers des citoyens de la région déclaraient prêts à abandonner une partie de leurs droits politiques contre la promesse d’une sécurité économique. Au Maroc, cette inclination a augmenté de 26 points en dix ans, se situant parmi les hausses les plus marquées, aux côtés de la Jordanie (+24 points), du Liban (+20 points) et de la Tunisie (+10 points).
Autre indicateur important : l’adhésion à un modèle de gouvernance fondé sur la Charia. Si celle-ci demeure majoritaire en Mauritanie et en Jordanie, elle reste marginale au Maroc et au Liban, limitée à de petites franges de la population. Le rapport met toutefois en lumière l’existence de soutiens hybrides, favorables à des régimes combinant principes démocratiques et référentiels religieux.
Autre indicateur important : l’adhésion à un modèle de gouvernance fondé sur la Charia. Si celle-ci demeure majoritaire en Mauritanie et en Jordanie, elle reste marginale au Maroc et au Liban, limitée à de petites franges de la population. Le rapport met toutefois en lumière l’existence de soutiens hybrides, favorables à des régimes combinant principes démocratiques et référentiels religieux.
Une recherche d’équilibre
Pour les auteurs du Baromètre arabe, ces évolutions traduisent un constat majeur : les sociétés de la région, Maroc inclus, sont toujours en quête d’un système qui conjugue représentation politique réelle et efficacité institutionnelle tangible. Si la démocratie demeure un idéal, elle peine à convaincre pleinement lorsqu’elle ne parvient pas à répondre aux attentes en matière d’emploi, de justice sociale et de gouvernance transparente.
In fine, le rapport observe que les Marocains – tout en demeurant largement acquis au pluralisme parlementaire – expriment un désir croissant de résultats concrets, quitte à relativiser l’importance de la participation politique. Ce paradoxe reflète les défis auxquels les démocraties émergentes de la région devront faire face : préserver les acquis du pluralisme tout en répondant aux aspirations pressantes de dignité, de sécurité économique et de gouvernance efficace.
In fine, le rapport observe que les Marocains – tout en demeurant largement acquis au pluralisme parlementaire – expriment un désir croissant de résultats concrets, quitte à relativiser l’importance de la participation politique. Ce paradoxe reflète les défis auxquels les démocraties émergentes de la région devront faire face : préserver les acquis du pluralisme tout en répondant aux aspirations pressantes de dignité, de sécurité économique et de gouvernance efficace.