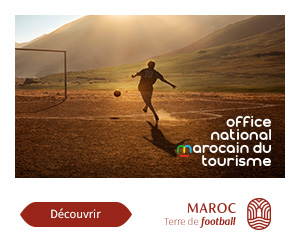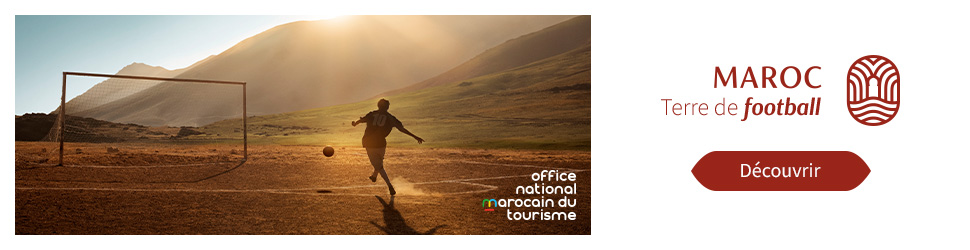- En cette période de candidatures aux doctorats, quels sont vos conseils pour aider les candidats à formuler un projet de recherche convaincant ? Et comment peuvent-ils se préparer efficacement à l’entretien oral ?
Pour rédiger un projet de recherche solide, il est essentiel que le candidat commence par montrer qu’il a bien compris l’intention du professeur qui propose le sujet. Le projet doit ensuite mettre en évidence une contribution scientifique claire : quels « gaps » souhaitez-vous combler ? Quelles nouvelles perspectives théoriques, méthodologiques ou empiriques entendez-vous apporter ? La règle d’or consiste à démontrer que la thèse ne sera pas un simple projet de fin d’études (PFE), mais un véritable travail de recherche susceptible de faire avancer les connaissances et de retenir l’attention de la communauté scientifique.
Dans la méthodologie et la revue de littérature, il est important de mettre en avant la manière dont le projet apporte une valeur ajoutée, que ce soit par la production de données originales, l’élaboration de modèles adaptés au contexte national, l’utilisation de techniques d’analyse innovantes ou combinées, ou encore l’exploration de phénomènes encore peu étudiés. Il convient également de souligner l’utilité pratique de la recherche : en quoi les résultats pourront-ils éclairer la décision publique ou contribuer à résoudre un problème concret dans le pays ? Enfin, il est essentiel de préciser comment la démarche choisie assure la faisabilité du projet, en s’appuyant sur des données et des méthodes accessibles.
Pour l’oral, au-delà de la maîtrise du sujet, il est important de préparer deux aspects essentiels. D’une part, il faut montrer que la problématique est originale et qu’elle apporte un véritable renouvellement par rapport aux recherches existantes. D’autre part, il est nécessaire de prouver que le projet est à la fois utile pour le pays et réalisable, en présentant un plan clair permettant d’obtenir des résultats rigoureux et exploitables. De nombreux projets de doctorat, pourtant ambitieux, sont refusés précisément parce qu’ils ne démontrent pas leur faisabilité, un critère pourtant fondamental.
- Plusieurs Universités marocaines proposent des doctorats en cotutelle ou en partenariat avec des institutions étrangères, quelles sont les destinations les plus accessibles ?
- La cotutelle de thèse permet à un doctorant d’être inscrit simultanément dans une Université marocaine et une Université étrangère, avec un enca- drement conjoint et une soutenance unique aboutissant généralement à une double délivrance de diplôme.
La France reste la destination la plus fréquente grâce à un cadre juridique précis (Campus France, conventions bilatérales) et à des financements dédiés, comme les bourses de mobilité doctorale du CNRST, les programmes PHC Toubkal et Hubert Curien, qui facilitent les séjours dans les laboratoires français. L’Espagne et la Belgique occupent également une place importante, notamment via Erasmus+, mais aussi à travers les programmes de coopération hispano-marocaine ou les financements de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF).
Le Canada attire à son tour de plus en plus de doctorants marocains, surtout au Québec, grâce à des ententes conclues avec des universités telles que Montréal, Laval, Sherbrooke ou encore les établissements du réseau UQ (Université du Québec), soutenues par des programmes fédéraux et provinciaux comme les Fonds de recherche du Québec (FRQ), les bourses Mitacs Globalink et les Vanier Canada Graduate Scholarships.
D’autres partenariats existent avec des universités américaines ou britanniques, appuyés par des fonds comme Fulbright (séjours de recherche aux États-Unis), le programme britannique Newton International Fellowships, et des appels spécifiques de la National Science Foundation (NSF). Des possibilités s’ouvrent aussi en Allemagne (bourses DAAD), en Italie (programmes Invest Your Talent), aux Pays-Bas (bourses Orange Knowledge Programme), ainsi qu’en Suisse (bourses d’excellence du gouvernement suisse).
Plusieurs universités marocaines offrent déjà des possibilités de cotutelle et de mobilité. À titre d’exemple, l’Université Ibn Tofaïl de Kénitra publie régulièrement des appels à « mobilité doctorale » destinés aux étudiants inscrits en cotutelle, notamment avec des établissements français partenaires, dans le cadre du financement CNRST.
Elle entretient aussi des accords actifs avec des universités relevant de l’Espagne, de la Belgique, de l’Italie, du Canada, des États-Unis, mais également avec des partenaires en Asie, notamment l’Université nationale Jeonbuk en Corée du Sud, des institutions japonaises, des établissements turcs, ainsi qu’avec des pays d’Europe de l’Est (Pologne, Roumanie) et d’Amérique latine (Mexique, Brésil).
L’Université Hassan II de Casablanca propose des conventions de cotutelle avec la France, le Canada et l’Italie, tandis que l’Université Cadi Ayyad de Marrakech met à disposition un modèle officiel de convention qui facilite les thèses conjointes avec, entre autres, l’Université de Caen Normandie et plusieurs institutions nord-américaines.
De son côté, l’Université Abdelmalek Essaâdi a conclu des accords de cotutelle avec l’Université de Grenade en Espagne, renforcés par des financements Erasmus+ et des bourses andalouses. Pour en bénéficier, les futurs doctorants doivent se renseigner très tôt, idéalement avant ou juste après l’inscription en première année de doctorat. Certaines universités étrangères refusent, en effet, les demandes au-delà de la deuxième année ou exigent qu’un accord de cotutelle soit signé dès le début du cursus.
Au Maroc, la première étape consiste à se présenter au Centre d’études doctorales de l’université ou à contacter le vice-président chargé de la recherche scientifique, qui orientera sur les conventions disponibles et les financements.
Outre les dispositifs déjà cités, d’autres programmes de mobilité ciblent ponctuellement les doctorants marocains : les bourses Chevening (Royaume-Uni), les bourses Marie Skłodowska-Curie (Union européenne), ou encore les appels de la Banque islamique de développement (BID) et de l’Organisation de la coopération islamique (OCI). Cette anticipation est décisive pour respecter les délais administratifs, monter un dossier solide et maximiser les chances de bénéficier des aides financières prévues pour ce type de partenariat.
- D’après votre expérience, quels sont les principaux défis auxquels sont confrontés les doctorants au Maroc ?
Les doctorants au Maroc font face à des défis qui vont au-delà de la maîtrise disciplinaire. L’un des plus importants est la langue, contrairement aux anglophones, ils doivent fournir un effort considérable pour maîtriser l’anglais scientifique, indispensable pour accéder à la littérature, publier et participer aux conférences.
Un autre défi majeur pour les doctorants est la maîtrise des outils techniques et technologiques spécifiques à leur domaine. L’utilisation de technologies avancées, comme l’intelligence artificielle ou les logiciels spécialisés, est devenue incontournable pour analyser les données et produire des résultats pertinents. En agronomie, par exemple, il faut savoir utiliser les technologies du secteur ; en finance, maîtriser les modèles économétriques récents et les logiciels de statistiques avancées intégrant parfois l’IA.
L’accès aux données constitue également une difficulté majeure. Les doctorants rencontrent souvent des obstacles pour obtenir un accès aux informations auprès des entreprises, institutions ou organismes publics qui opèrent dans le secteur étudié. Ces défis constituent des axes concrets que les autorités compétentes doivent prendre en considération pour développer la recherche scientifique au Maroc. Il s’agit, notamment, de financer des programmes d’apprentissage de l’anglais appliqués aux domaines de recherche, ainsi que des outils avancés pour chercheurs, de faciliter les partenariats entre laboratoires et entreprises afin de créer des projets répondant aux problèmes réels du marché. Il est question aussi d’assurer un soutien logistique et financier aux doctorants, et de favoriser l’accès à des réseaux scientifiques nationaux et internationaux.
- En dehors de la carrière universitaire, quelles sont les autres voies possibles pour un docteur au Maroc ?
Un doctorat ne se limite pas à une carrière universitaire. Les compétences spécialisées acquises ouvrent de nombreuses portes dans divers secteurs au Maroc et à l’international. Les départements de Recherche et Développement (R&D) des grandes entreprises industrielles, technologiques, pharmaceutiques ou agricoles recrutent des docteurs pour innover et transformer des idées en produits concrets. Les cabinets de conseil, les institutions publiques et internationales sont aussi des employeurs majeurs, notamment pour des missions de conseil stratégique, d’évaluation de politiques ou d’analyse économique.
Par ailleurs, les laboratoires de recherche nationaux et internationaux offrent des postes en recherche appliquée ou fondamentale, souvent financés par appels à projets, favorisant le développement d’un réseau scientifique solide. Enfin, un doctorat peut également mener à l’entrepreneuriat, au consulting indépendant ou à la formation spécialisée.
- Quels conseils pour les futurs doctorants ?
- Un point essentiel pour les futurs doctorants est de s’assurer que leurs travaux respectent trois conditions clés, à savoir : l’originalité, l’utilité et la faisabilité. L’originalité garantit une contribution nouvelle à la science, l’utilité répond à des besoins concrets, et la faisabilité assure que le projet peut être mené à bien. En suivant ces critères, les doctorants optimisent leurs chances de succès.
Pour rédiger un projet de recherche solide, il est essentiel que le candidat commence par montrer qu’il a bien compris l’intention du professeur qui propose le sujet. Le projet doit ensuite mettre en évidence une contribution scientifique claire : quels « gaps » souhaitez-vous combler ? Quelles nouvelles perspectives théoriques, méthodologiques ou empiriques entendez-vous apporter ? La règle d’or consiste à démontrer que la thèse ne sera pas un simple projet de fin d’études (PFE), mais un véritable travail de recherche susceptible de faire avancer les connaissances et de retenir l’attention de la communauté scientifique.
Dans la méthodologie et la revue de littérature, il est important de mettre en avant la manière dont le projet apporte une valeur ajoutée, que ce soit par la production de données originales, l’élaboration de modèles adaptés au contexte national, l’utilisation de techniques d’analyse innovantes ou combinées, ou encore l’exploration de phénomènes encore peu étudiés. Il convient également de souligner l’utilité pratique de la recherche : en quoi les résultats pourront-ils éclairer la décision publique ou contribuer à résoudre un problème concret dans le pays ? Enfin, il est essentiel de préciser comment la démarche choisie assure la faisabilité du projet, en s’appuyant sur des données et des méthodes accessibles.
Pour l’oral, au-delà de la maîtrise du sujet, il est important de préparer deux aspects essentiels. D’une part, il faut montrer que la problématique est originale et qu’elle apporte un véritable renouvellement par rapport aux recherches existantes. D’autre part, il est nécessaire de prouver que le projet est à la fois utile pour le pays et réalisable, en présentant un plan clair permettant d’obtenir des résultats rigoureux et exploitables. De nombreux projets de doctorat, pourtant ambitieux, sont refusés précisément parce qu’ils ne démontrent pas leur faisabilité, un critère pourtant fondamental.
- Plusieurs Universités marocaines proposent des doctorats en cotutelle ou en partenariat avec des institutions étrangères, quelles sont les destinations les plus accessibles ?
- La cotutelle de thèse permet à un doctorant d’être inscrit simultanément dans une Université marocaine et une Université étrangère, avec un enca- drement conjoint et une soutenance unique aboutissant généralement à une double délivrance de diplôme.
La France reste la destination la plus fréquente grâce à un cadre juridique précis (Campus France, conventions bilatérales) et à des financements dédiés, comme les bourses de mobilité doctorale du CNRST, les programmes PHC Toubkal et Hubert Curien, qui facilitent les séjours dans les laboratoires français. L’Espagne et la Belgique occupent également une place importante, notamment via Erasmus+, mais aussi à travers les programmes de coopération hispano-marocaine ou les financements de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF).
Le Canada attire à son tour de plus en plus de doctorants marocains, surtout au Québec, grâce à des ententes conclues avec des universités telles que Montréal, Laval, Sherbrooke ou encore les établissements du réseau UQ (Université du Québec), soutenues par des programmes fédéraux et provinciaux comme les Fonds de recherche du Québec (FRQ), les bourses Mitacs Globalink et les Vanier Canada Graduate Scholarships.
D’autres partenariats existent avec des universités américaines ou britanniques, appuyés par des fonds comme Fulbright (séjours de recherche aux États-Unis), le programme britannique Newton International Fellowships, et des appels spécifiques de la National Science Foundation (NSF). Des possibilités s’ouvrent aussi en Allemagne (bourses DAAD), en Italie (programmes Invest Your Talent), aux Pays-Bas (bourses Orange Knowledge Programme), ainsi qu’en Suisse (bourses d’excellence du gouvernement suisse).
Plusieurs universités marocaines offrent déjà des possibilités de cotutelle et de mobilité. À titre d’exemple, l’Université Ibn Tofaïl de Kénitra publie régulièrement des appels à « mobilité doctorale » destinés aux étudiants inscrits en cotutelle, notamment avec des établissements français partenaires, dans le cadre du financement CNRST.
Elle entretient aussi des accords actifs avec des universités relevant de l’Espagne, de la Belgique, de l’Italie, du Canada, des États-Unis, mais également avec des partenaires en Asie, notamment l’Université nationale Jeonbuk en Corée du Sud, des institutions japonaises, des établissements turcs, ainsi qu’avec des pays d’Europe de l’Est (Pologne, Roumanie) et d’Amérique latine (Mexique, Brésil).
L’Université Hassan II de Casablanca propose des conventions de cotutelle avec la France, le Canada et l’Italie, tandis que l’Université Cadi Ayyad de Marrakech met à disposition un modèle officiel de convention qui facilite les thèses conjointes avec, entre autres, l’Université de Caen Normandie et plusieurs institutions nord-américaines.
De son côté, l’Université Abdelmalek Essaâdi a conclu des accords de cotutelle avec l’Université de Grenade en Espagne, renforcés par des financements Erasmus+ et des bourses andalouses. Pour en bénéficier, les futurs doctorants doivent se renseigner très tôt, idéalement avant ou juste après l’inscription en première année de doctorat. Certaines universités étrangères refusent, en effet, les demandes au-delà de la deuxième année ou exigent qu’un accord de cotutelle soit signé dès le début du cursus.
Au Maroc, la première étape consiste à se présenter au Centre d’études doctorales de l’université ou à contacter le vice-président chargé de la recherche scientifique, qui orientera sur les conventions disponibles et les financements.
Outre les dispositifs déjà cités, d’autres programmes de mobilité ciblent ponctuellement les doctorants marocains : les bourses Chevening (Royaume-Uni), les bourses Marie Skłodowska-Curie (Union européenne), ou encore les appels de la Banque islamique de développement (BID) et de l’Organisation de la coopération islamique (OCI). Cette anticipation est décisive pour respecter les délais administratifs, monter un dossier solide et maximiser les chances de bénéficier des aides financières prévues pour ce type de partenariat.
- D’après votre expérience, quels sont les principaux défis auxquels sont confrontés les doctorants au Maroc ?
Les doctorants au Maroc font face à des défis qui vont au-delà de la maîtrise disciplinaire. L’un des plus importants est la langue, contrairement aux anglophones, ils doivent fournir un effort considérable pour maîtriser l’anglais scientifique, indispensable pour accéder à la littérature, publier et participer aux conférences.
Un autre défi majeur pour les doctorants est la maîtrise des outils techniques et technologiques spécifiques à leur domaine. L’utilisation de technologies avancées, comme l’intelligence artificielle ou les logiciels spécialisés, est devenue incontournable pour analyser les données et produire des résultats pertinents. En agronomie, par exemple, il faut savoir utiliser les technologies du secteur ; en finance, maîtriser les modèles économétriques récents et les logiciels de statistiques avancées intégrant parfois l’IA.
L’accès aux données constitue également une difficulté majeure. Les doctorants rencontrent souvent des obstacles pour obtenir un accès aux informations auprès des entreprises, institutions ou organismes publics qui opèrent dans le secteur étudié. Ces défis constituent des axes concrets que les autorités compétentes doivent prendre en considération pour développer la recherche scientifique au Maroc. Il s’agit, notamment, de financer des programmes d’apprentissage de l’anglais appliqués aux domaines de recherche, ainsi que des outils avancés pour chercheurs, de faciliter les partenariats entre laboratoires et entreprises afin de créer des projets répondant aux problèmes réels du marché. Il est question aussi d’assurer un soutien logistique et financier aux doctorants, et de favoriser l’accès à des réseaux scientifiques nationaux et internationaux.
- En dehors de la carrière universitaire, quelles sont les autres voies possibles pour un docteur au Maroc ?
Un doctorat ne se limite pas à une carrière universitaire. Les compétences spécialisées acquises ouvrent de nombreuses portes dans divers secteurs au Maroc et à l’international. Les départements de Recherche et Développement (R&D) des grandes entreprises industrielles, technologiques, pharmaceutiques ou agricoles recrutent des docteurs pour innover et transformer des idées en produits concrets. Les cabinets de conseil, les institutions publiques et internationales sont aussi des employeurs majeurs, notamment pour des missions de conseil stratégique, d’évaluation de politiques ou d’analyse économique.
Par ailleurs, les laboratoires de recherche nationaux et internationaux offrent des postes en recherche appliquée ou fondamentale, souvent financés par appels à projets, favorisant le développement d’un réseau scientifique solide. Enfin, un doctorat peut également mener à l’entrepreneuriat, au consulting indépendant ou à la formation spécialisée.
- Quels conseils pour les futurs doctorants ?
- Un point essentiel pour les futurs doctorants est de s’assurer que leurs travaux respectent trois conditions clés, à savoir : l’originalité, l’utilité et la faisabilité. L’originalité garantit une contribution nouvelle à la science, l’utilité répond à des besoins concrets, et la faisabilité assure que le projet peut être mené à bien. En suivant ces critères, les doctorants optimisent leurs chances de succès.