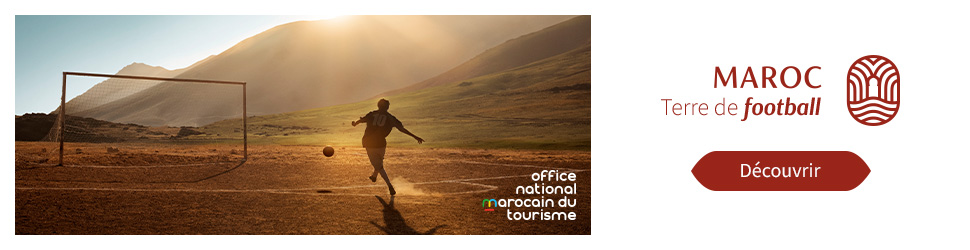Alors que les services de réanimation des divers hôpitaux du Royaume fonctionnent à plein régime, se pose avec acuité la question des infections nosocomiales. Cette appellation barbare désigne les infections associées aux soins qui ont été contractées au cours d’un séjour dans un établissement de santé et qui étaient absentes au moment de l’admission du patient. Dans une interview réalisée récemment par Febrayer.tv, le président de L’Association Marocaine des Droits Humains (AMDH), qui a évoqué plusieurs problématiques liées au système de Santé du Royaume, a souligné que l’implication d’individus « qui ne sont pas des infirmiers » dans les soins prodigués dans les réanimations de Marrakech, ce qui, selon lui, aurait provoqué des morts à cause de maladies nosocomiales. Le problème lié à ce type d’infections est, d’après la même source, présent dans d’autres établissements hospitaliers du Royaume.
Un cas sur vingt
Pourtant, le ministère de la Santé affirmait en 2019 que le taux de prévalence des maladies nosocomiales au Maroc était de 5,4%. Face au seuil de 10% en moyenne fixé par l’OMS pour les pays à revenu faible à intermédiaire et celui de 7% pour les pays à revenu élevé, le résultat affiché par le ministère de la Santé au Maroc semble dans les normes. La France avait d’ailleurs affiché en 2017 un taux à peine plus bas : 5,2%, selon l’enquête nationale réalisée à l’époque dans l’Hexagone. «En comparaison avec les pays européens, le Maroc a habituellement des taux qui ne sont pas très différents en matière de proportion d’infections nosocomiales », confirme Dr Zakaria Ouassou, réanimateur et membre du comité de lutte contre les infections nosocomiales de l’hôpital d’Azrou. « Il est cependant difficile d’évaluer ce genre de risque en période de pandémie en l’absence d’un véritable registre des maladies », précise le praticien.
Entre quantité et qualité
« Après une période de confinement où il y a eu une baisse de fréquentation des hôpitaux, on voit arriver actuellement les malades Covid et aussi les patients qui ne se sont pas fait soigner durant la période de confinement », contextualise le réanimateur qui admet toutefois qu’il n’est pas exclu qu’une grosse charge de travail puisse, dans certains cas, pousser les soignants à des gestes moins prudents. Quand ils ne sont pas écrasés par la charge de travail, les praticiens sont cependant plus précautionneux que jamais : « Je pense que, paradoxalement, la pandémie a eu un effet positif sur les précautions d’usage contre les maladies nosocomiales dans le sens où elle a imposé aux soignants (pour leur propre sécurité) d’être plus prudents et d’être encore plus pointilleux sur l’hygiène », confie le praticien. Il est d’ailleurs vrai que les précautions d’usage pour lutter contre les maladies nosocomiales dans les milieux hospitaliers ressemblent à s’y méprendre aux mesures de prévention de la Covid 19.
Au four et au moulin
Les équipes soignantes des réanimations du Royaume font manifestement face à une charge de travail qui peut parfois devenir suffocante, mais où la discipline en termes d’hygiène, au-delà d’une simple lutte contre les infections nosocomiales, prend des allures de code de survie. « À l’instar des autres centres hospitaliers, nous avons généralisé l’utilisation et renforcé la disponibilité des gels hydroalcooliques. Nous avons également renforcé toutes les bonnes pratiques de vigilance. Dans les services de réanimation du monde entier, il est actuellement avéré que la mesure qui a le plus marché contre les maladies nosocomiales est la désinfection de mains. En rendant cette pratique systématique, nous limitons les risques de propagation de la Covid, mais aussi des infections nosocomiales », souligne le réanimateur.
La lutte contre les infections nosocomiales au Maroc reste cependant perfectible, selon le Dr Jamal Bakhat, président de la Société des Médecins d’Hygiène et de Salubrité Publique. « Dans l’idéal, chaque hôpital devait avoir une structure dédiée où un technicien et un médecin d’hygiène auraient comme mission d’organiser le suivi et la lutte contre les infections nosocomiales en organisant les désinfections et les décontaminations, en réalisant des prélèvements réguliers pour vérifier qu’il n’y a pas de germes résistants et aussi en assurant la formation continue du personnel », résume-t-il.
Un cas sur vingt
Pourtant, le ministère de la Santé affirmait en 2019 que le taux de prévalence des maladies nosocomiales au Maroc était de 5,4%. Face au seuil de 10% en moyenne fixé par l’OMS pour les pays à revenu faible à intermédiaire et celui de 7% pour les pays à revenu élevé, le résultat affiché par le ministère de la Santé au Maroc semble dans les normes. La France avait d’ailleurs affiché en 2017 un taux à peine plus bas : 5,2%, selon l’enquête nationale réalisée à l’époque dans l’Hexagone. «En comparaison avec les pays européens, le Maroc a habituellement des taux qui ne sont pas très différents en matière de proportion d’infections nosocomiales », confirme Dr Zakaria Ouassou, réanimateur et membre du comité de lutte contre les infections nosocomiales de l’hôpital d’Azrou. « Il est cependant difficile d’évaluer ce genre de risque en période de pandémie en l’absence d’un véritable registre des maladies », précise le praticien.
Entre quantité et qualité
« Après une période de confinement où il y a eu une baisse de fréquentation des hôpitaux, on voit arriver actuellement les malades Covid et aussi les patients qui ne se sont pas fait soigner durant la période de confinement », contextualise le réanimateur qui admet toutefois qu’il n’est pas exclu qu’une grosse charge de travail puisse, dans certains cas, pousser les soignants à des gestes moins prudents. Quand ils ne sont pas écrasés par la charge de travail, les praticiens sont cependant plus précautionneux que jamais : « Je pense que, paradoxalement, la pandémie a eu un effet positif sur les précautions d’usage contre les maladies nosocomiales dans le sens où elle a imposé aux soignants (pour leur propre sécurité) d’être plus prudents et d’être encore plus pointilleux sur l’hygiène », confie le praticien. Il est d’ailleurs vrai que les précautions d’usage pour lutter contre les maladies nosocomiales dans les milieux hospitaliers ressemblent à s’y méprendre aux mesures de prévention de la Covid 19.
Au four et au moulin
Les équipes soignantes des réanimations du Royaume font manifestement face à une charge de travail qui peut parfois devenir suffocante, mais où la discipline en termes d’hygiène, au-delà d’une simple lutte contre les infections nosocomiales, prend des allures de code de survie. « À l’instar des autres centres hospitaliers, nous avons généralisé l’utilisation et renforcé la disponibilité des gels hydroalcooliques. Nous avons également renforcé toutes les bonnes pratiques de vigilance. Dans les services de réanimation du monde entier, il est actuellement avéré que la mesure qui a le plus marché contre les maladies nosocomiales est la désinfection de mains. En rendant cette pratique systématique, nous limitons les risques de propagation de la Covid, mais aussi des infections nosocomiales », souligne le réanimateur.
La lutte contre les infections nosocomiales au Maroc reste cependant perfectible, selon le Dr Jamal Bakhat, président de la Société des Médecins d’Hygiène et de Salubrité Publique. « Dans l’idéal, chaque hôpital devait avoir une structure dédiée où un technicien et un médecin d’hygiène auraient comme mission d’organiser le suivi et la lutte contre les infections nosocomiales en organisant les désinfections et les décontaminations, en réalisant des prélèvements réguliers pour vérifier qu’il n’y a pas de germes résistants et aussi en assurant la formation continue du personnel », résume-t-il.
Oussama ABAOUSS
Encadré
Microbiologie
Les germes résistants aux antibiotiques : un vrai problème de santé publique
Les infections nosocomiales sont le plus souvent causées par des germes qui ont un niveau de résistance aux antibiotiques les plus communs. L’utilisation intensive des antibiotiques à large spectre a favorisé l’émergence d’un certain nombre de ces germes (voir infographie).
Contrairement à d’autres pays qui ont commencé plus tôt à utiliser les antibiotiques à large spectre, le Maroc n’a pas encore vu émerger des cas d’infections nosocomiales causées par les pires bactéries résistantes (les staphylocoques entre autres). « Dans les services de réanimation lourde, les antibiotiques à large spectre sont de plus en plus utilisés. Automatiquement, la résistance des germes aux antibiotiques est plus puissante. Ce phénomène commence d’ailleurs à apparaître même ici au Maroc », explique Pr Mohamed Khatouf, chef du service de réanimation du CHU de Fès.
Si l’utilisation des antibiotiques à large spectre est incontournable dans les services de réanimation qui admettent des pathologies qui ne peuvent être traitées autrement, il existe cependant un autre facteur qui peut être évité. « L’utilisation des antibiotiques à large spectre prescrits par des médecins pour un usage courant risque de contribuer également à l’émergence d’un certain nombre de germes résistants », explique le praticien. « Heureusement, nous n’avons pas enregistré d’épidémie engendrée par un germe de ce genre. Le cas échéant, ce serait une réelle catastrophe pour un service de réanimation de se trouver dans pareille situation », conclut Pr Khatouf.
Les germes résistants aux antibiotiques : un vrai problème de santé publique
Les infections nosocomiales sont le plus souvent causées par des germes qui ont un niveau de résistance aux antibiotiques les plus communs. L’utilisation intensive des antibiotiques à large spectre a favorisé l’émergence d’un certain nombre de ces germes (voir infographie).
Contrairement à d’autres pays qui ont commencé plus tôt à utiliser les antibiotiques à large spectre, le Maroc n’a pas encore vu émerger des cas d’infections nosocomiales causées par les pires bactéries résistantes (les staphylocoques entre autres). « Dans les services de réanimation lourde, les antibiotiques à large spectre sont de plus en plus utilisés. Automatiquement, la résistance des germes aux antibiotiques est plus puissante. Ce phénomène commence d’ailleurs à apparaître même ici au Maroc », explique Pr Mohamed Khatouf, chef du service de réanimation du CHU de Fès.
Si l’utilisation des antibiotiques à large spectre est incontournable dans les services de réanimation qui admettent des pathologies qui ne peuvent être traitées autrement, il existe cependant un autre facteur qui peut être évité. « L’utilisation des antibiotiques à large spectre prescrits par des médecins pour un usage courant risque de contribuer également à l’émergence d’un certain nombre de germes résistants », explique le praticien. « Heureusement, nous n’avons pas enregistré d’épidémie engendrée par un germe de ce genre. Le cas échéant, ce serait une réelle catastrophe pour un service de réanimation de se trouver dans pareille situation », conclut Pr Khatouf.
3 questions au Pr Mohamed Khatouf, anesthésiste-réanimateur
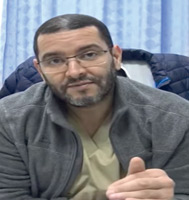
Pr Mohamed Khatouf
« Le taux d’infections nosocomiales augmente avec la durée du séjour dans le service»
Pr Mohamed Khatouf, chef du service de réanimation du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Fès, a répondu à nos questions à propos des infections nosocomiales au Maroc.
- Quelles sont les infections nosocomiales les plus fréquentes dans les services de réanimation ?
- Les infections nosocomiales sont le plus souvent causées par des dispositifs thérapeutiques qui, parfois, exposent les patients à des germes résistants. Il s’agit le plus souvent d’infections respiratoires liées à la ventilation, d’infections urinaires liées aux sondes vésicales, ou encore d’infections du cathéter de voie centrale ou d’autres abords veineux. Le taux d’infections nosocomiales augmente avec la durée du séjour dans le service.
- Quelles sont les mesures prises par les équipes soignantes afin de lutter contre ce genre d’infections ?
- Il y a énormément de mesures qui sont prises, notamment le lavage obligatoire des mains et le changement des gants stériles à chaque fois que le soignant change de malade, les gestes médicaux qui sont faits de façon aseptique ou encore le nettoyage régulier de l’entourage du patient.
- Les personnes qui travaillent dans les réanimations sont-elles toutes qualifiées pour prendre les bonnes mesures ?
- Les équipes des services de réanimation sont composées de plusieurs profils, et ce, partout dans le monde. Il y a des médecins anesthésistes réanimateurs, des infirmiers diplômés d’Etat, mais également des aides-soignants qui participent aux soins, au nursing et qui font un travail extraordinaire. Il y a également les femmes de ménage et les brancardiers. Il s’agit avant tout d’un travail d’équipe où personne ne peut être considéré comme responsable de transmission d’infection nosocomiale, car chacun est qualifié et veille à respecter les bonnes pratiques.
Pr Mohamed Khatouf, chef du service de réanimation du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Fès, a répondu à nos questions à propos des infections nosocomiales au Maroc.
- Quelles sont les infections nosocomiales les plus fréquentes dans les services de réanimation ?
- Les infections nosocomiales sont le plus souvent causées par des dispositifs thérapeutiques qui, parfois, exposent les patients à des germes résistants. Il s’agit le plus souvent d’infections respiratoires liées à la ventilation, d’infections urinaires liées aux sondes vésicales, ou encore d’infections du cathéter de voie centrale ou d’autres abords veineux. Le taux d’infections nosocomiales augmente avec la durée du séjour dans le service.
- Quelles sont les mesures prises par les équipes soignantes afin de lutter contre ce genre d’infections ?
- Il y a énormément de mesures qui sont prises, notamment le lavage obligatoire des mains et le changement des gants stériles à chaque fois que le soignant change de malade, les gestes médicaux qui sont faits de façon aseptique ou encore le nettoyage régulier de l’entourage du patient.
- Les personnes qui travaillent dans les réanimations sont-elles toutes qualifiées pour prendre les bonnes mesures ?
- Les équipes des services de réanimation sont composées de plusieurs profils, et ce, partout dans le monde. Il y a des médecins anesthésistes réanimateurs, des infirmiers diplômés d’Etat, mais également des aides-soignants qui participent aux soins, au nursing et qui font un travail extraordinaire. Il y a également les femmes de ménage et les brancardiers. Il s’agit avant tout d’un travail d’équipe où personne ne peut être considéré comme responsable de transmission d’infection nosocomiale, car chacun est qualifié et veille à respecter les bonnes pratiques.
Recueillis par O. A.
Repères
Deux modes de transmission
Les infections nosocomiales peuvent se transmettre à travers des agents infectieux qui proviennent du patient lui-même, et qui sont présents sur la peau ou dans les muqueuses. La contamination a lieu lors de l’ouverture de la peau (lors de l’introduction d’un cathéter par exemple). Les infections nosocomiales peuvent également se transmettre à travers des agents infectieux qui proviennent de l’environnement du patient. L’infection provient alors d’un autre malade, du personnel soignant ou encore d’un élément contaminé.
Les germes les plus fréquents
Selon une étude française publiée en 2018, les infections nosocomiales sont le plus souvent causées par des bactéries de type Escherichia coli (23,6 % des germes isolés) qui vit naturellement dans les intestins où elle ne provoque généralement aucun symptôme, Staphylococcus aureus (13,8 %) qui est présent dans la muqueuse du nez, de la gorge et sur le périnée d’environ 15 à 30 % des êtres humains, Enterococcus faecalis (6,5 %) et Pseudomonas aeruginosa (6,3 %) qui est fréquente dans l’environnement, en particulier à l’hôpital.