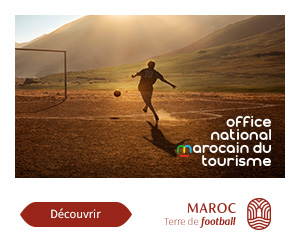Dans l’espace public contemporain, la pensée n’est plus ce qui anime les débats. Ce sont les opinions qui règnent, et la nuance entre pensée et opinion s’efface, souvent au profit de la plus bruyante, de la plus réactive. On pourrait même dire que les avalanches d’opinions, immédiates, impulsives, jetées au milieu du vacarme numérique, ne laissent aucune chance à la pensée de s’installer, de se construire, de circuler et d’évoluer pour tendre vers un horizon commun, celui du bien commun ou de l’intérêt général.
Il suffit d’observer les commentaires qui s’enchaînent sur les réseaux sociaux pour comprendre à quel point cette confusion est devenue la norme. Beaucoup confondent opinion et pensée, comme si elles relevaient de la même démarche, du même niveau d’exigence ou de la même profondeur. C’est précisément l’inverse.
Une opinion, c’est une idée toute faite, une position spontanée, qui ne ressent pas le besoin de se nourrir d’arguments solides ni de se confronter au réel. Elle s’énonce sans précautions, sans doute, sans références, souvent c'est l'émotion qui est son moteur. Elle existe surtout parce qu’elle rassure celui qui l’exprime, elle confirme ce qu’il croit déjà.
Une pensée, au contraire, est le fruit d’une démarche. Elle exige du temps, de la nuance, de l’histoire, des faits, des dates et tout ce qui permet de mettre une idée à l’épreuve. La pensée accepte l’incertitude comme condition de possibilité. Elle ne cherche pas à s’enfermer dans une certitude confortable, mais à explorer le monde en évitant les raccourcis. Elle n'a que faire des bons sentiments. Elle se construit, s’ajuste, se transforme, parfois même se contredit, car elle reconnaît la complexité du réel.
Aujourd’hui, l’idéologie triomphe précisément parce qu’elle propose des opinions instantanées plutôt que des pensées construites. Elle offre un cadre simple, souvent binaire, où chacun peut trouver sa place sans effort intellectuel. Mais ce triomphe a un coût : celui de la liberté intérieure, celle qui permet de penser par soi-même. Or, sans cette liberté, la discussion publique se réduit à une suite d’affrontements stériles, incapables de produire du sens, encore moins du commun.
Retrouver la pensée, c’est donc renouer avec l’exigence : accepter la lenteur, la complexité, le doute, la contradiction. C’est refuser que chaque sujet devienne un drapeau idéologique. C’est remettre au cœur du débat non pas l’emportement, mais la recherche partagée d’une vérité toujours imparfaite, toujours en mouvement.
C’est peut-être cela, aujourd’hui, le véritable acte de résistance.
Pour bien illustrer cette réflexion par un exemple concret, il serait tentant de choisir l’un des sujets brûlants évoqués plus haut. Mais ce serait justement retomber dans l’écueil dénoncé, celui où le simple fait de nommer un thème contemporain suffit à déclencher un déferlement d’opinions instantanées, au détriment de toute pensée véritable. Pour éviter cela, mieux vaut remonter dans le temps et choisir une période où la pensée a pu, précisément, se déployer avec une intensité remarquable malgré les embûches.
Arrêtons-nous donc au XVIIᵉ siècle, moment charnière associé à l’héritage de la Renaissance européenne et à l’essor de l’âge classique. Si cette époque a profondément marqué l’histoire intellectuelle de l’Europe, c’est qu’elle fut une célébration de la pensée. Jamais les philosophes n’avaient été aussi écoutés. Jamais la raison n’avait occupé une place aussi centrale dans les débats. Le rationalisme naît alors non seulement comme méthode, mais comme véritable éthique. Penser devient un engagement envers la vérité, et non envers un camp.
Après Descartes, figure fondatrice du rationalisme, un autre penseur va pousser plus loin encore l’exigence de liberté intellectuelle. Baruch Spinoza. Philosophe hollandais d’origine juive portugaise, il incarne à lui seul ce que signifie penser envers et contre tout. Sa pensée demeure aujourd’hui fascinante non seulement pour sa profondeur conceptuelle, mais pour la liberté inouïe dont elle témoigne. Spinoza ose penser Dieu autrement, non comme une entité extérieure au monde, mais comme la substance même de toute réalité. Une position radicale, audacieuse, qui refuse toute soumission aux orthodoxies.
Cette liberté, Spinoza la paiera cher. Excommunié de sa communauté, menacé de mort, il quitte Amsterdam pour se réfugier à Rijnsburg. C’est là qu’il poursuivra, en solitaire, son travail philosophique. Et c’est là aussi qu’il gagnera sa vie en exerçant un métier humble, mais essentiel pour la science naissante, polisseur de lentilles et de verres optiques. Il était réputé pour l’excellence exceptionnelle de son travail, au point que des savants de toute l’Europe utilisaient ses lentilles pour construire microscopes et télescopes.
Ce métier n’était pas seulement une source de revenus. Il était aussi, pour Spinoza, une discipline intérieure. Le geste lent, patient, méticuleux du polissage, reprendre, ajuster, affiner, recommencer, nourrissait sa pensée. Comme si cet exercice manuel, exigeant et rigoureux, devenait la métaphore concrète de son travail intellectuel. Polir une lentille, c’est permettre au regard de voir plus loin et plus juste; polir une idée, c’est permettre à la pensée de devenir plus claire, plus précise, plus fidèle au réel. Chez Spinoza, ces deux gestes se rejoignent, se renforcent, la main qui polit éclaire l’esprit, et l’esprit qui réfléchit guide la main.
C’est seulement après sa mort que paraîtra son œuvre majeure, L’Éthique, publiée en 1677. Ce livre unique, construit comme un traité de géométrie, deviendra l’un des monuments de la philosophie européenne. Tous les penseurs qui lui succéderont, Leibniz, Hegel, Nietzsche, Freud, Deleuze, entre autres, seront, d’une manière ou d’une autre, influencés par ce philosophe autodidacte qui n’a jamais laissé une idéologie obscurantiste barrer la route à la pensée.
Spinoza incarne ainsi un modèle rare, celui d’un esprit libre, qui refuse les certitudes faciles, qui travaille la pensée comme on polit une lentille, patiemment, rigoureusement, humblement. Un rappel précieux pour notre époque saturée d’opinions rapides, la liberté intellectuelle ne s’improvise pas, elle se construit. Elle demande un effort, une discipline, un courage que Spinoza, par sa vie comme par son œuvre, n’a cessé de montrer.
Dans ces temps troublés où l’idéologie triomphe trop facilement, je me permets de vous recommander vivement l’ouvrage de Frédéric Lenoir consacré à Spinoza, Le miracle Spinoza, une philosophie pour éclairer notre vie.
Une autre époque où la pensée a connu son heure de gloire. On retrouve un autre moment de ce souffle intellectuel au tournant du XXᵉ siècle, au Moyen-Orient, notamment en Égypte et au Liban. Là, une constellation d’écrivains, de penseurs, de philosophes et de poètes, Taha Hussein, Abbas Mahmoud al-Akkad, Mikhaïl Naïma, Gibran Khalil Gibran, Maarouf al-Rusafi, Mohamed Abduh, Jamal ad-Din al-Afghani et bien d’autres encore, ont incarné ce que signifie penser à contre-courant de son époque. Ce fut une véritable renaissance arabe, un mouvement de libres penseurs qui, souvent au prix de leur tranquillité et parfois de leur sécurité, ont osé bousculer l’ordre établi. Leur héritage, immense, irrigue encore aujourd’hui la pensée de générations entières.
Mais que reste-t-il aujourd’hui de cette liberté intellectuelle que l’on tenait jadis pour un phare, une respiration, une promesse ? Où se tapit encore la pensée vraiment libre, celle qui dérange, qui éclaire, qui fend l’obscurité pour y tracer des passages inédits ? L’espace public bruisse des mêmes voix, celles de Zemmour, de BHL ou de MBC, silhouettes médiatiques qui occupent toute la scène et relèguent dans la pénombre les esprits plus profonds, plus exigeants, plus dérangeants.
Pour rencontrer un véritable penseur indépendant, il faut s’aventurer dans les marges, les sous-sols, les arrière-salles où veillent encore quelques irréductibles, Au Québec, Alain Deneault, Norman Baillargeon, Serge Bouchard… En France, Edgar Morin, Manuel Tod, Jacques Derrida… En Amérique, Noam Chomsky, infatigable démolisseur de certitudes, dont la lucidité reste une boussole dans la tempête. Et dans le monde arabe, Au Maroc, le défient Mohamed Abed El Jaberi et de la syrie, résident en France, le toujours vivant Adonis, poète et libre penseur, l’incompris splendide, dressé seul face à l’immobilisme.
À 96 ans, sa parole libre, sa poésie insurgée, sa lucidité tranchante font de lui une montagne de sagesse et de rationalité. Certains régimes jugent Adonis trop dangereux pour franchir leurs frontières, signe, peut-être, qu’il dit ce qui doit être dit. Et pourtant, par sa critique implacable du sommeil arabe, il rend aux siens le service le plus précieux, celui de les réveiller. Plus qu'un prix Nobel de la littérature, il mérite la reconnaissance des siens que l'histoire lui accordera tôt ou tard au même titre qu'un Moutanabbi ou un Farabi ou un Najib Mahfoud.
Je me garderai de citer ici d’autres penseurs libres contemporains, non par oubli, mais pour ne pas attirer sur eux, ni sur moi, les foudres des idéologies dominantes.
Mohamed Lotfi
15 Novembre 2025
Il suffit d’observer les commentaires qui s’enchaînent sur les réseaux sociaux pour comprendre à quel point cette confusion est devenue la norme. Beaucoup confondent opinion et pensée, comme si elles relevaient de la même démarche, du même niveau d’exigence ou de la même profondeur. C’est précisément l’inverse.
Une opinion, c’est une idée toute faite, une position spontanée, qui ne ressent pas le besoin de se nourrir d’arguments solides ni de se confronter au réel. Elle s’énonce sans précautions, sans doute, sans références, souvent c'est l'émotion qui est son moteur. Elle existe surtout parce qu’elle rassure celui qui l’exprime, elle confirme ce qu’il croit déjà.
Une pensée, au contraire, est le fruit d’une démarche. Elle exige du temps, de la nuance, de l’histoire, des faits, des dates et tout ce qui permet de mettre une idée à l’épreuve. La pensée accepte l’incertitude comme condition de possibilité. Elle ne cherche pas à s’enfermer dans une certitude confortable, mais à explorer le monde en évitant les raccourcis. Elle n'a que faire des bons sentiments. Elle se construit, s’ajuste, se transforme, parfois même se contredit, car elle reconnaît la complexité du réel.
Aujourd’hui, l’idéologie triomphe précisément parce qu’elle propose des opinions instantanées plutôt que des pensées construites. Elle offre un cadre simple, souvent binaire, où chacun peut trouver sa place sans effort intellectuel. Mais ce triomphe a un coût : celui de la liberté intérieure, celle qui permet de penser par soi-même. Or, sans cette liberté, la discussion publique se réduit à une suite d’affrontements stériles, incapables de produire du sens, encore moins du commun.
Retrouver la pensée, c’est donc renouer avec l’exigence : accepter la lenteur, la complexité, le doute, la contradiction. C’est refuser que chaque sujet devienne un drapeau idéologique. C’est remettre au cœur du débat non pas l’emportement, mais la recherche partagée d’une vérité toujours imparfaite, toujours en mouvement.
C’est peut-être cela, aujourd’hui, le véritable acte de résistance.
Pour bien illustrer cette réflexion par un exemple concret, il serait tentant de choisir l’un des sujets brûlants évoqués plus haut. Mais ce serait justement retomber dans l’écueil dénoncé, celui où le simple fait de nommer un thème contemporain suffit à déclencher un déferlement d’opinions instantanées, au détriment de toute pensée véritable. Pour éviter cela, mieux vaut remonter dans le temps et choisir une période où la pensée a pu, précisément, se déployer avec une intensité remarquable malgré les embûches.
Arrêtons-nous donc au XVIIᵉ siècle, moment charnière associé à l’héritage de la Renaissance européenne et à l’essor de l’âge classique. Si cette époque a profondément marqué l’histoire intellectuelle de l’Europe, c’est qu’elle fut une célébration de la pensée. Jamais les philosophes n’avaient été aussi écoutés. Jamais la raison n’avait occupé une place aussi centrale dans les débats. Le rationalisme naît alors non seulement comme méthode, mais comme véritable éthique. Penser devient un engagement envers la vérité, et non envers un camp.
Après Descartes, figure fondatrice du rationalisme, un autre penseur va pousser plus loin encore l’exigence de liberté intellectuelle. Baruch Spinoza. Philosophe hollandais d’origine juive portugaise, il incarne à lui seul ce que signifie penser envers et contre tout. Sa pensée demeure aujourd’hui fascinante non seulement pour sa profondeur conceptuelle, mais pour la liberté inouïe dont elle témoigne. Spinoza ose penser Dieu autrement, non comme une entité extérieure au monde, mais comme la substance même de toute réalité. Une position radicale, audacieuse, qui refuse toute soumission aux orthodoxies.
Cette liberté, Spinoza la paiera cher. Excommunié de sa communauté, menacé de mort, il quitte Amsterdam pour se réfugier à Rijnsburg. C’est là qu’il poursuivra, en solitaire, son travail philosophique. Et c’est là aussi qu’il gagnera sa vie en exerçant un métier humble, mais essentiel pour la science naissante, polisseur de lentilles et de verres optiques. Il était réputé pour l’excellence exceptionnelle de son travail, au point que des savants de toute l’Europe utilisaient ses lentilles pour construire microscopes et télescopes.
Ce métier n’était pas seulement une source de revenus. Il était aussi, pour Spinoza, une discipline intérieure. Le geste lent, patient, méticuleux du polissage, reprendre, ajuster, affiner, recommencer, nourrissait sa pensée. Comme si cet exercice manuel, exigeant et rigoureux, devenait la métaphore concrète de son travail intellectuel. Polir une lentille, c’est permettre au regard de voir plus loin et plus juste; polir une idée, c’est permettre à la pensée de devenir plus claire, plus précise, plus fidèle au réel. Chez Spinoza, ces deux gestes se rejoignent, se renforcent, la main qui polit éclaire l’esprit, et l’esprit qui réfléchit guide la main.
C’est seulement après sa mort que paraîtra son œuvre majeure, L’Éthique, publiée en 1677. Ce livre unique, construit comme un traité de géométrie, deviendra l’un des monuments de la philosophie européenne. Tous les penseurs qui lui succéderont, Leibniz, Hegel, Nietzsche, Freud, Deleuze, entre autres, seront, d’une manière ou d’une autre, influencés par ce philosophe autodidacte qui n’a jamais laissé une idéologie obscurantiste barrer la route à la pensée.
Spinoza incarne ainsi un modèle rare, celui d’un esprit libre, qui refuse les certitudes faciles, qui travaille la pensée comme on polit une lentille, patiemment, rigoureusement, humblement. Un rappel précieux pour notre époque saturée d’opinions rapides, la liberté intellectuelle ne s’improvise pas, elle se construit. Elle demande un effort, une discipline, un courage que Spinoza, par sa vie comme par son œuvre, n’a cessé de montrer.
Dans ces temps troublés où l’idéologie triomphe trop facilement, je me permets de vous recommander vivement l’ouvrage de Frédéric Lenoir consacré à Spinoza, Le miracle Spinoza, une philosophie pour éclairer notre vie.
Une autre époque où la pensée a connu son heure de gloire. On retrouve un autre moment de ce souffle intellectuel au tournant du XXᵉ siècle, au Moyen-Orient, notamment en Égypte et au Liban. Là, une constellation d’écrivains, de penseurs, de philosophes et de poètes, Taha Hussein, Abbas Mahmoud al-Akkad, Mikhaïl Naïma, Gibran Khalil Gibran, Maarouf al-Rusafi, Mohamed Abduh, Jamal ad-Din al-Afghani et bien d’autres encore, ont incarné ce que signifie penser à contre-courant de son époque. Ce fut une véritable renaissance arabe, un mouvement de libres penseurs qui, souvent au prix de leur tranquillité et parfois de leur sécurité, ont osé bousculer l’ordre établi. Leur héritage, immense, irrigue encore aujourd’hui la pensée de générations entières.
Mais que reste-t-il aujourd’hui de cette liberté intellectuelle que l’on tenait jadis pour un phare, une respiration, une promesse ? Où se tapit encore la pensée vraiment libre, celle qui dérange, qui éclaire, qui fend l’obscurité pour y tracer des passages inédits ? L’espace public bruisse des mêmes voix, celles de Zemmour, de BHL ou de MBC, silhouettes médiatiques qui occupent toute la scène et relèguent dans la pénombre les esprits plus profonds, plus exigeants, plus dérangeants.
Pour rencontrer un véritable penseur indépendant, il faut s’aventurer dans les marges, les sous-sols, les arrière-salles où veillent encore quelques irréductibles, Au Québec, Alain Deneault, Norman Baillargeon, Serge Bouchard… En France, Edgar Morin, Manuel Tod, Jacques Derrida… En Amérique, Noam Chomsky, infatigable démolisseur de certitudes, dont la lucidité reste une boussole dans la tempête. Et dans le monde arabe, Au Maroc, le défient Mohamed Abed El Jaberi et de la syrie, résident en France, le toujours vivant Adonis, poète et libre penseur, l’incompris splendide, dressé seul face à l’immobilisme.
À 96 ans, sa parole libre, sa poésie insurgée, sa lucidité tranchante font de lui une montagne de sagesse et de rationalité. Certains régimes jugent Adonis trop dangereux pour franchir leurs frontières, signe, peut-être, qu’il dit ce qui doit être dit. Et pourtant, par sa critique implacable du sommeil arabe, il rend aux siens le service le plus précieux, celui de les réveiller. Plus qu'un prix Nobel de la littérature, il mérite la reconnaissance des siens que l'histoire lui accordera tôt ou tard au même titre qu'un Moutanabbi ou un Farabi ou un Najib Mahfoud.
Je me garderai de citer ici d’autres penseurs libres contemporains, non par oubli, mais pour ne pas attirer sur eux, ni sur moi, les foudres des idéologies dominantes.
Mohamed Lotfi
15 Novembre 2025