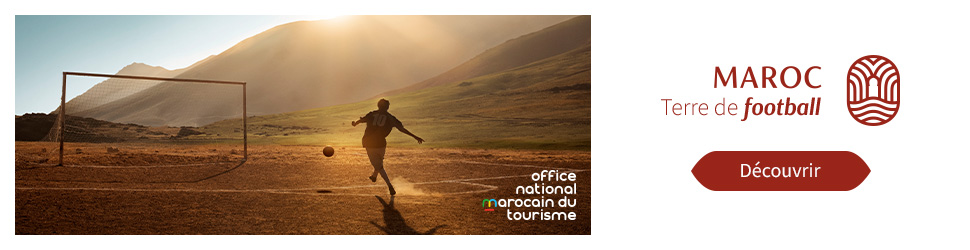Les relations franco-algériennes, figées depuis plus d’un an dans une impasse diplomatique sans précédent, semblent connaître leurs premiers frémissements de détente. Intervenant lundi 10 novembre, le directeur de la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), Nicolas Lerner, a déclaré percevoir «des signaux, publics et non publics, émanant de l’Algérie» laissant entrevoir «une possible reprise du dialogue» avec Paris.
Une déclaration mesurée, mais significative, qui traduit un changement de ton après une période marquée par la méfiance et les tensions. «Les canaux de communication n’ont jamais été totalement coupés, mais la coopération antiterroriste a atteint un point extrêmement bas», a reconnu le chef du Renseignement français, estimant qu’il n’est «dans l’intérêt d’aucun des deux pays de rester dans cette situation de blocage».
Le différend entre Paris et Alger remonte à l’été 2024, lorsque la France a publiquement réaffirmé son soutien au plan marocain d’autonomie pour le Sahara occidental, reconnu par les États-Unis depuis 2020 comme base sérieuse et crédible de règlement du conflit. Cette position a provoqué la fureur du régime algérien, qui a rappelé son ambassadeur à Paris et dénoncé ce qu’il a qualifié de «prise de position partiale».
La crise s’est ensuite envenimée après l’arrestation de deux ressortissants français en Algérie : l’écrivain Boualem Sansal, interpellé le 16 novembre 2024 et condamné à cinq ans de prison pour «atteinte à l’unité nationale», et le journaliste Christophe Gleizes, correspondant de SoFoot, condamné à sept ans de prison pour «apologie du terrorisme». Ce dernier, accusé d’avoir entretenu des contacts avec des militants du Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie (MAK), classé «organisation terroriste» par Alger, doit comparaître en appel le 3 décembre prochain.
Ces affaires ont plongé les relations bilatérales dans une crise de confiance profonde, marquée par la suspension de la coopération sécuritaire, la réduction des échanges économiques et le rappel des diplomates des deux côtés. Paris avait parlé d’une «rupture grave de confiance», tandis qu’Alger dénonçait une «campagne hostile» orchestrée par certains médias français.
Selon plusieurs sources diplomatiques, des signaux d’apaisement se multiplient depuis quelques semaines. Le président Abdelmadjid Tebboune envisagerait d’accorder une grâce présidentielle à Boualem Sansal, à la suite d’une demande du président fédéral allemande. Un geste interprété comme la première manifestation concrète d’une volonté d’ouverture.
Autre signe notable : pour la première fois depuis le déclenchement de la crise, les médias publics algériens ont évoqué Sansal sans recours à la rhétorique injurieuse habituelle, rompant ainsi avec des années de diabolisation de l’écrivain.
Parallèlement, plusieurs canaux officieux travaillent à la réactivation du dialogue entre les deux capitales. Du côté algérien, Chems-Eddine Mohamed Hafiz, recteur de la Grande mosquée de Paris, joue un rôle de médiation informelle en tant que relais de confiance du régime. Du côté français, l’archevêque d’Alger, Mgr Jean-Paul Vesco, a été reçu à plusieurs reprises par le président Tebboune, dans le cadre de discussions discrètes visant à rétablir un climat de confiance.
Enfin, la nomination de Laurent Nuñez au ministère de l’Intérieur français, en remplacement de figures plus hostiles à Alger, a contribué à calmer le jeu. Considéré comme un homme de dialogue, Nuñez a adopté une approche plus pragmatique et moins idéologique du dossier algérien.
Si la reprise du dialogue semble amorcée, les obstacles demeurent nombreux. La méfiance mutuelle, alimentée par des décennies de contentieux mémoriels, de divergences politiques et de rivalités régionales, reste profonde. Mais les impératifs sécuritaires dans la bande sahélo-saharienne, la crise migratoire et les enjeux énergétiques poussent les deux capitales à renouer un minimum de coordination.
Comme le souligne un diplomate européen à Bruxelles, «ni la France ni l’Algérie n’ont intérêt à entretenir un froid durable. Les deux pays partagent des intérêts de sécurité et d’influence trop étroitement imbriqués pour s’ignorer».
Reste à savoir si ces «signaux» évoqués par Nicolas Lerner vont déboucher sur une véritable relance des relations bilatérales, ou s’il ne s’agit que d’un simple jeu d’apparences avant de futures élections de part et d’autre de la Méditerranée. Pour l’heure, la prudence domine à Paris comme à Alger. Mais une chose est sure: après un an de glaciation diplomatique, l’air semble à nouveau circuler entre les deux rives - timidement, prudemment, mais résolument.
Une déclaration mesurée, mais significative, qui traduit un changement de ton après une période marquée par la méfiance et les tensions. «Les canaux de communication n’ont jamais été totalement coupés, mais la coopération antiterroriste a atteint un point extrêmement bas», a reconnu le chef du Renseignement français, estimant qu’il n’est «dans l’intérêt d’aucun des deux pays de rester dans cette situation de blocage».
Le différend entre Paris et Alger remonte à l’été 2024, lorsque la France a publiquement réaffirmé son soutien au plan marocain d’autonomie pour le Sahara occidental, reconnu par les États-Unis depuis 2020 comme base sérieuse et crédible de règlement du conflit. Cette position a provoqué la fureur du régime algérien, qui a rappelé son ambassadeur à Paris et dénoncé ce qu’il a qualifié de «prise de position partiale».
La crise s’est ensuite envenimée après l’arrestation de deux ressortissants français en Algérie : l’écrivain Boualem Sansal, interpellé le 16 novembre 2024 et condamné à cinq ans de prison pour «atteinte à l’unité nationale», et le journaliste Christophe Gleizes, correspondant de SoFoot, condamné à sept ans de prison pour «apologie du terrorisme». Ce dernier, accusé d’avoir entretenu des contacts avec des militants du Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie (MAK), classé «organisation terroriste» par Alger, doit comparaître en appel le 3 décembre prochain.
Ces affaires ont plongé les relations bilatérales dans une crise de confiance profonde, marquée par la suspension de la coopération sécuritaire, la réduction des échanges économiques et le rappel des diplomates des deux côtés. Paris avait parlé d’une «rupture grave de confiance», tandis qu’Alger dénonçait une «campagne hostile» orchestrée par certains médias français.
Selon plusieurs sources diplomatiques, des signaux d’apaisement se multiplient depuis quelques semaines. Le président Abdelmadjid Tebboune envisagerait d’accorder une grâce présidentielle à Boualem Sansal, à la suite d’une demande du président fédéral allemande. Un geste interprété comme la première manifestation concrète d’une volonté d’ouverture.
Autre signe notable : pour la première fois depuis le déclenchement de la crise, les médias publics algériens ont évoqué Sansal sans recours à la rhétorique injurieuse habituelle, rompant ainsi avec des années de diabolisation de l’écrivain.
Parallèlement, plusieurs canaux officieux travaillent à la réactivation du dialogue entre les deux capitales. Du côté algérien, Chems-Eddine Mohamed Hafiz, recteur de la Grande mosquée de Paris, joue un rôle de médiation informelle en tant que relais de confiance du régime. Du côté français, l’archevêque d’Alger, Mgr Jean-Paul Vesco, a été reçu à plusieurs reprises par le président Tebboune, dans le cadre de discussions discrètes visant à rétablir un climat de confiance.
Enfin, la nomination de Laurent Nuñez au ministère de l’Intérieur français, en remplacement de figures plus hostiles à Alger, a contribué à calmer le jeu. Considéré comme un homme de dialogue, Nuñez a adopté une approche plus pragmatique et moins idéologique du dossier algérien.
Si la reprise du dialogue semble amorcée, les obstacles demeurent nombreux. La méfiance mutuelle, alimentée par des décennies de contentieux mémoriels, de divergences politiques et de rivalités régionales, reste profonde. Mais les impératifs sécuritaires dans la bande sahélo-saharienne, la crise migratoire et les enjeux énergétiques poussent les deux capitales à renouer un minimum de coordination.
Comme le souligne un diplomate européen à Bruxelles, «ni la France ni l’Algérie n’ont intérêt à entretenir un froid durable. Les deux pays partagent des intérêts de sécurité et d’influence trop étroitement imbriqués pour s’ignorer».
Reste à savoir si ces «signaux» évoqués par Nicolas Lerner vont déboucher sur une véritable relance des relations bilatérales, ou s’il ne s’agit que d’un simple jeu d’apparences avant de futures élections de part et d’autre de la Méditerranée. Pour l’heure, la prudence domine à Paris comme à Alger. Mais une chose est sure: après un an de glaciation diplomatique, l’air semble à nouveau circuler entre les deux rives - timidement, prudemment, mais résolument.