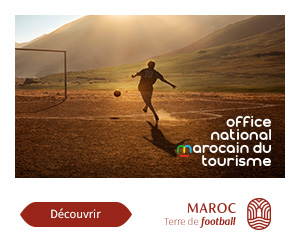Un récent article signé par Omar Hasnaoui Ch., PhD, revenait sur la réunion organisée à la Maison-Blanche par Donald Trump avec les dirigeants de Microsoft, Apple, Google, Meta, OpenAI, Oracle et AMD. Les annonces y étaient spectaculaires : plusieurs centaines de milliards de dollars investis dans l’IA, principalement dans la construction de data centers et la fabrication de semi-conducteurs. Derrière les promesses numériques, ce sont d’abord du béton, du silicium… et beaucoup d’électricité.
Selon l’Agence internationale de l’énergie, les data centers, dopés par l’IA, pourraient consommer d’ici 2030 près de 945 térawattheures par an, soit l’équivalent de la production de 110 centrales nucléaires. Aux États-Unis, cette demande rivalisera bientôt avec celle de la Californie. Au Maroc, un grand data center pourrait absorber autant d’énergie que la centrale solaire Noor de 500 MW.
De la ville intelligente à la région intelligente
Face à ce constat, il est clair que la smart city ne peut pas être pensée comme un simple décor technologique. Rabat ou Casablanca ne deviendront pas intelligentes en multipliant capteurs et tableaux de bord. Une smart city véritable est un projet de société : mobilité fluide, gestion durable de l’eau et de l’énergie, respect de la biodiversité, justice sociale et mémoire vivante.
Et surtout, une ville n’est jamais isolée. Elle est reliée à son territoire et à ses flux. Le Maroc a une chance unique : ses 12 régions géographiques et une 13ᵉ région, celle de la diaspora, forment un écosystème interdépendant. Régions côtières et intérieures, Marrakech-Safi comme laboratoire culturel, et la diaspora comme réservoir de talents et de capitaux : ensemble, elles dessinent les contours d’un Maroc des régions intelligentes et résilientes.
Le paradoxe énergétique des smart cities
Les villes intelligentes veulent réduire les embouteillages, optimiser l’eau, protéger la santé urbaine. Mais si l’électricité qui alimente ces systèmes provient de charbon ou de gaz, elles risquent d’aggraver la crise climatique. L’IA peut être un outil de sobriété… ou un accélérateur de pollution.
La solution est connue : coupler l’essor de l’IA à un mix énergétique bas-carbone – solaire, éolien, hydraulique, nucléaire, stockage et hydrogène vert. Rabat ne sera pas intelligente si son tramway, ses hôpitaux connectés et ses data centers fonctionnent avec de l’énergie fossile.
Gouvernance et souveraineté énergétique
Pour éviter que la ville intelligente ne contribue à la destruction de la planète, trois conditions sont essentielles :
- Souveraineté numérique et énergétique : cloud marocain, cybersécurité, data centers alimentés par renouvelables.
- Sobriété numérique : optimiser les algorithmes IA et limiter le gaspillage de ressources.
- Gouvernance citoyenne et territoriale : impliquer les habitants et relier les villes en réseau au service des régions.
Selon l’Agence internationale de l’énergie, les data centers, dopés par l’IA, pourraient consommer d’ici 2030 près de 945 térawattheures par an, soit l’équivalent de la production de 110 centrales nucléaires. Aux États-Unis, cette demande rivalisera bientôt avec celle de la Californie. Au Maroc, un grand data center pourrait absorber autant d’énergie que la centrale solaire Noor de 500 MW.
De la ville intelligente à la région intelligente
Face à ce constat, il est clair que la smart city ne peut pas être pensée comme un simple décor technologique. Rabat ou Casablanca ne deviendront pas intelligentes en multipliant capteurs et tableaux de bord. Une smart city véritable est un projet de société : mobilité fluide, gestion durable de l’eau et de l’énergie, respect de la biodiversité, justice sociale et mémoire vivante.
Et surtout, une ville n’est jamais isolée. Elle est reliée à son territoire et à ses flux. Le Maroc a une chance unique : ses 12 régions géographiques et une 13ᵉ région, celle de la diaspora, forment un écosystème interdépendant. Régions côtières et intérieures, Marrakech-Safi comme laboratoire culturel, et la diaspora comme réservoir de talents et de capitaux : ensemble, elles dessinent les contours d’un Maroc des régions intelligentes et résilientes.
Le paradoxe énergétique des smart cities
Les villes intelligentes veulent réduire les embouteillages, optimiser l’eau, protéger la santé urbaine. Mais si l’électricité qui alimente ces systèmes provient de charbon ou de gaz, elles risquent d’aggraver la crise climatique. L’IA peut être un outil de sobriété… ou un accélérateur de pollution.
La solution est connue : coupler l’essor de l’IA à un mix énergétique bas-carbone – solaire, éolien, hydraulique, nucléaire, stockage et hydrogène vert. Rabat ne sera pas intelligente si son tramway, ses hôpitaux connectés et ses data centers fonctionnent avec de l’énergie fossile.
Gouvernance et souveraineté énergétique
Pour éviter que la ville intelligente ne contribue à la destruction de la planète, trois conditions sont essentielles :
- Souveraineté numérique et énergétique : cloud marocain, cybersécurité, data centers alimentés par renouvelables.
- Sobriété numérique : optimiser les algorithmes IA et limiter le gaspillage de ressources.
- Gouvernance citoyenne et territoriale : impliquer les habitants et relier les villes en réseau au service des régions.
Conclusion
L’intelligence artificielle est une promesse de puissance et de compétitivité. Mais elle ne doit pas devenir un gouffre énergétique. En reliant Rabat, Casablanca et ses 13 régions dans une vision systémique, le Maroc peut inventer un modèle afro-méditerranéen où intelligence rime avec durabilité.
La smart city n’est pas une vitrine numérique : c’est un pacte écologique et citoyen. À condition de l’ancrer dans la transition énergétique, elle peut transformer le Maroc en pionnier d’une intelligence territoriale bas-carbone, capable de répondre à la double exigence de prospérité et de survie planétaire.
La smart city n’est pas une vitrine numérique : c’est un pacte écologique et citoyen. À condition de l’ancrer dans la transition énergétique, elle peut transformer le Maroc en pionnier d’une intelligence territoriale bas-carbone, capable de répondre à la double exigence de prospérité et de survie planétaire.