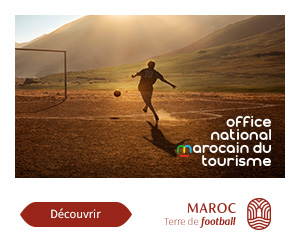Missive d’un hôpital de Beyrouth, le week-end de la disparition du musicien : « Samedi à 9 heures du matin, le cœur du grand artiste et créateur Ziad Rahbani s’est arrêté de battre ». C’est la fin d’une vie et le début d’une autre sans lui. « Je sens que tout est fini, je sens que le Liban est devenu vide », écrit sur X sa compagne, l’actrice libanaise Carmen Lebbos, à l’annonce de la mort. « Une conscience vive, une voix qui s’était rebellée contre l’injustice, et un miroir sincère des opprimés et des marginalisés », pour le président libanais Joseph Aoun. « Le Liban perd un artiste exceptionnel et créatif, une voix libre qui est restée fidèle aux valeurs de justice et de dignité et qui disait ce que beaucoup n’osaient pas dire », déclare le premier ministre, Nawaf Salam. « Nous redoutions que ce jour arrive, car nous savions que son état de santé s’aggravait et que sa volonté de se faire soigner faiblissait », ajoute sur X le ministre de la Culture, Ghassan Salamé. De tels témoignages s’accumulent et traduisent le pouvoir créatif propre à cet artiste engagé à gauche et laïc.
Seule la maman, l’immense chanteuse Faïrouz, entretient un silence débordant de souffrance. Voit-elle, entendt-elle tout ce qui se dit à l’endroit d’un fils que le monde respecte et souvent adule ? Ancien ministre français, actuel directeur de l’Institut du monde arabe et vedette culturelle, Jack Lang rend, en quelques mots, hommage à l’homme et à l’œuvre : « Ziad Rahbani s’en est allé. Fils de la légendaire Faïrouz, il a porté sur le monde un regard tendre et tranchant, mêlant satire, poésie et désenchantement. Musicien, dramaturge, chroniqueur des déroutes arabes, il a donné une voix aux silences et une musique aux colères. » Chorégraphe et enseignante de langue arabe, Lamia Safieddine est Libanaise. Née à Conakry en Guinée, elle passe deux années de son enfance au Maroc. Au lendemain de la mort de Rahbani, elle craque, joliment : « Je viens d’apprendre. Le silence s’est refermé comme une porte qu’on claque trop tôt. Ziad… Mon cœur bat encore, mais c’est un tambour crevé. Ma respiration porte le deuil de chaque note que tu ne joueras plus. Depuis mes 19 ans, ton piano habite mon corps. Ta voix, râpeuse et tendre, descendait le long de ma colonne, épousait mes vertèbres, se glissait jusqu’à mes pieds. Je t’ai dansé comme on creuse un puits.
À chaque chorégraphie, je te cherchais — pas pour te comprendre, mais pour te traverser. Tu étais mon chaos et ma clarté. Tu parlais pour nous tous, pour ceux qui n’avaient plus les mots, plus les forces, plus le souffle. Et moi, je prenais ton cri et je le rendais visible. Je le faisais chair. Aujourd’hui, je danse à genoux. La poussière du Liban m’embrasse les paumes, le sang séché de notre histoire s’accroche à mes talons. Tu es parti, mais tu es plus en moi que jamais. Tu es ce souffle court quand je lève les bras vers un ciel en miettes. Tu es cette larme sèche, logée dans mon cœur, qui refuse de tomber. Ton absence est un tremblement dans ma danse. Mais je danserai encore. Je danserai pour toi, pour nous, pour ce pays que tu as tant aimé, tant grondé, tant caressé de ta fureur douce. Je danserai pour que ta voix résonne, encore, malgré la mort, car un homme comme toi ne meurt pas vraiment. Il s’enracine. » On en perd la voix.
Seule la maman, l’immense chanteuse Faïrouz, entretient un silence débordant de souffrance. Voit-elle, entendt-elle tout ce qui se dit à l’endroit d’un fils que le monde respecte et souvent adule ? Ancien ministre français, actuel directeur de l’Institut du monde arabe et vedette culturelle, Jack Lang rend, en quelques mots, hommage à l’homme et à l’œuvre : « Ziad Rahbani s’en est allé. Fils de la légendaire Faïrouz, il a porté sur le monde un regard tendre et tranchant, mêlant satire, poésie et désenchantement. Musicien, dramaturge, chroniqueur des déroutes arabes, il a donné une voix aux silences et une musique aux colères. » Chorégraphe et enseignante de langue arabe, Lamia Safieddine est Libanaise. Née à Conakry en Guinée, elle passe deux années de son enfance au Maroc. Au lendemain de la mort de Rahbani, elle craque, joliment : « Je viens d’apprendre. Le silence s’est refermé comme une porte qu’on claque trop tôt. Ziad… Mon cœur bat encore, mais c’est un tambour crevé. Ma respiration porte le deuil de chaque note que tu ne joueras plus. Depuis mes 19 ans, ton piano habite mon corps. Ta voix, râpeuse et tendre, descendait le long de ma colonne, épousait mes vertèbres, se glissait jusqu’à mes pieds. Je t’ai dansé comme on creuse un puits.
À chaque chorégraphie, je te cherchais — pas pour te comprendre, mais pour te traverser. Tu étais mon chaos et ma clarté. Tu parlais pour nous tous, pour ceux qui n’avaient plus les mots, plus les forces, plus le souffle. Et moi, je prenais ton cri et je le rendais visible. Je le faisais chair. Aujourd’hui, je danse à genoux. La poussière du Liban m’embrasse les paumes, le sang séché de notre histoire s’accroche à mes talons. Tu es parti, mais tu es plus en moi que jamais. Tu es ce souffle court quand je lève les bras vers un ciel en miettes. Tu es cette larme sèche, logée dans mon cœur, qui refuse de tomber. Ton absence est un tremblement dans ma danse. Mais je danserai encore. Je danserai pour toi, pour nous, pour ce pays que tu as tant aimé, tant grondé, tant caressé de ta fureur douce. Je danserai pour que ta voix résonne, encore, malgré la mort, car un homme comme toi ne meurt pas vraiment. Il s’enracine. » On en perd la voix.
Satire sociale, réalisme cru
Jeune, Ziad a de qui tenir. Né de l’union de l’icône Faïrouz (Nouhad Haddad) et du compositeur Assy Rahbani, son avenir artistique et intellectuel est comme tracé. A 13 ans il écrit « Mon ami Dieu », un livre édité grâce au soutien de son père, cofondateur de l’école musicale et théâtrale moderne libanaise.
Quatre années plus tard, Ziad compose pour sa mère « Sa’alouni Ennas », pendant que son père est hospitalisé. Le succès est sans appel. Avec le concours de son frère Mansour, Assy modernise la chanson arabe en mêlant pans classiques occidentaux, russes et latino-américains à des rythmes orientaux. Ziad achève le travail en inventant le jazz oriental, gardant comme base des influences classiques. Ces mélanges savants sont ensuite confiés à la sensibilité de Faïrouz qui en fait des scies incontournables. Ziad se consacre ultérieurement au théâtre, jouant dans « Al Mahatta » et « Mais Erreem » avant de créer ses propres œuvres. Dès 1973, il écrit et met en scène « Sahriyé », suivie de « Nazl Sourour » (1974), « Bil Nisbeh La Boukra Chou ? » (1978), « Film Amiriki Taweel » (1980), et « Shi Fashil » (1983). Ces pièces signent un tournant dans le théâtre libanais, mêlant satire sociale, engagement politique et réalisme cru. En parcourant sa carrière, on n’est pas étonné de découvrir des fiches telle que celle-ci : « Musicien, compositeur, metteur en scène, Ziad Rahbani a marqué des générations de Libanais avec ses chansons et surtout ses pièces de théâtre, dont jeunes et moins jeunes connaissent les répliques par cœur.
Visionnaire, il a, dans ses pièces, évoqué la guerre civile avant même son déclenchement en 1975, les petites guerres qu’elle a engendrées ou la crise économique. » Pour l’auteur-compositeur-interprète marocain Nouamane Lahlou, « Ziad Rahmadi est le plus grand musicologue de l’histoire de la musique arabe sur les plans réunis de la créativité et de la réflexion ». Clair et limpide.
Quatre années plus tard, Ziad compose pour sa mère « Sa’alouni Ennas », pendant que son père est hospitalisé. Le succès est sans appel. Avec le concours de son frère Mansour, Assy modernise la chanson arabe en mêlant pans classiques occidentaux, russes et latino-américains à des rythmes orientaux. Ziad achève le travail en inventant le jazz oriental, gardant comme base des influences classiques. Ces mélanges savants sont ensuite confiés à la sensibilité de Faïrouz qui en fait des scies incontournables. Ziad se consacre ultérieurement au théâtre, jouant dans « Al Mahatta » et « Mais Erreem » avant de créer ses propres œuvres. Dès 1973, il écrit et met en scène « Sahriyé », suivie de « Nazl Sourour » (1974), « Bil Nisbeh La Boukra Chou ? » (1978), « Film Amiriki Taweel » (1980), et « Shi Fashil » (1983). Ces pièces signent un tournant dans le théâtre libanais, mêlant satire sociale, engagement politique et réalisme cru. En parcourant sa carrière, on n’est pas étonné de découvrir des fiches telle que celle-ci : « Musicien, compositeur, metteur en scène, Ziad Rahbani a marqué des générations de Libanais avec ses chansons et surtout ses pièces de théâtre, dont jeunes et moins jeunes connaissent les répliques par cœur.
Visionnaire, il a, dans ses pièces, évoqué la guerre civile avant même son déclenchement en 1975, les petites guerres qu’elle a engendrées ou la crise économique. » Pour l’auteur-compositeur-interprète marocain Nouamane Lahlou, « Ziad Rahmadi est le plus grand musicologue de l’histoire de la musique arabe sur les plans réunis de la créativité et de la réflexion ». Clair et limpide.