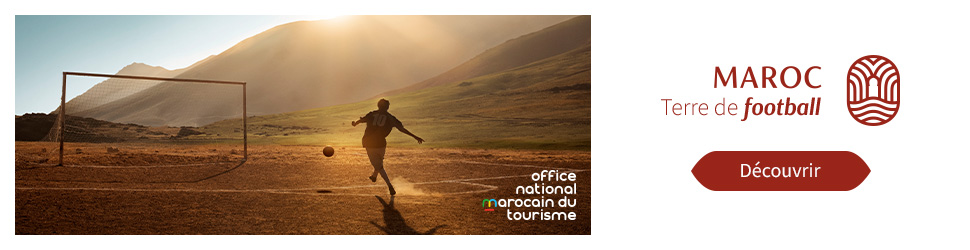Introduction : une crise révélatrice, un tournant stratégique
L’Espagne traverse actuellement une phase critique de son évolution énergétique. Loin de constituer une simple succession d’incidents techniques isolés, les fluctuations de tension, les risques de délestage et les pics de consommation observés ces derniers mois traduisent les limites d’un modèle en transition. Ces manifestations ne sont pas les symptômes d’un échec irréversible, mais plutôt les secousses d’une transformation structurelle engagée, marquée par la montée en puissance des énergies renouvelables, la décarbonation progressive du mix énergétique, et la digitalisation croissante des infrastructures.
Dans ce contexte mouvant, cette crise doit être lue comme une alerte fondatrice. Elle offre un moment propice pour repenser les équilibres, moderniser les régulations, renforcer les solidarités et accélérer la transition. Plus qu’un simple défi national, il s’agit d’une opportunité régionale d’approfondir les interconnexions, de mutualiser les ressources et de construire une résilience partagée.
Dans cette dynamique, le Maroc se profile comme un acteur incontournable. Fort d’une stratégie de transition énergétique volontariste, d’un mix diversifié, et d’une position géographique charnière entre l’Europe et l’Afrique, le Royaume incarne une complémentarité précieuse pour son voisin ibérique.
Il serait par ailleurs judicieux d’envisager un cadre institutionnel renforcé pour la coopération énergétique euro-méditerranéenne, afin d’anticiper ensemble les crises à venir et de faciliter des investissements conjoints.
1. Espagne : une alerte technique révélatrice d’une transformation systémique
Les alertes émises récemment par Red Eléctrica d’España (REE), gestionnaire du réseau de transport d’électricité, sont significatives. Elles ne traduisent pas une défaillance ponctuelle, mais bien l’émergence de contraintes structurelles dans un système en recomposition. L’insertion massive des énergies renouvelables, particulièrement solaire et éolienne, bouleverse l’équilibre traditionnel entre production et consommation.
En octobre 2025, la Commission nationale des marchés et de la concurrence (CNMC) a averti qu’en l’absence de mesures correctives immédiates, jusqu’à deux millions de foyers pourraient être confrontés à des coupures lors des pics de consommation. Cette situation souligne l’urgence d’introduire des mécanismes de flexibilité avancés : stockage énergétique, gestion intelligente de la demande, automatisation et prédiction via l’intelligence artificielle.
Mais au-delà des solutions technologiques, c’est l’ensemble du cadre de régulation, de supervision et de gouvernance qu’il convient de réformer. Le modèle énergétique espagnol ne peut plus reposer sur des équilibres statiques ; il doit désormais intégrer agilité, interactivité et anticipation.
L’intégration de plateformes numériques communes pour la gestion transfrontalière pourrait également optimiser la répartition des ressources et renforcer la réactivité du système face aux fluctuations.
2. Une crise aux racines multiples : technique, structurelle et climatique
2.1. Une transition ambitieuse, mais techniquement exigeante
Avec 56 % d’électricité produite à partir de sources renouvelables en 2024, l’Espagne figure parmi les pionniers européens de la transition énergétique. Toutefois, cette mutation rapide impose de nouveaux défis. L’intermittence intrinsèque du solaire et de l’éolien perturbe la stabilité du réseau et rend la gestion de la production plus complexe.
Les infrastructures existantes, conçues pour un modèle centralisé, doivent évoluer vers un système distribué, intelligent et modulable. La transition ne peut réussir qu’en intégrant des technologies de stockage, des capacités de pilotage décentralisé et des outils d’analyse prédictive capables de prévenir les déséquilibres entre l’offre et la demande.
L’expérimentation de micro-réseaux locaux dans certaines zones sensibles pourrait permettre d’accroître la résilience et de tester des solutions innovantes avant un déploiement à plus grande échelle.
2.2. Une demande énergétique en transformation silencieuse
La croissance de la demande énergétique semble modeste à première vue (+0,9 % en 2024), mais ce chiffre masque une transformation qualitative profonde. L’électrification de la mobilité, la prolifération des centres de données, l’usage généralisé de la climatisation sous l’effet du réchauffement climatique modifient en profondeur les schémas de consommation.
Cette mutation implique des besoins nouveaux en flexibilité, en régionalisation des réponses énergétiques et en pilotage fin des flux. Le système doit désormais être capable de s’adapter non seulement à la quantité d’énergie requise, mais aussi à sa temporalité et à sa géographie.
Une sensibilisation accrue des consommateurs, avec des outils de gestion participative, contribuerait à une meilleure maîtrise des pics de consommation.
2.3. Le climat : facteur aggravant de vulnérabilité systémique
L’été 2025 a été marqué par des températures record dépassant les 45 °C dans plusieurs régions espagnoles. Cette canicule exceptionnelle a généré des pics de consommation historiques, mettant sous pression la totalité du système électrique, de la production à la distribution.
Ces épisodes climatiques extrêmes, appelés à se multiplier, renforcent la vulnérabilité du réseau. La résilience climatique doit dès lors être érigée en priorité stratégique, au même titre que la transition technologique ou la régulation économique.
Le développement de solutions basées sur la nature, comme l’augmentation des espaces verts urbains et des infrastructures rafraîchissantes, pourrait indirectement réduire la demande en climatisation.
3. Des impacts économiques significatifs et durables
La crise énergétique actuelle se traduit aussi par une flambée des prix. Sur les marchés spot, les tarifs de l’électricité ont enregistré une hausse de plus de 50 % pendant les périodes de tension. Cette volatilité met en difficulté aussi bien les ménages que les entreprises.
Pour les foyers les plus modestes, cela signifie une érosion du pouvoir d’achat et une augmentation de la précarité énergétique. Pour les industries, notamment celles fortement consommatrices d’électricité (métallurgie, chimie, agroalimentaire), la hausse des coûts fragilise la compétitivité et ralentit l’investissement.
Cependant, cette contrainte peut devenir un catalyseur d’innovation. Elle incite à l’adoption de technologies de stockage, de dispositifs d’efficacité énergétique, et à la relocalisation des chaînes de valeur autour de l’autonomie et de la sobriété énergétique.
L’accompagnement public-privé dans le financement de projets d’efficacité énergétique pourrait accélérer cette transition, tout en préservant l’emploi et la compétitivité.
4. Interdépendance énergétique : le Maroc, un partenaire stratégique et réactif
L’Espagne fait partie intégrante d’un réseau énergétique euro-méditerranéen de plus en plus interconnecté. Elle partage avec le Maroc une capacité d’échange de 1 400 MW, qui s’est révélée cruciale à plusieurs reprises. L’événement d’avril 2025 est particulièrement parlant : confronté à un risque de black-out, le réseau espagnol a pu compter sur une injection de 400 MW d’électricité en provenance du Maroc, permettant d’éviter une panne régionale majeure.
Cette solidarité énergétique opérationnelle souligne l’importance de l’interconnexion non seulement technique, mais aussi politique. Le Maroc apparaît dès lors non plus comme un simple fournisseur occasionnel, mais comme un partenaire stratégique dans la sécurisation du réseau ibérique.
Pour maximiser cette coopération, il devient indispensable d’instaurer une gouvernance conjointe, des mécanismes de prévision partagés et une harmonisation progressive des régulations.
Par ailleurs, le développement de projets communs dans les énergies renouvelables transfrontalières pourrait renforcer l’autonomie énergétique régionale et favoriser la création d’emplois qualifiés.
5. Des leviers de transformation pour les deux pays
Face à cette situation à la fois critique et riche en potentialités, l’Espagne et le Maroc disposent de cinq leviers stratégiques pour bâtir ensemble un avenir énergétique durable et intégré :
5.1. Accroître la flexibilité du réseau
Il s’agit de développer massivement des capacités de stockage : batteries de nouvelle génération, stations de pompage-turbinage (STEP), et dispositifs de pilotage intelligent de la consommation. L’intégration d’algorithmes d’intelligence artificielle dans la supervision du réseau permettra de prédire et d’amortir les déséquilibres en temps réel.
5.2. Promouvoir l’efficacité énergétique
Réduire durablement la demande énergétique implique une rénovation ambitieuse des bâtiments, une lutte active contre les pertes énergétiques et une incitation forte à la sobriété. Une tarification sociale équitable doit accompagner cette transition pour protéger les ménages les plus vulnérables.
5.3. Stimuler l’innovation industrielle
Les industries électro-intensives doivent être accompagnées dans leur mutation vers des modèles bas carbone. Cela passe par la récupération de chaleur, l’intégration de production locale d’énergie, et la promotion du modèle du "prosommateur", à la fois producteur et consommateur.
5.4. Renforcer la coopération régionale
Un marché intégré de l’électricité à l’échelle euro-méditerranéenne permettrait d’optimiser les complémentarités, de mutualiser les risques et de sécuriser l’approvisionnement. Cela suppose une harmonisation progressive des régulations, des normes et des mécanismes de compensation.
5.5. Garantir une transition juste
La justice énergétique ne doit pas être une conséquence, mais un pilier de la transition. Les politiques tarifaires doivent à la fois encourager les comportements vertueux et amortir les effets sociaux des hausses de prix.
6. Pour le Maroc : une double opportunité stratégique
La situation espagnole constitue pour le Maroc une source d’enseignement précieuse. Elle permet d’anticiper les écueils d’un système en mutation rapide, et d’adapter en amont les cadres techniques et réglementaires. Mais elle ouvre aussi une opportunité d’affirmation géopolitique.
Doté d’un mix énergétique diversifié (solaire, éolien, hydraulique), de projets emblématiques (centrales Noor), d’une gouvernance énergétique en structuration, et d’ambitions continentales (notamment à travers l’Initiative Atlantique), le Maroc peut se positionner comme un fournisseur de flexibilité, un pôle de stabilité, et un vecteur de convergence régionale.
Cette posture, à la croisée du technique et du diplomatique, doit être consolidée et projetée comme un modèle de transition réussie dans le sud global.
L’investissement accru dans la formation technique et la recherche collaborative renforcera la compétitivité et l’attractivité du Maroc dans ce secteur stratégique.
7. Conclusion : dépasser la crise, bâtir une vision commune
Ce que vit l’Espagne aujourd’hui ne peut être réduit à une crise conjoncturelle. Il s’agit d’un tournant historique, d’un point d’inflexion révélateur des vulnérabilités mais aussi porteur d’une dynamique de réinvention.
Ce moment charnière appelle une réponse à la hauteur des enjeux : structurée, collective et prospective. Il s’agit non seulement de gérer l’urgence, mais surtout de construire un avenir énergétique pérenne, intelligent, équitable et souverain.
Dans cette perspective, le Maroc, fort de ses atouts géostratégiques, de sa stratégie de transition maîtrisée et de sa fiabilité régionale, a un rôle majeur à jouer. En coopérant étroitement avec l’Espagne, il peut contribuer à écrire une nouvelle page de l’intégration énergétique euro‑méditerranéenne, fondée sur l’interdépendance assumée, la confiance partagée et l’innovation solidaire.
L’Espagne alerte, le Maroc anticipe, ensemble ils peuvent transformer une crise en opportunité et ouvrir la voie à une nouvelle ère énergétique pour la région.