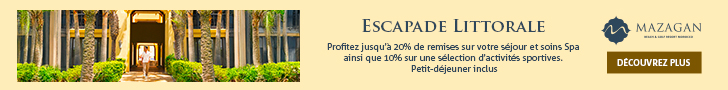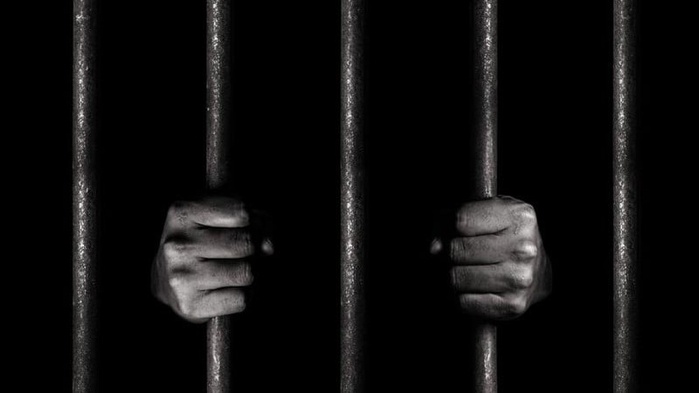La justice juvénile au Maroc avance sur une ligne de crête oscillant entre avancées législatives prometteuses et réalités institutionnelles encore complexes. Pour garantir pleinement les droits des enfants en conflit avec la loi, il est désormais indispensable de passer du cadre juridique aux pratiques concrètes, en mettant en place des dispositifs humains, coordonnés et adaptés aux besoins spécifiques de ces enfants. L’enjeu majeur demeure la traduction effective des réformes législatives en actions tangibles sur le terrain.
C’est dans cet esprit que les associations Bayti, AIDA (Ayuda, Intercambio y Desarrollo) et Defence for Children International (DCI), en partenariat avec la Délégation Générale à l’Administration Pénitentiaire et à la Réinsertion (DGAPR) et avec le cofinancement de l’Union Européenne, ont lancé une initiative majeure en faveur des droits de l’enfant, portée par le projet « Ensemble pour une justice protectrice des enfants et des femmes détenues avec leurs enfants ». Ce projet vise notamment à renforcer la Coalition nationale pour la justice juvénile et à promouvoir la mise en œuvre effective des réformes législatives, afin d’améliorer durablement la protection et les droits des enfants privés de liberté au Maroc.
C’est dans cet esprit que les associations Bayti, AIDA (Ayuda, Intercambio y Desarrollo) et Defence for Children International (DCI), en partenariat avec la Délégation Générale à l’Administration Pénitentiaire et à la Réinsertion (DGAPR) et avec le cofinancement de l’Union Européenne, ont lancé une initiative majeure en faveur des droits de l’enfant, portée par le projet « Ensemble pour une justice protectrice des enfants et des femmes détenues avec leurs enfants ». Ce projet vise notamment à renforcer la Coalition nationale pour la justice juvénile et à promouvoir la mise en œuvre effective des réformes législatives, afin d’améliorer durablement la protection et les droits des enfants privés de liberté au Maroc.
Des lacunes juridiques qui pénalisent les enfants
L’accès à la justice pour les mineurs constitue un droit fondamental, inscrit dans plusieurs instruments internationaux, notamment la Convention relative aux droits de l’enfant. Au Maroc, malgré des avancées législatives significatives ces dernières années, plusieurs obstacles persistent. Parmi eux, on note un accès encore limité à une assistance juridique spécialisée, l'absence de services de défense adaptés aux enfants, ainsi qu’un manque d’informations claires et compréhensibles sur leurs droits et les procédures judiciaires.
Sur cette lancée, les participants ont réaffirmé leur volonté de consolider les mécanismes de coopération entre les institutions concernées. L’événement a réuni des représentants des plus hautes institutions de l’État (magistrature, ministères, administration pénitentiaire, services sociaux), des organisations de la société civile et des partenaires multilatéraux. Tous ont engagé un dialogue interinstitutionnel en vue d’améliorer l’impact des actions conjointes, dans un esprit de complémentarité, de synergie et de responsabilité partagée.
Dans une déclaration à « L’Opinion », Ana Habiba Dahbi, experte en protection de l’enfance au sein de l’organisation AIDA, a affirmé : « Le plaidoyer, pour nous, ce n’est pas seulement de faire évoluer la loi. Le Maroc est déjà engagé dans une refonte importante de sa législation. Mais ce qui est tout aussi essentiel, c’est d’assurer le suivi de cette législation, pour que l’intérêt supérieur de l’enfant soit réellement placé au centre ».
« On ne peut pas se permettre d’avoir des lois qui laissent des vides juridiques. Cela ouvre la porte à des décisions rendues par les juges sur la base de leur propre appréciation, et non sur des faits clairs et encadrés », ajoute notre interlocutrice, soulignant que lorsqu’on parle d’intérêt supérieur de l’enfant, "cela signifie aussi que l’enfant doit comprendre pourquoi il est détenu, pourquoi il est en prison". Ce lien entre la décision judiciaire et la perception de l’enfant est aujourd’hui largement insuffisant.
Soutien psychologique et réinsertion
De nombreux mineurs incarcérés présentent des troubles psychologiques, avec des signes cliniques révélant des troubles de conduite et un stress chronique. Ces conditions peuvent laisser des séquelles durables à l’âge adulte, d’où l’importance d’envisager un suivi adapté dès le plus jeune âge.
Bouchra El Mourabiti, psychothérapeute pour adolescents, a livré à « L’Opinion » son analyse des symptômes les plus courants des troubles de conduite chez cette catégorie. "Parmi ces détenus, on observe souvent une activité sexuelle précoce, des crises de colère répétées et prolongées, de l’agressivité, des mensonges, des tromperies, des destructions de biens, des dépendances ainsi que des comportements violents", précise-t-elle. En revanche, le trouble de stress post-traumatique sévère est moins fréquent, mais se manifeste par des maux de tête, des douleurs musculaires, des troubles digestifs, des douleurs thoraciques, une accélération du rythme cardiaque, des troubles du sommeil, des problèmes dermatologiques ainsi que des migraines ». « Ces symptômes peuvent également entraîner des difficultés de concentration, des troubles de la mémoire et des difficultés à gérer l’anxiété, la peur ou la panique ».
Elle a ajouté que parmi les traitements modernes ayant fait leurs preuves figurent la thérapie de groupe, la thérapie cognitive comportementale et la pharmacothérapie. « Il est essentiel que les détenus bénéficient de ces interventions dès leur entrée en prison et continuent d’en bénéficier à leur sortie. L’État a le devoir de les accompagner dans leur réinsertion sociale afin de les aider à faire face aux pressions liées à la stigmatisation sociale et à la frustration du chômage, fréquentes chez les personnes avec un casier judiciaire ».
Concernant les enfants ne manifestant aucun remords et présentant des comportements criminels graves, Bouchra El Mourabiti précise : « Après un traitement continu d’au moins trois ans, si l’absence de remords, l’engourdissement émotionnel et les pensées agressives persistent, il est probable que nous ayons affaire à une personnalité psychopathique, fortement susceptible de récidiver. Ces individus représentent un danger majeur pour la société ».
« À mon avis, l’administration pénitentiaire devrait réaliser des études psychologiques comparatives, idéalement longitudinales, afin d’identifier les détenus susceptibles de bénéficier d’une réduction de peine ou d’une grâce », conclut-elle.
La plus-value des peines alternatives
Le séminaire a également mis l’accent sur la Loi n°43.22 relative aux peines alternatives, considérée comme un levier essentiel pour favoriser la réinsertion des mineurs et réduire la détention, dans le but de diminuer le nombre d’enfants privés de liberté.
Pour sa part, Alex Kamarotos, directeur de Defence for Children International (DCI), a souligné : « Ce que nous recommandons, c’est de miser sur la prévention et de développer des alternatives à l’emprisonnement. Lorsqu’un enfant commet une erreur, il ne faut pas le jeter en prison, un environnement frustrant et traumatisant qui ne favorise pas sa reconstruction. Il est essentiel de proposer des solutions alternatives, comme des centres d’éducation et de réinsertion ».
« Les études les plus récentes ont démontré que la détention laisse des marques psychologiques profondes. Ces traumatismes accompagnent l’enfant tout au long de sa vie, jusqu’à l’âge adulte, affectant durablement son parcours ».
Par ailleurs, un processus structuré a été lancé pour renforcer et consolider une Coalition nationale multisectorielle. Ce processus devrait aboutir à la création d’un Comité de pilotage représentatif en mars 2026, suivi de l’adoption d’une feuille de route triennale couvrant la période 2026-2028, prévue pour juillet 2026.
Trois questions à Ana Habiba Dahbi : « Nous apportons un accompagnement juridique aux enfants détenus sans avocat »
Ana Habiba Dahbi, experte en protection de l’enfance au sein de l’Organisation AIDA, a répondu à nos questions.
- Quelles actions envisagez-vous dans votre projet pour soutenir les enfants en détention ?
- Dans le cadre de ce projet, nous travaillons directement avec les enfants détenus et les femmes accompagnées de leurs enfants, en leur offrant une assistance juridique et un soutien psychosocial via des avocats, psychologues et ateliers sur l’égalité, la violence et les compétences sociales pour faciliter leur réinsertion. L’assistance juridique vise aussi à permettre la libération des enfants : lors d’un précédent projet, 90 enfants ont pu sortir des centres de réinsertion de Aïn Sebaâ et Benslimane. Par ailleurs, le projet prévoit le renforcement des capacités des acteurs du système judiciaire et de protection de l’enfance (assistants sociaux, avocats, juges, services pénitentiaires et de santé), en leur transmettant des pratiques adaptées issues d’autres pays similaires, afin d’améliorer la prise de décision en respectant toujours l’intérêt supérieur de l’enfant.
- Quels dispositifs juridiques et psychologiques avez-vous mis en place pour soutenir les enfants détenus ?
- Sur le plan juridique, deux avocats accompagneront les enfants détenus sans représentation légale, notamment ceux dont les familles n’ont pas les moyens de payer un avocat. L’objectif est d’assurer un suivi judiciaire tout au long du processus. Des collaborations sont également prévues avec la clinique juridique de Casablanca pour sensibiliser les étudiants en droit à la protection de l’enfance. Côté psychosocial, deux psychologues interviendront pour un accompagnement en profondeur des enfants et de leurs familles, autour des traumatismes et de la réinsertion. Enfin, un axe de plaidoyer viendra appuyer ces actions pour faire évoluer les pratiques à long terme.
- Combien de bénéficiaires sont prévus pour la prochaine étape du projet ?
- Initialement, le projet prévoyait d’accompagner 350 enfants, mais nous avons finalement atteint 1.140 bénéficiaires. Pour cette nouvelle phase, nous restons sur une base de 350 enfants, 90 familles et 23 femmes détenues avec leurs enfants. Cela dit, nous savons que nous dépasserons probablement ces chiffres. Sur les trois prochaines années, l’intervention s’élargira à de nouveaux établissements, notamment les prisons locales de Settat (Ali Moumen), Larache, Oukacha, ainsi que les centres d’Aïn Sebaâ et Benslimane.
- Quelles actions envisagez-vous dans votre projet pour soutenir les enfants en détention ?
- Dans le cadre de ce projet, nous travaillons directement avec les enfants détenus et les femmes accompagnées de leurs enfants, en leur offrant une assistance juridique et un soutien psychosocial via des avocats, psychologues et ateliers sur l’égalité, la violence et les compétences sociales pour faciliter leur réinsertion. L’assistance juridique vise aussi à permettre la libération des enfants : lors d’un précédent projet, 90 enfants ont pu sortir des centres de réinsertion de Aïn Sebaâ et Benslimane. Par ailleurs, le projet prévoit le renforcement des capacités des acteurs du système judiciaire et de protection de l’enfance (assistants sociaux, avocats, juges, services pénitentiaires et de santé), en leur transmettant des pratiques adaptées issues d’autres pays similaires, afin d’améliorer la prise de décision en respectant toujours l’intérêt supérieur de l’enfant.
- Quels dispositifs juridiques et psychologiques avez-vous mis en place pour soutenir les enfants détenus ?
- Sur le plan juridique, deux avocats accompagneront les enfants détenus sans représentation légale, notamment ceux dont les familles n’ont pas les moyens de payer un avocat. L’objectif est d’assurer un suivi judiciaire tout au long du processus. Des collaborations sont également prévues avec la clinique juridique de Casablanca pour sensibiliser les étudiants en droit à la protection de l’enfance. Côté psychosocial, deux psychologues interviendront pour un accompagnement en profondeur des enfants et de leurs familles, autour des traumatismes et de la réinsertion. Enfin, un axe de plaidoyer viendra appuyer ces actions pour faire évoluer les pratiques à long terme.
- Combien de bénéficiaires sont prévus pour la prochaine étape du projet ?
- Initialement, le projet prévoyait d’accompagner 350 enfants, mais nous avons finalement atteint 1.140 bénéficiaires. Pour cette nouvelle phase, nous restons sur une base de 350 enfants, 90 familles et 23 femmes détenues avec leurs enfants. Cela dit, nous savons que nous dépasserons probablement ces chiffres. Sur les trois prochaines années, l’intervention s’élargira à de nouveaux établissements, notamment les prisons locales de Settat (Ali Moumen), Larache, Oukacha, ainsi que les centres d’Aïn Sebaâ et Benslimane.