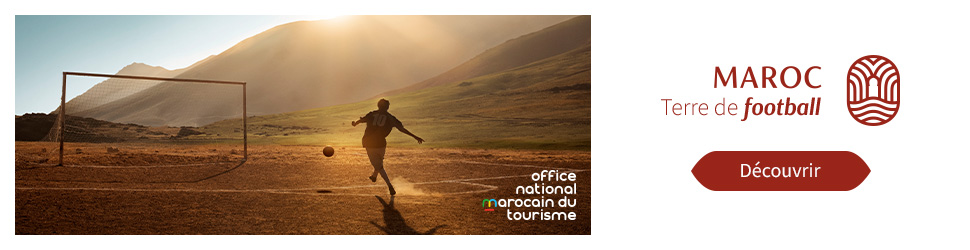L’étude livre d’emblée un paradoxe frappant : 92% des Marocains considèrent qu’il est avantageux pour une marque d’être marocaine, et 61% déclarent avoir une très bonne image des marques locales, avec un enthousiasme plus marqué encore chez les moins de 30 ans, pourtant, lorsque l’on observe les motivations réelles à l’achat, la marocanité joue un rôle minime : seuls 3 à 5% des sondés la citent comme critère principal de choix. Ce décalage s’explique, selon l’étude, par un phénomène structurant : «L’origine n’a plus à compenser la performance». Les marques marocaines se sont imposées, au fil des années, sur les terrains décisifs du choix - qualité, goût, prix -, rendant leur identité nationale moins déterminante dans l’arbitrage final.
Le rapport souligne que l’impact du Made in Morocco ne se déploie pas de manière uniforme. Sa force dépend d’abord de la maturité des catégories. Dans les univers considérés comme des spécialités marocaines - huile d’olive, semoule, dattes -, la marocanité constitue un atout naturel, presque évident. Ailleurs, elle n’est efficace que si la marque apporte d’abord la preuve de sa qualité. Cette exigence est particulièrement marquée dans des catégories historiquement dominées par l’importé, telles que les fromages ou les cosmétiques.
L’étude met également en évidence une dimension contextuelle : la fibre nationale ne fonctionne pas comme un driver permanent, mais comme un levier émotionnel puissant, qui s’active lors de moments collectifs forts : compétitions sportives, boycott, tensions géopolitiques ou périodes de fierté nationale. Dans ces situations, la marocanité devient un amplificateur redoutable, mais uniquement si la crédibilité de la marque est déjà installée.
Le rapport souligne que l’impact du Made in Morocco ne se déploie pas de manière uniforme. Sa force dépend d’abord de la maturité des catégories. Dans les univers considérés comme des spécialités marocaines - huile d’olive, semoule, dattes -, la marocanité constitue un atout naturel, presque évident. Ailleurs, elle n’est efficace que si la marque apporte d’abord la preuve de sa qualité. Cette exigence est particulièrement marquée dans des catégories historiquement dominées par l’importé, telles que les fromages ou les cosmétiques.
L’étude met également en évidence une dimension contextuelle : la fibre nationale ne fonctionne pas comme un driver permanent, mais comme un levier émotionnel puissant, qui s’active lors de moments collectifs forts : compétitions sportives, boycott, tensions géopolitiques ou périodes de fierté nationale. Dans ces situations, la marocanité devient un amplificateur redoutable, mais uniquement si la crédibilité de la marque est déjà installée.
Une influence croissante chez les jeunes générations
Les moins de 30 ans jouent un rôle central dans cette transformation. Ils ont «cassé le réflexe importé = meilleur» et évaluent désormais les marques marocaines à la performance, non à l’origine. Pour eux, la marocanité n’est ni un refuge ni une excuse : elle n’a de valeur que lorsqu’elle se combine à des standards élevés. Ce regard exigeant contribue à pousser les marques locales vers davantage d’innovation, de qualité et d’alignement sur les attentes d’une génération plus connectée, plus exposée au monde et plus habituée à comparer.
Selon l’étude, tirer pleinement parti du Made in Morocco exige une approche stratégique claire. La marocanité renforce, mais elle ne compense pas. Une marque locale performante peut ainsi en faire un différenciateur crédible, mais jamais l’ériger en argument principal. Le rapport insiste sur plusieurs conditions : exceller sur les drivers universels (qualité, goût, innovation), activer l’identité marocaine de manière authentique, et surtout l’adapter aux spécificités des catégories.
La proximité constitue également un atout structurel : compréhension fine des besoins marocains, réactivité, adaptation locale, connaissance des usages. Autant d’éléments qui, bien exploités, permettent aux marques locales de rivaliser, voire de surpasser, les standards internationaux.
La parole des experts : Qualité, exigence et marocanité moderne
L’étude intègre les éclairages de plusieurs professionnels, qui convergent sur un point essentiel : la marocanité d’un produit n’a de sens que si la qualité suit.
Pour Mehdi Alami, fondateur de Next-Gen Trade & Consulting, l’impact identitaire reste marginal en dehors des contextes particuliers. Selon lui, l’impulsion qui soutient le Made in Morocco vient davantage des politiques publiques que du consommateur lui-même. À ses yeux, l’expression la plus accomplie de la marocanité serait celle d’une marque née au Maroc devenant réellement mondiale, capable de porter l’excellence nationale au-delà des frontières.
Du côté des entreprises, Sophia Anbaoui (CMO de VIVA – Oland Group) rappelle qu’une marque marocaine ne peut revendiquer son identité qu’en l’adossant à une exigence de qualité irréprochable, adaptée aux préférences marocaines, et soutenue par une communication ancrée dans les codes culturels du pays.
Ryad Bendouro (DG délégué, H&S Retail Holding) adopte une vision similaire : les marques marocaines ne doivent pas suivre, mais définir leurs propres standards, visant à se hisser au niveau des meilleures références mondiales.
Enfin, Imane Belmejdoub (Head of Marketing, Centrale Danone) met en garde contre une marocanité «déclarative», sans substance : elle ne peut créer la préférence que si elle s’appuie sur une valeur ajoutée tangible, une pertinence locale authentique et une écoute fine des usages.
L’étude conclut que la marocanité peut devenir une source de performance, à condition d’être mobilisée au bon moment et dans les bonnes catégories, comme un marqueur stratégique et non comme un argument automatique. Le Made in Morocco, loin d’être un simple label, est une promesse exigeante : celle d’un produit qui incarne un Maroc ambitieux, innovant et aligné avec les attentes d’un consommateur devenu l’un des plus sélectifs et informés de la région.