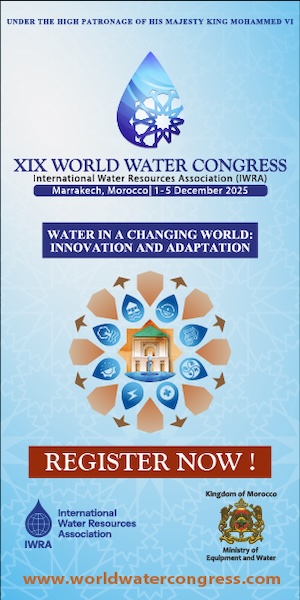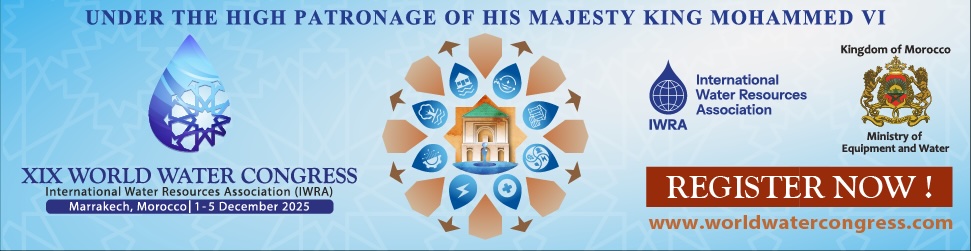Alors que le Maroc s’engage dans une profonde réforme de son système de santé, un débat essentiel refait surface, faut-il permettre au pharmacien d’assurer la continuité du traitement lorsqu’un médicament prescrit est en rupture de stock ? Pour le Dr Mohamed Lahbabi, président de la Confédération des Syndicats des Pharmaciens du Maroc, la réponse est claire, la substitution n’est pas un privilège revendiqué, mais un devoir de santé publique et un acte de responsabilité partagée.
Chaque jour, des patients se heurtent à l’indisponibilité de médicaments prescrits. Dans ces situations, le pharmacien, garant de la continuité thérapeutique, se retrouve confronté à un dilemme, respecter un cadre déontologique rigide ou répondre à l’urgence sanitaire.
L’article 27 du Code de déontologie interdit toute modification d’ordonnance sans accord préalable du médecin. Pourtant, la loi 17-04 relative au médicament et à la pharmacie confère explicitement au pharmacien la mission d’analyser, délivrer, informer et conseiller.
Or, la Constitution marocaine, dans son article 31, garantit le droit à la santé et à la continuité des soins. Une mise en cohérence s’impose donc entre le droit, la déontologie et la pratique quotidienne afin d’autoriser une substitution encadrée et transparente.
Souveraineté sanitaire
Le ministère de la Santé et l’Agence marocaine du médicament et des produits de santé (AMMPS) ont amorcé la mise en place d’un Répertoire national des génériques, reposant sur des exigences strictes de bioéquivalence et de qualité. Ce répertoire constitue le socle d’une substitution sécurisée, conforme aux standards internationaux.
Cette démarche s’inscrit dans la stratégie nationale de souveraineté sanitaire et dans les orientations de l’Organisation mondiale de la Santé. Elle s’aligne également sur les pratiques de pays comme la France, la Belgique ou le Canada, où la substitution pharmaceutique est un instrument reconnu de continuité des soins et de rationalisation des dépenses publiques.
Des objections à dissiper par la science
Certains médecins restent réservés, invoquant des doutes sur la qualité des génériques. Pourtant, ces médicaments sont régulièrement prescrits et ne peuvent être commercialisés sans preuve de bioéquivalence, conformément au décret n° 2-17-429.
Mettre en doute leur fiabilité revient à fragiliser la confiance dans le système du médicament marocain. En réalité, le refus de substitution ne protège pas le patient ,il l’expose à une rupture de traitement, surtout lorsque le prescripteur n’est pas joignable. Une situation particulièrement visible durant la pandémie de Covid-19, période où les pharmaciens ont assuré la continuité du service malgré les contraintes.
Le pharmacien, acteur de proximité et pilier de la santé publique
Dans un contexte économique marqué par la baisse des prix des médicaments et l’érosion des marges, les pharmaciens continuent de servir l’intérêt général.
La substitution ne génère pas de profit supplémentaire, elle contribue au contraire à réduire la charge financière des ménages et à améliorer l’accès aux traitements, notamment dans les zones rurales.
Le pharmacien n’est pas un rival du médecin, mais un partenaire dans la chaîne du soin. La substitution, lorsqu’elle respecte des protocoles précis , même DCI, même dosage, information du patient, mention « non substituable » en cas de justification médicale, devient un acte de santé publique à part entière.
Pour un cadre marocain clair et responsable
Face à l’urgence d’encadrer la substitution médicamenteuse, la Confédération des Syndicats des Pharmaciens du Maroc (CSPM) appelle à la mise en place d’un dispositif clair, cohérent et pragmatique, garantissant la sécurité du patient tout en préservant l’équilibre entre les professions de santé.
Cette réforme devrait reposer sur quatre axes majeurs. D’abord, l’adoption d’un décret instaurant une dérogation encadrée à l’article 27 du Code de déontologie, afin de permettre au pharmacien d’intervenir dans un cadre légal précis lorsque le médicament prescrit est indisponible.
Ensuite, la finalisation et la reconnaissance officielle du Répertoire national des génériques comme référence scientifique incontestable. Ce répertoire servirait de base à toute décision de substitution, en s’appuyant sur des critères stricts de bioéquivalence et de qualité.
Troisièmement, la CSPM préconise la conclusion d’une convention avec la CNSS, permettant de valoriser et de compenser équitablement l’acte de substitution en tant que service rendu à la continuité des soins.
Enfin, une large campagne nationale d’information devrait être lancée, destinée à sensibiliser le corps médical, les pharmaciens et le grand public. Cette initiative vise à expliquer le cadre de la substitution, ses bénéfices et les garanties de sécurité qui l’accompagnent, afin de restaurer la confiance et d’assurer une meilleure compréhension du rôle du pharmacien dans la chaîne du soin.
La substitution pharmaceutique ne retire rien au prescripteur ; elle consolide au contraire la relation de confiance entre le médecin, le pharmacien et le patient.
Elle constitue un outil de justice sociale, un gage de sécurité thérapeutique et un indicateur de maturité sanitaire pour le Maroc. Le pays dispose aujourd’hui des institutions, des compétences et de la volonté nécessaires pour franchir ce pas, dans l’intérêt du citoyen. Car, comme le souligne Dr Lahbabi, la véritable question demeure : à qui profite encore la peur du générique, sinon à ceux qui oublient que la santé du patient ne porte pas de marque ?
Chaque jour, des patients se heurtent à l’indisponibilité de médicaments prescrits. Dans ces situations, le pharmacien, garant de la continuité thérapeutique, se retrouve confronté à un dilemme, respecter un cadre déontologique rigide ou répondre à l’urgence sanitaire.
L’article 27 du Code de déontologie interdit toute modification d’ordonnance sans accord préalable du médecin. Pourtant, la loi 17-04 relative au médicament et à la pharmacie confère explicitement au pharmacien la mission d’analyser, délivrer, informer et conseiller.
Or, la Constitution marocaine, dans son article 31, garantit le droit à la santé et à la continuité des soins. Une mise en cohérence s’impose donc entre le droit, la déontologie et la pratique quotidienne afin d’autoriser une substitution encadrée et transparente.
Souveraineté sanitaire
Le ministère de la Santé et l’Agence marocaine du médicament et des produits de santé (AMMPS) ont amorcé la mise en place d’un Répertoire national des génériques, reposant sur des exigences strictes de bioéquivalence et de qualité. Ce répertoire constitue le socle d’une substitution sécurisée, conforme aux standards internationaux.
Cette démarche s’inscrit dans la stratégie nationale de souveraineté sanitaire et dans les orientations de l’Organisation mondiale de la Santé. Elle s’aligne également sur les pratiques de pays comme la France, la Belgique ou le Canada, où la substitution pharmaceutique est un instrument reconnu de continuité des soins et de rationalisation des dépenses publiques.
Des objections à dissiper par la science
Certains médecins restent réservés, invoquant des doutes sur la qualité des génériques. Pourtant, ces médicaments sont régulièrement prescrits et ne peuvent être commercialisés sans preuve de bioéquivalence, conformément au décret n° 2-17-429.
Mettre en doute leur fiabilité revient à fragiliser la confiance dans le système du médicament marocain. En réalité, le refus de substitution ne protège pas le patient ,il l’expose à une rupture de traitement, surtout lorsque le prescripteur n’est pas joignable. Une situation particulièrement visible durant la pandémie de Covid-19, période où les pharmaciens ont assuré la continuité du service malgré les contraintes.
Le pharmacien, acteur de proximité et pilier de la santé publique
Dans un contexte économique marqué par la baisse des prix des médicaments et l’érosion des marges, les pharmaciens continuent de servir l’intérêt général.
La substitution ne génère pas de profit supplémentaire, elle contribue au contraire à réduire la charge financière des ménages et à améliorer l’accès aux traitements, notamment dans les zones rurales.
Le pharmacien n’est pas un rival du médecin, mais un partenaire dans la chaîne du soin. La substitution, lorsqu’elle respecte des protocoles précis , même DCI, même dosage, information du patient, mention « non substituable » en cas de justification médicale, devient un acte de santé publique à part entière.
Pour un cadre marocain clair et responsable
Face à l’urgence d’encadrer la substitution médicamenteuse, la Confédération des Syndicats des Pharmaciens du Maroc (CSPM) appelle à la mise en place d’un dispositif clair, cohérent et pragmatique, garantissant la sécurité du patient tout en préservant l’équilibre entre les professions de santé.
Cette réforme devrait reposer sur quatre axes majeurs. D’abord, l’adoption d’un décret instaurant une dérogation encadrée à l’article 27 du Code de déontologie, afin de permettre au pharmacien d’intervenir dans un cadre légal précis lorsque le médicament prescrit est indisponible.
Ensuite, la finalisation et la reconnaissance officielle du Répertoire national des génériques comme référence scientifique incontestable. Ce répertoire servirait de base à toute décision de substitution, en s’appuyant sur des critères stricts de bioéquivalence et de qualité.
Troisièmement, la CSPM préconise la conclusion d’une convention avec la CNSS, permettant de valoriser et de compenser équitablement l’acte de substitution en tant que service rendu à la continuité des soins.
Enfin, une large campagne nationale d’information devrait être lancée, destinée à sensibiliser le corps médical, les pharmaciens et le grand public. Cette initiative vise à expliquer le cadre de la substitution, ses bénéfices et les garanties de sécurité qui l’accompagnent, afin de restaurer la confiance et d’assurer une meilleure compréhension du rôle du pharmacien dans la chaîne du soin.
La substitution pharmaceutique ne retire rien au prescripteur ; elle consolide au contraire la relation de confiance entre le médecin, le pharmacien et le patient.
Elle constitue un outil de justice sociale, un gage de sécurité thérapeutique et un indicateur de maturité sanitaire pour le Maroc. Le pays dispose aujourd’hui des institutions, des compétences et de la volonté nécessaires pour franchir ce pas, dans l’intérêt du citoyen. Car, comme le souligne Dr Lahbabi, la véritable question demeure : à qui profite encore la peur du générique, sinon à ceux qui oublient que la santé du patient ne porte pas de marque ?