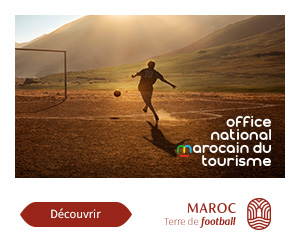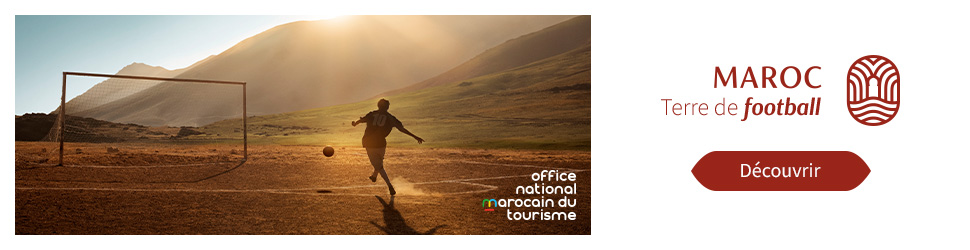- Le mouvement GENZ212 a marqué les esprits, en publiant un mémorandum qui établit un diagnostic clair et sans concession des maux du pays. Est-ce que la transition de la protestation à la proposition technique est la partie la plus difficile à réaliser ?
Effectivement, cette transition est, sans doute, la plus difficile à réaliser. Passer de la protestation à la proposition, c’est changer de posture : on passe d’un cri du cœur à un travail de construction. Cela demande de la structuration, du temps, de la méthode et surtout de la confiance. Le mouvement GENZ212 a déjà franchi une étape importante en formulant un diagnostic clair et argumenté.
C’est une preuve de maturité politique. Mais le vrai défi commence maintenant : comment transformer cette conscience collective en action organisée et durable ? Le Maroc manque encore d’espaces où les jeunes peuvent apprendre à structurer leur action, à dialoguer avec les institutions, à comprendre les mécanismes de décision publique et à défendre leurs idées dans un cadre pacifique et stratégique.
C’est là qu’interviennent les Associations, les Mouvements citoyens et les acteurs intermédiaires, lesquels peuvent jouer ce rôle de « passeur », d’école de la participation. Sans cet accompagnement, la dynamique risque de s’essouffler ou d’être récupérée. En somme, la structuration de l’action collective est la clé. Sans organisation, la contestation s’éteint. Avec elle, elle se transforme en force de proposition.
- Vous êtes au cœur du dialogue. Quels sont, selon vous, les points majeurs sur lesquels les décideurs politiques continuent de manquer la compréhension des revendications de GENZ212, malgré la médiatisation ?
Ce fossé n’est pas seulement générationnel, il est aussi culturel et politique. Les décideurs continuent souvent à communiquer dans un registre de promotion : ils parlent de leurs réalisations, de leurs plans, de leurs visions… mais rarement de leurs échecs ou de leurs limites. Or, les jeunes ne demandent pas un discours parfait ; ils demandent un discours vrai. Ce que le mouvement GENZ212 exprime, c’est une soif de sincérité.
Les jeunes ne veulent pas seulement être écoutés, ils veulent être considérés comme des acteurs du changement. Le problème, c’est que les canaux de dialogue existants ne leur inspirent plus confiance. Quand un jeune prend la parole, il veut sentir qu’elle a un impact réel, pas qu’elle alimente un rapport ou un communiqué.
Pour avancer, il faut une volonté politique claire d’ouvrir un dialogue sincère et constructif avec cette génération. Cela veut dire reconnaître, publiquement, les limites des politiques actuelles ; donner des garanties que leurs revendications seront prises en compte. Cela veut dire aussi passer d’une communication verticale à une communication horizontale, basée sur la co-construction. Tant que les décideurs continueront à parler aux jeunes sans parler avec eux, la distance restera la même.
- L'éducation est un pilier fondamental, mais les inégalités se creusent. Les écoles publiques sont souvent délaissées au profit du privé. Quelle proposition concrète avez-vous pour garantir une répartition plus équitable des ressources publiques vers les écoles des quartiers défavorisés ?
L’école publique est le cœur battant de toute nation. Or, aujourd’hui, elle bat faiblement, et les inégalités se sont tellement creusées que l’école, censée corriger les injustices sociales, les reproduit. À travers les Cafés Citoyens, organisés dans les douze régions du Maroc par l’Association « Les Citoyens », nous avons entendu des centaines de jeunes et d’enseignants. Trois priorités sont revenues sans cesse : la première est la proximité et la dignité, car beaucoup d’élèves des zones rurales parcourent encore plusieurs kilomètres à pied pour rejoindre leur école.
Ce qui décourage la scolarisation, surtout chez les filles, d'où la nécessité d'investir dans des écoles de proximité avec des infrastructures décentes et des conditions de vie dignes pour les enseignants. La deuxième priorité est de revaloriser la formation et le métier d’enseignant, pour qu'enseigner redevienne une vocation et non un refuge par défaut, ce qui passe par une meilleure rémunération, une formation continue, et une reconnaissance symbolique de leur rôle comme pilier du développement.
Enfin, la troisième est de réformer les contenus et d’ouvrir l’école à la pensée critique, car trop d’élèves apprennent à réciter et non à raisonner, l'école devant enseigner l’analyse, la créativité, la citoyenneté et les compétences du XXIème siècle, y compris la transition numérique.
Au-delà de ces aspects techniques, il faut restaurer la valeur morale et sociale de l’école publique pour qu'elle redevienne un lieu de mixité sociale où l’enfant du cadre et celui de l’ouvrier se côtoient. Car tant que les classes moyennes fuiront l’école publique, la fracture sociale continuera de se creuser. En somme, refonder l’école, c’est refonder la promesse d’égalité.
- La santé est une préoccupation majeure, le système étant souvent critiqué pour son accès inégal et le manque de ressources humaines dans certaines régions, malgré les efforts de généralisation de l'AMO. Peut-on régler cela en deux coups de cuillère à pot ?
Non, on ne répare pas le système de santé en deux ans ni en deux réformes, car la santé est un écosystème complexe englobant les infrastructures, les ressources humaines, la gouvernance et la confiance, et sur chacun de ces points, il y a du retard. Former un médecin prend près de sept ans, rendant illusoire l'idée que la généralisation de l’AMO suffira à elle seule à combler les inégalités d’accès. Mais cela ne signifie pas qu'il faille attendre dix ans pour agir.
Des leviers immédiats existent, notamment en renforçant les services de proximité tels que : les dispensaires, les centres de santé ruraux et la médecine de famille, qui sont souvent les premiers et seuls points de contact pour des millions de Marocains. Il est également crucial de revaloriser les conditions de travail de tout le personnel médical pour endiguer la fuite vers le privé ou vers l’étranger.
Enfin, la numérisation de la gestion du système de santé permettrait de réduire la bureaucratie, d'améliorer la transparence et la coordination entre les établissements. En définitive, la santé ne se réduit pas à des hôpitaux, elle commence par la prévention, l’éducation sanitaire et la dignité du soin. C’est aussi une question de confiance fondamentale : quand les gens croient à leur système de santé, ils croient davantage à leur pays.
- En matière d’emploi, le Royaume compte des diplômés très qualifiés mais un chômage élevé. L'enjeu est-il uniquement quantitatif ou la solution réside-t-elle dans une réforme profonde de la réglementation du travail et de l'aide à l'entrepreneuriat ?
Le problème n’est pas seulement quantitatif, il est structurel et culturel. Nous avons formé des générations de diplômés dans des filières déconnectées du marché de l’emploi. Les entreprises cherchent des profils adaptables, capables de travailler en équipe, d’innover, de communiquer. Le système éducatif, lui, continue à valoriser la conformité plus que la créativité. Il faut donc repenser la formation du capital humain : renforcer la passerelle entre l’école, l’Université et l’entreprise, encourager les stages dès le lycée, et valoriser les métiers techniques.
Mais il faut aussi un changement de mentalité. On a encore du mal à accepter l’échec, à oser entreprendre. Or, l’entrepreneuriat ne se décrète pas, il s’apprend, dès l’école, par la pratique, par la confiance, par l’encouragement à la prise d’initiative. L’État a fait des efforts pour créer des programmes d’appui, mais tant qu’on n’aura pas une culture de l’initiative et du risque maîtrisé, ces programmes resteront des solutions ponctuelles. L’emploi, c’est une question de dignité avant tout. Donner du travail, ce n’est pas seulement donner un revenu, c’est donner une place dans la société. Et c’est cela que notre jeunesse réclame, avec force et légitimité.
Recueillis par
Safaa KSAANI
Safaa KSAANI