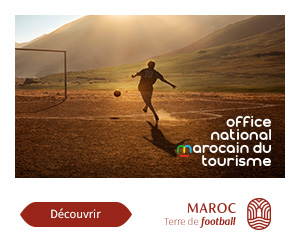Un mois après le Discours du Trône, dans lequel le Souverain a donné Ses instructions en vue d’engager un véritable sursaut en matière de mise à niveau globale des territoires et de réduction des disparités sociales et spatiales, le ministre de l’Intérieur a adressé une circulaire aux walis et gouverneurs, les invitant à préparer une nouvelle génération de programmes intégrés de développement territorial. En ligne de mire : la consolidation de la régionalisation avancée, mettre en valeur les spécificités locales et promouvoir la solidarité entre les collectivités, afin que chaque citoyen bénéficie de manière équitable des retombées du développement. Une démarche qui s’impose du fait que le modèle de développement marocain a longtemps été marqué par une forte centralisation. Les choix d’investissement public se sont concentrés sur les régions côtières, déjà prospères, renforçant leur domination économique. Le rapport publié la semaine dernière par le Policy Center for the New South explique que ce schéma trouve ses racines dans la période coloniale, qui avait instauré une organisation duale du territoire : un littoral tourné vers l’industrialisation et un arrière-pays marginalisé. Une structure qui, malgré les réformes, perdure aujourd’hui.
Quatre racines de disparité
Le dynamisme industriel et des services a porté l’économie nationale, avec des secteurs phares comme l’automobile et l’aéronautique, mais ces pôles, largement implantés dans les métropoles littorales, génèrent peu de retombées sur le reste du pays, note le policy brief. À l’inverse, l’agriculture, principal employeur dans les régions intérieures, demeure vulnérable aux aléas climatiques et peine à gagner en productivité. Le Maroc avance donc, mais à des vitesses très différentes selon les territoires, comme l’a bien exprimé SM le Roi lors de Son discours.
La même source précise que les effets d’entraînement attendus d’une croissance concentrée dans certains pôles n’ont pas eu lieu. Les infrastructures de transport, bien que modernisées, profitent d’abord aux zones côtières. Les échanges de biens, de capitaux et de savoirs entre les régions restent limités, freinant l’intégration des territoires périphériques à la dynamique nationale.
Et si la Constitution de 2011 avait fait de la «régionalisation avancée» un levier pour réduire les fractures territoriales, le processus reste néanmoins inabouti. Les régions manquent de ressources financières, de compétences administratives et d’autonomie réelle pour définir et mettre en œuvre leurs propres stratégies de développement. Pire, le rapport rappelle que certains observateurs estiment que la décentralisation telle qu’elle est appliquée a parfois renforcé les inégalités.
Le bout du tunnel ?
Ces déséquilibres ne sont pas spécifiques au Maroc, souligne le PCNS, qui affirme que de nombreux pays en développement connaissent la même dynamique avec des pôles moteurs qui tirent la croissance nationale, mais accentuent les écarts régionaux. Pour autant, la concentration urbaine reste une opportunité, à condition de savoir en redistribuer les bénéfices. Casablanca ou Tanger ne sont pas seulement des symboles d’inégalités, mais aussi des foyers de dynamisme dont l’impact pourrait irriguer l’ensemble du pays, précise-t-on de même source.
Cela suppose de créer de véritables espaces économiques interconnectés. Les politiques publiques doivent, selon le rapport, encourager les complémentarités entre régions, développer des chaînes de valeur communes et renforcer les liens logistiques et technologiques. Les investissements en infrastructures ne doivent plus se limiter aux grands axes autoroutiers ou portuaires, mais s’étendre aux routes transversales et aux zones encore mal desservies, y compris dans le numérique. Un autre levier central est celui de la formation et de l’emploi. Le rapport recommande d’adapter les programmes de formation professionnelle aux réalités économiques de chaque territoire, en rapprochant les établissements de formation des bassins d’activité et en favorisant des partenariats entre écoles et entreprises locales.
En outre, la réussite d’un développement territorial inclusif dépendra de la gouvernance. Les Conseils régionaux doivent devenir de véritables acteurs de développement, capables de définir leurs priorités et d’innover dans leurs politiques. Le rôle de l’État central serait alors de fixer les grandes orientations stratégiques, tout en laissant aux régions la liberté de mettre en œuvre leurs propres solutions, dans un cadre d’évaluation clair et transparent.
Le brief alerte sur le fait que le pays risque de se retrouver dans un «piège spatial», où la croissance nationale stagne non pas par manque d’investissements ou d’innovation, mais parce que ses bénéfices restent confinés aux grandes métropoles. Dans cette perspective, réduire les fractures régionales n’est pas seulement une exigence sociale, mais un impératif pour garantir la soutenabilité et l’inclusivité du développement marocain.
Quatre racines de disparité
Le dynamisme industriel et des services a porté l’économie nationale, avec des secteurs phares comme l’automobile et l’aéronautique, mais ces pôles, largement implantés dans les métropoles littorales, génèrent peu de retombées sur le reste du pays, note le policy brief. À l’inverse, l’agriculture, principal employeur dans les régions intérieures, demeure vulnérable aux aléas climatiques et peine à gagner en productivité. Le Maroc avance donc, mais à des vitesses très différentes selon les territoires, comme l’a bien exprimé SM le Roi lors de Son discours.
La même source précise que les effets d’entraînement attendus d’une croissance concentrée dans certains pôles n’ont pas eu lieu. Les infrastructures de transport, bien que modernisées, profitent d’abord aux zones côtières. Les échanges de biens, de capitaux et de savoirs entre les régions restent limités, freinant l’intégration des territoires périphériques à la dynamique nationale.
Et si la Constitution de 2011 avait fait de la «régionalisation avancée» un levier pour réduire les fractures territoriales, le processus reste néanmoins inabouti. Les régions manquent de ressources financières, de compétences administratives et d’autonomie réelle pour définir et mettre en œuvre leurs propres stratégies de développement. Pire, le rapport rappelle que certains observateurs estiment que la décentralisation telle qu’elle est appliquée a parfois renforcé les inégalités.
Le bout du tunnel ?
Ces déséquilibres ne sont pas spécifiques au Maroc, souligne le PCNS, qui affirme que de nombreux pays en développement connaissent la même dynamique avec des pôles moteurs qui tirent la croissance nationale, mais accentuent les écarts régionaux. Pour autant, la concentration urbaine reste une opportunité, à condition de savoir en redistribuer les bénéfices. Casablanca ou Tanger ne sont pas seulement des symboles d’inégalités, mais aussi des foyers de dynamisme dont l’impact pourrait irriguer l’ensemble du pays, précise-t-on de même source.
Cela suppose de créer de véritables espaces économiques interconnectés. Les politiques publiques doivent, selon le rapport, encourager les complémentarités entre régions, développer des chaînes de valeur communes et renforcer les liens logistiques et technologiques. Les investissements en infrastructures ne doivent plus se limiter aux grands axes autoroutiers ou portuaires, mais s’étendre aux routes transversales et aux zones encore mal desservies, y compris dans le numérique. Un autre levier central est celui de la formation et de l’emploi. Le rapport recommande d’adapter les programmes de formation professionnelle aux réalités économiques de chaque territoire, en rapprochant les établissements de formation des bassins d’activité et en favorisant des partenariats entre écoles et entreprises locales.
En outre, la réussite d’un développement territorial inclusif dépendra de la gouvernance. Les Conseils régionaux doivent devenir de véritables acteurs de développement, capables de définir leurs priorités et d’innover dans leurs politiques. Le rôle de l’État central serait alors de fixer les grandes orientations stratégiques, tout en laissant aux régions la liberté de mettre en œuvre leurs propres solutions, dans un cadre d’évaluation clair et transparent.
Le brief alerte sur le fait que le pays risque de se retrouver dans un «piège spatial», où la croissance nationale stagne non pas par manque d’investissements ou d’innovation, mais parce que ses bénéfices restent confinés aux grandes métropoles. Dans cette perspective, réduire les fractures régionales n’est pas seulement une exigence sociale, mais un impératif pour garantir la soutenabilité et l’inclusivité du développement marocain.
3 questions à Jawad Nouhi : « Malgré les plans, le Maroc reste un pays à deux vitesses »
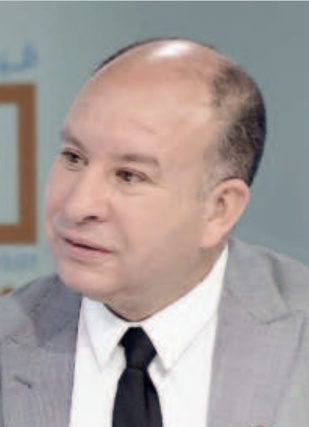
Professeur à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Rabat-Agdal, Jawad Nouhi a répondu à nos questions.
- Quel état des lieux peut-on dresser de la justice spatiale au Maroc ?
La justice spatiale est aujourd’hui un levier essentiel pour corriger les déséquilibres territoriaux. Elle vise à assurer une répartition équitable des ressources, des services publics et des opportunités de développement sur l’ensemble du territoire national. Au fil des années, différents gouvernements ont lancé des programmes pour réduire les inégalités sociales et territoriales. Il s’agit en l’occurrence du désenclavement du monde rural, de l’amélioration de l’accès aux services essentiels et de la création d’activités économiques pour freiner l’exode rural. Cependant, faute d’avoir intégré la justice spatiale comme principe structurant, ces projets n’ont pas produit les résultats attendus. Les indicateurs montrent encore un Maroc à deux vitesses avec trois régions qui concentrent l’essentiel des investissements, des services et des infrastructures, tandis que d’autres demeurent fortement marginalisées. Même à l’intérieur d’une même région, les écarts entre centres urbains et zones périphériques restent considérables.
- Le Souverain a donné Ses Hautes Orientations au gouvernement pour élaborer une nouvelle génération de programmes de développement territorial. Comment peut-on réussir cette étape ?
L’approche prônée par Sa Majesté le Roi consiste à faire de la dimension territoriale un levier central du développement rural. Elle implique de passer d’une logique verticale, où l’État demeure l’acteur principal, à une logique plus décentralisée, donnant aux régions un rôle actif dans la conception et la mise en œuvre des projets. Cette nouvelle dynamique suppose l’instauration d’une véritable politique publique intégrée en faveur du monde rural, axée sur l’amélioration des indicateurs de développement humain, la réduction de la pauvreté et la création d’opportunités économiques locales. Un élément clé de cette politique est l’instauration d’un «contrat territorial» entre les citoyens et les acteurs politiques, reposant sur des agendas de développement propres à chaque région, élaborés à partir de la réalité économique et sociale locale.
- Quelle approche territoriale locale peut-on développer pour renforcer la création de richesse dans les régions ?
Il est indispensable de passer d’une logique de développement centrée sur l’échelle nationale à une véritable approche territoriale et locale. Cela suppose de mieux prendre en compte les spécificités des milieux rural et urbain, leurs atouts respectifs et leurs besoins réels, lors de la conception et de la mise en œuvre des programmes. Cette logique doit s’appliquer non seulement entre les régions, mais aussi à l’intérieur de chaque région. Dans cette perspective, il s’agit de renforcer le rôle de l’agriculture comme moteur du développement économique et social, tout en accordant une attention particulière à l’investissement dans le capital humain. Parallèlement, la diversification des activités économiques en milieu rural doit être encouragée, notamment par la création de zones industrielles dédiées aux industries agroalimentaires à forte valeur ajoutée.
HCP : Des régions avancent… d’autres peinent à suivre
Les écarts se retrouvent d’abord dans la répartition de la richesse. Trois régions – Casablanca-Settat (32,2% du PIB), Rabat-Salé-Kénitra (15,7%) et Tanger-Tétouan-Al Hoceima (10,6%) – concentrent à elles seules près de 60% du PIB national. Le contraste est encore plus marqué au regard du PIB par habitant : 89.533 dirhams à Dakhla-Oued Eddahab contre une moyenne nationale de 40.508 dirhams.
Dans ce paysage contrasté, certaines régions tirent leur épingle du jeu. Dakhla-Oued Eddahab enregistre une croissance record de 10,1%, portée par la pêche et le BTP, suivie par Fès-Meknès (+8,9%) grâce à l’agriculture et aux services, et Marrakech-Safi (+6,3%) dopée par le tourisme. Casablanca-Settat et Tanger-Tétouan-Al Hoceima confirment leur rôle de locomotives industrielles et logistiques, avec des croissances proches de 5%.
À l’opposé, des territoires comme Laâyoune-Sakia El Hamra (2,9%), Souss-Massa (1,8%) ou Drâa-Tafilalet (1,5%) progressent timidement. Plus préoccupant encore, Béni Mellal-Khénifra (-1,3%) et l’Oriental (-1%) enregistrent un recul, conséquence directe de la vulnérabilité de leurs économies agricoles.
Dans ce paysage contrasté, certaines régions tirent leur épingle du jeu. Dakhla-Oued Eddahab enregistre une croissance record de 10,1%, portée par la pêche et le BTP, suivie par Fès-Meknès (+8,9%) grâce à l’agriculture et aux services, et Marrakech-Safi (+6,3%) dopée par le tourisme. Casablanca-Settat et Tanger-Tétouan-Al Hoceima confirment leur rôle de locomotives industrielles et logistiques, avec des croissances proches de 5%.
À l’opposé, des territoires comme Laâyoune-Sakia El Hamra (2,9%), Souss-Massa (1,8%) ou Drâa-Tafilalet (1,5%) progressent timidement. Plus préoccupant encore, Béni Mellal-Khénifra (-1,3%) et l’Oriental (-1%) enregistrent un recul, conséquence directe de la vulnérabilité de leurs économies agricoles.
Inclusion économique : Quatre leviers de développement
Pour Dr Khalid Laraki, expert de l'AIEA, l’intégration progressive des régions sous-performantes au tissu économique national représente une opportunité stratégique pour asseoir un modèle de développement plus inclusif, équilibré et durable à l’échelle du Royaume. Il propose ainsi quatre leviers fondamentaux :
1. Renforcer les infrastructures
Il est essentiel de prioriser des investissements conséquents dans les infrastructures de transport, d’énergie et de communication, notamment dans les régions périphériques. Une meilleure connectivité facilitera les échanges commerciaux, attirera les investissements et intégrera davantage ces territoires aux dynamiques économiques nationales et internationales.
2. Soutenir l’industrialisation
La promotion de l’industrialisation, particulièrement dans des secteurs porteurs tels que l’agro-industrie, les énergies renouvelables ou encore la transformation des produits locaux, constitue un levier de diversification économique. Elle permettra également la création d’emplois durables et contribuera à dynamiser les régions les moins développées.
3. Stimuler l’innovation
Le développement des technologies numériques, l’appui aux start-ups locales et l’introduction de solutions innovantes dans les secteurs agricoles et artisanaux représentent un vecteur de modernisation économique. La digitalisation des entreprises régionales renforcera leur compétitivité et facilitera l’accès aux marchés internationaux.
4. Encourager les partenariats public-privé
Les partenariats entre les secteurs public et privé sont indispensables pour mobiliser des financements, notamment privés, en faveur de projets d’envergure dans les régions en retard de développement. Ils permettent non seulement d’accélérer la mise en œuvre des infrastructures, mais aussi de garantir une répartition plus équitable des ressources et des bénéfices générés.
1. Renforcer les infrastructures
Il est essentiel de prioriser des investissements conséquents dans les infrastructures de transport, d’énergie et de communication, notamment dans les régions périphériques. Une meilleure connectivité facilitera les échanges commerciaux, attirera les investissements et intégrera davantage ces territoires aux dynamiques économiques nationales et internationales.
2. Soutenir l’industrialisation
La promotion de l’industrialisation, particulièrement dans des secteurs porteurs tels que l’agro-industrie, les énergies renouvelables ou encore la transformation des produits locaux, constitue un levier de diversification économique. Elle permettra également la création d’emplois durables et contribuera à dynamiser les régions les moins développées.
3. Stimuler l’innovation
Le développement des technologies numériques, l’appui aux start-ups locales et l’introduction de solutions innovantes dans les secteurs agricoles et artisanaux représentent un vecteur de modernisation économique. La digitalisation des entreprises régionales renforcera leur compétitivité et facilitera l’accès aux marchés internationaux.
4. Encourager les partenariats public-privé
Les partenariats entre les secteurs public et privé sont indispensables pour mobiliser des financements, notamment privés, en faveur de projets d’envergure dans les régions en retard de développement. Ils permettent non seulement d’accélérer la mise en œuvre des infrastructures, mais aussi de garantir une répartition plus équitable des ressources et des bénéfices générés.














![Disparités régionales : Miroirs réfractaires d’un Maroc à plusieurs vitesses [INTÉGRAL] Disparités régionales : Miroirs réfractaires d’un Maroc à plusieurs vitesses [INTÉGRAL]](https://www.lopinion.ma/photo/art/grande/91452154-64288698.jpg?v=1759314579)
![Disparités régionales : Miroirs réfractaires d’un Maroc à plusieurs vitesses [INTÉGRAL] Disparités régionales : Miroirs réfractaires d’un Maroc à plusieurs vitesses [INTÉGRAL]](https://www.lopinion.ma/photo/art/default/91452154-64288698.jpg?v=1759314580)
![Disparités régionales : Miroirs réfractaires d’un Maroc à plusieurs vitesses [INTÉGRAL] Disparités régionales : Miroirs réfractaires d’un Maroc à plusieurs vitesses [INTÉGRAL]](https://www.lopinion.ma/photo/art/grande/91452154-64288737.jpg?v=1759314436)
![Disparités régionales : Miroirs réfractaires d’un Maroc à plusieurs vitesses [INTÉGRAL] Disparités régionales : Miroirs réfractaires d’un Maroc à plusieurs vitesses [INTÉGRAL]](https://www.lopinion.ma/photo/art/default/91452154-64288737.jpg?v=1759314437)