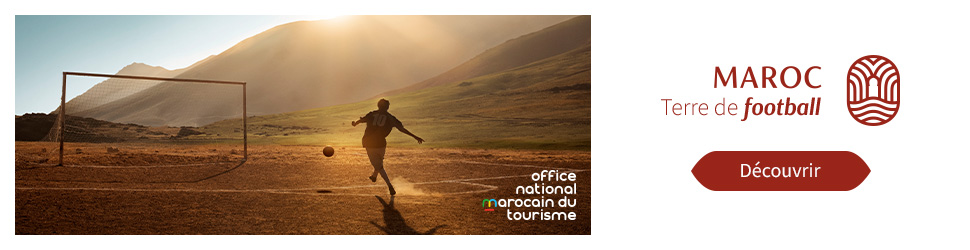C’est ce que révèle un nouveau rapport publié par l’association SimSim – Participation Citoyenne, en partenariat avec l'Association Pionniers du Changement pour le développement et la culture, qui dresse un état des lieux préoccupant de la mise en œuvre concrète de ce texte pourtant essentiel à la transparence de l’action publique.
Entre juillet 2023 et janvier 2024, les deux associations ont supervisé le dépôt de 102 demandes normalisées d’accès à l’information auprès de 60 institutions publiques et collectivités territoriales, via la plateforme numérique Chafafiya. Le constat est sans appel : seulement 34 demandes ont reçu une réponse, soit un taux de satisfaction de 33 %.
Pis encore, près de la moitié de ces réponses sont parvenues en dehors du délai légal prévu par la loi (20 jours ouvrables, prorogeables à 40 jours dans certains cas). Le délai moyen de réponse enregistré est de 50 jours ouvrable, avec des extrêmes atteignant jusqu’à 160 jours, témoignant d’un non-respect généralisé des prescriptions réglementaires.
Sur les 102 demandes envoyées, 67 ont été adressées à des collectivités territoriales, 24 à des établissements ou entreprises publics, et 11 à des administrations centrales. Ce choix visait à tester l’application de la loi aussi bien à l’échelon local que national.
Le rapport pointe que la majorité des entités interrogées ne disposent pas d’un référent désigné pour le traitement des demandes, comme le prévoit pourtant la législation. Cette lacune structurelle engendre une absence de procédures internes claires, ralentissant, voire empêchant le traitement des requêtes citoyennes.
Entre juillet 2023 et janvier 2024, les deux associations ont supervisé le dépôt de 102 demandes normalisées d’accès à l’information auprès de 60 institutions publiques et collectivités territoriales, via la plateforme numérique Chafafiya. Le constat est sans appel : seulement 34 demandes ont reçu une réponse, soit un taux de satisfaction de 33 %.
Pis encore, près de la moitié de ces réponses sont parvenues en dehors du délai légal prévu par la loi (20 jours ouvrables, prorogeables à 40 jours dans certains cas). Le délai moyen de réponse enregistré est de 50 jours ouvrable, avec des extrêmes atteignant jusqu’à 160 jours, témoignant d’un non-respect généralisé des prescriptions réglementaires.
Sur les 102 demandes envoyées, 67 ont été adressées à des collectivités territoriales, 24 à des établissements ou entreprises publics, et 11 à des administrations centrales. Ce choix visait à tester l’application de la loi aussi bien à l’échelon local que national.
Le rapport pointe que la majorité des entités interrogées ne disposent pas d’un référent désigné pour le traitement des demandes, comme le prévoit pourtant la législation. Cette lacune structurelle engendre une absence de procédures internes claires, ralentissant, voire empêchant le traitement des requêtes citoyennes.
Réponses complètes : Une minorité de bons élèves
Parmi les 34 réponses obtenues, seules 11 ont été jugées complètes et de qualité satisfaisante. Ces réponses émanent d’institutions aussi diverses que le ministère délégué auprès du Chef du gouvernement chargé de la Transition numérique, la commune de Tiznit, le Conseil régional de l’Oriental, la Présidence du Ministère public, la Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA) ou encore la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT).
Ces bonnes pratiques, bien que minoritaires, démontrent, selon le rapport, que l’application de la loi 31.13 est possible, à condition d’une volonté institutionnelle forte et d’une organisation administrative adaptée.
Adoptée en 2018 et entrée en vigueur en mars 2019, la loi 31.13 a été saluée comme un jalon démocratique important. Elle consacre le droit de tout citoyen d’accéder aux informations détenues par les administrations publiques, les collectivités territoriales, les établissements publics, les instances constitutionnelles et les entreprises chargées d’un service public.
Mais les six années écoulées n’ont pas permis d’ancrer ce droit dans les pratiques administratives quotidiennes. Les auteurs du rapport relèvent notamment l’absence de culture de transparence, la peur institutionnelle de partager l’information, ainsi qu’une méconnaissance persistante des obligations légales de la part des agents publics.
Ce déficit d’accès à l’information constitue un obstacle majeur à la bonne gouvernance, à la participation citoyenne et à la redevabilité de l’État. Il compromet également les engagements internationaux du Maroc, notamment en matière de transparence budgétaire, de lutte contre la corruption et de respect des principes démocratiques énoncés dans la Constitution de 2011.
Les auteurs du rapport rappellent que le droit à l’information est un levier de transformation des rapports entre administration et citoyens, et non un simple outil technique. Il contribue à rétablir la confiance dans l’institution publique et à garantir un contrôle citoyen effectif sur les politiques publiques.
Ces bonnes pratiques, bien que minoritaires, démontrent, selon le rapport, que l’application de la loi 31.13 est possible, à condition d’une volonté institutionnelle forte et d’une organisation administrative adaptée.
Adoptée en 2018 et entrée en vigueur en mars 2019, la loi 31.13 a été saluée comme un jalon démocratique important. Elle consacre le droit de tout citoyen d’accéder aux informations détenues par les administrations publiques, les collectivités territoriales, les établissements publics, les instances constitutionnelles et les entreprises chargées d’un service public.
Mais les six années écoulées n’ont pas permis d’ancrer ce droit dans les pratiques administratives quotidiennes. Les auteurs du rapport relèvent notamment l’absence de culture de transparence, la peur institutionnelle de partager l’information, ainsi qu’une méconnaissance persistante des obligations légales de la part des agents publics.
Ce déficit d’accès à l’information constitue un obstacle majeur à la bonne gouvernance, à la participation citoyenne et à la redevabilité de l’État. Il compromet également les engagements internationaux du Maroc, notamment en matière de transparence budgétaire, de lutte contre la corruption et de respect des principes démocratiques énoncés dans la Constitution de 2011.
Les auteurs du rapport rappellent que le droit à l’information est un levier de transformation des rapports entre administration et citoyens, et non un simple outil technique. Il contribue à rétablir la confiance dans l’institution publique et à garantir un contrôle citoyen effectif sur les politiques publiques.