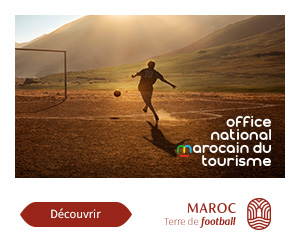La question n’est plus si l’IA doit faire partie de la formation médicale, mais comment l’intégrer de manière éthique, critique et centrée sur le patient. C’est là que se révèle un enjeu crucial : la résistance culturelle et professionnelle d’une partie du corps enseignant et médical.
Dans mes recherches sur l’acceptation des technologies de e-santé, j’ai identifié des facteurs clés d’acceptabilité : perception d’une utilité clinique réelle, facilité d’usage, fiabilité et transparence des algorithmes, et alignement avec les valeurs du soin. Ces conditions, rarement réunies, expliquent pourquoi, même face à des outils performants, une partie des professeurs et cliniciens restent sceptiques.
Lors d’une observation menée à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, un dispositif intelligent d’aide au suivi des patients diabétiques a rencontré une forte réticence. Non pas par peur irrationnelle de la technologie, mais par souci de préserver le rôle décisionnel du médecin, éviter la surcharge cognitive d’outils mal intégrés, et refuser l’opacité des critères de décision. Cette prudence, loin d’être un frein, est une forme de vigilance professionnelle.
Cette résistance ou cette adoption ne se vit pas de manière uniforme. J’ai été témoin de deux situations révélatrices. La première concerne un spécialiste renommé, doté d’une solide réputation clinique, qui utilise désormais DeepSeek pour vérifier ses connaissances et explorer de nouvelles pistes avant de poser un diagnostic. Loin de craindre que l’IA « pense à sa place », il s’en sert comme un second regard, un outil d’augmentation de son expertise, qu’il confronte toujours à son jugement médical.
La seconde situation, à l’opposé, est celle d’une praticienne chevronnée qui m’a confié, avec une pointe d’amertume : « Il ne me reste plus qu’à me mettre à la retraite… Franchement, cher ami, l’IA me fait peur. » Dans son esprit, l’IA n’est pas un allié, mais une force déstabilisante, annonciatrice d’un monde médical dans lequel elle ne se reconnaît plus.
Ces deux témoignages illustrent la diversité des attitudes face à l’IA : pour certains, elle représente un prolongement naturel de l’effort d’apprentissage et d’actualisation des connaissances ; pour d’autres, elle incarne une rupture brutale avec un univers professionnel bâti sur des décennies de pratique humaine.
En milieu académique marocain, la situation est similaire : une partie des professeurs perçoivent l’IA comme un raccourci cognitif dévalorisant l’effort intellectuel, ou comme une intrusion dans le lien maître–élève. Résultat : des programmes de médecine où l’IA reste absente ou cantonnée à un module optionnel, alors même que les étudiants l’utilisent déjà hors cadre officiel.
Or, l’intégration de l’IA dans l’éducation médicale ne vise pas à produire des diplômés férus de technologie, mais des cliniciens capables de penser de manière critique, d’agir de manière éthique et de s’adapter en continu. Cela suppose :
- Une refonte des curricula où l’IA est une compétence transversale, intégrée aux cours de sémiologie, de diagnostic, de santé publique et de bioéthique.
- Une formation continue obligatoire des enseignants pour les préparer à encadrer et guider l’usage de l’IA.
- Un cadre éthique national définissant les frontières entre assistance à l’apprentissage et substitution intellectuelle.
- Une souveraineté cognitive en santé, garantissant que les IA utilisées soient adaptées à nos données, nos langues et nos réalités cliniques.
L’IA ne doit pas remplacer le jugement clinique, mais créer un environnement où les étudiants apprennent à remettre en question, critiquer et contextualiser ses suggestions. La résistance actuelle des médecins et professeurs, si elle est comprise et accompagnée, peut devenir un levier de régulation et de qualité.
Refuser l’IA par crainte, c’est risquer de former des médecins du XXe siècle pour un système de santé du XXIe siècle. Mais l’imposer sans dialogue, c’est ignorer la richesse d’une culture médicale qui a toujours placé l’humain au centre. Entre ces deux écueils, il existe une voie marocaine : celle d’une adoption progressive, co-construite et souveraine, où l’IA devient un outil au service du savoir, du soin et du patient.
Dans mes recherches sur l’acceptation des technologies de e-santé, j’ai identifié des facteurs clés d’acceptabilité : perception d’une utilité clinique réelle, facilité d’usage, fiabilité et transparence des algorithmes, et alignement avec les valeurs du soin. Ces conditions, rarement réunies, expliquent pourquoi, même face à des outils performants, une partie des professeurs et cliniciens restent sceptiques.
Lors d’une observation menée à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, un dispositif intelligent d’aide au suivi des patients diabétiques a rencontré une forte réticence. Non pas par peur irrationnelle de la technologie, mais par souci de préserver le rôle décisionnel du médecin, éviter la surcharge cognitive d’outils mal intégrés, et refuser l’opacité des critères de décision. Cette prudence, loin d’être un frein, est une forme de vigilance professionnelle.
Cette résistance ou cette adoption ne se vit pas de manière uniforme. J’ai été témoin de deux situations révélatrices. La première concerne un spécialiste renommé, doté d’une solide réputation clinique, qui utilise désormais DeepSeek pour vérifier ses connaissances et explorer de nouvelles pistes avant de poser un diagnostic. Loin de craindre que l’IA « pense à sa place », il s’en sert comme un second regard, un outil d’augmentation de son expertise, qu’il confronte toujours à son jugement médical.
La seconde situation, à l’opposé, est celle d’une praticienne chevronnée qui m’a confié, avec une pointe d’amertume : « Il ne me reste plus qu’à me mettre à la retraite… Franchement, cher ami, l’IA me fait peur. » Dans son esprit, l’IA n’est pas un allié, mais une force déstabilisante, annonciatrice d’un monde médical dans lequel elle ne se reconnaît plus.
Ces deux témoignages illustrent la diversité des attitudes face à l’IA : pour certains, elle représente un prolongement naturel de l’effort d’apprentissage et d’actualisation des connaissances ; pour d’autres, elle incarne une rupture brutale avec un univers professionnel bâti sur des décennies de pratique humaine.
En milieu académique marocain, la situation est similaire : une partie des professeurs perçoivent l’IA comme un raccourci cognitif dévalorisant l’effort intellectuel, ou comme une intrusion dans le lien maître–élève. Résultat : des programmes de médecine où l’IA reste absente ou cantonnée à un module optionnel, alors même que les étudiants l’utilisent déjà hors cadre officiel.
Or, l’intégration de l’IA dans l’éducation médicale ne vise pas à produire des diplômés férus de technologie, mais des cliniciens capables de penser de manière critique, d’agir de manière éthique et de s’adapter en continu. Cela suppose :
- Une refonte des curricula où l’IA est une compétence transversale, intégrée aux cours de sémiologie, de diagnostic, de santé publique et de bioéthique.
- Une formation continue obligatoire des enseignants pour les préparer à encadrer et guider l’usage de l’IA.
- Un cadre éthique national définissant les frontières entre assistance à l’apprentissage et substitution intellectuelle.
- Une souveraineté cognitive en santé, garantissant que les IA utilisées soient adaptées à nos données, nos langues et nos réalités cliniques.
L’IA ne doit pas remplacer le jugement clinique, mais créer un environnement où les étudiants apprennent à remettre en question, critiquer et contextualiser ses suggestions. La résistance actuelle des médecins et professeurs, si elle est comprise et accompagnée, peut devenir un levier de régulation et de qualité.
Refuser l’IA par crainte, c’est risquer de former des médecins du XXe siècle pour un système de santé du XXIe siècle. Mais l’imposer sans dialogue, c’est ignorer la richesse d’une culture médicale qui a toujours placé l’humain au centre. Entre ces deux écueils, il existe une voie marocaine : celle d’une adoption progressive, co-construite et souveraine, où l’IA devient un outil au service du savoir, du soin et du patient.