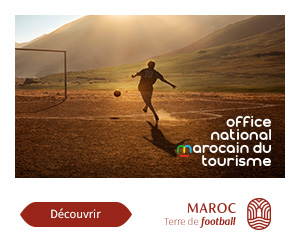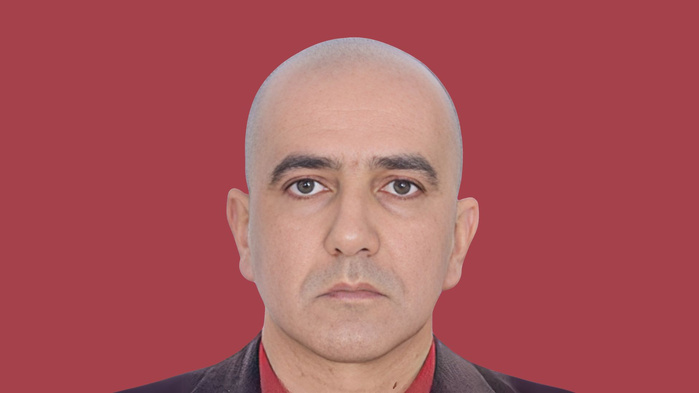
Dr Adil Loubbardi, doctorat en génétique moléculaire et physiologique / Commissaire Divisionnaire / Ex Responsable de la sécurité (police judiciaire, sécurité publique et application de la loi)
Nulle drogue n’incarne mieux la mondialisation de son usage que la cocaïne. Elle symbolise, du fait de son statut de drogue de la performance et de l’insertion, un certain esprit marqué par le culte de la compétition. Le développement de sa consommation à l’échelle de la planète après les États-Unis est d’ailleurs contemporain du développement des échanges commerciaux provoqués notamment par l’émergence de la Chine et l’intégration de l’ex-URSS au marché capitaliste mondial. Dès lors, les flux de son trafic suivent les grandes voies commerciales maritimes, tandis que son usage, autrefois réservé aux « élites » occidentales, se démocratise et touche aussi les consommateurs des pays du tiers monde.
Géopolitique de la cocaïne :
Jusqu’à la fin des années 1990, l’économie de la cocaïne ne possédait qu’une dimension régionale n’affectant quasiment que le continent américain. Si, en matière d’offre, la réalité n’a pas changé avec le monopole productif exercé par l’Amérique du Sud, essentiellement la Colombie, la Bolivie et le Pérou, la saturation puis la stagnation du marché des États-Unis a incité les organisations criminelles à réorienter les flux de production en direction de l’Europe occidentale. Selon les estimations de l’ONUDC (Office des Nations unies contre la drogue et le crime), compte tenu des saisies, ces deux régions représentent un peu plus de la moitié de la cocaïne consommée dans le monde.
C’est donc à une véritable mondialisation du marché et du trafic qu’on assiste aujourd’hui. La totalité des continents de la planète est concernée, y compris l’Afrique, qui s’insère de plus en plus, elle aussi, dans l’économie mondiale de la cocaïne. Pour atteindre un marché européen en pleine croissance, les organisations transnationales en charge du trafic diversifient les routes d’approvisionnement afin d’échapper aux dispositifs répressifs mis en place par l’Union européenne sur la façade atlantique et passent de plus en plus par l’ouest du continent africain.
L'essor de la route africaine
Le trafic de cocaïne vers l’Europe emprunte trois grandes voies.
Géopolitique de la cocaïne :
Jusqu’à la fin des années 1990, l’économie de la cocaïne ne possédait qu’une dimension régionale n’affectant quasiment que le continent américain. Si, en matière d’offre, la réalité n’a pas changé avec le monopole productif exercé par l’Amérique du Sud, essentiellement la Colombie, la Bolivie et le Pérou, la saturation puis la stagnation du marché des États-Unis a incité les organisations criminelles à réorienter les flux de production en direction de l’Europe occidentale. Selon les estimations de l’ONUDC (Office des Nations unies contre la drogue et le crime), compte tenu des saisies, ces deux régions représentent un peu plus de la moitié de la cocaïne consommée dans le monde.
C’est donc à une véritable mondialisation du marché et du trafic qu’on assiste aujourd’hui. La totalité des continents de la planète est concernée, y compris l’Afrique, qui s’insère de plus en plus, elle aussi, dans l’économie mondiale de la cocaïne. Pour atteindre un marché européen en pleine croissance, les organisations transnationales en charge du trafic diversifient les routes d’approvisionnement afin d’échapper aux dispositifs répressifs mis en place par l’Union européenne sur la façade atlantique et passent de plus en plus par l’ouest du continent africain.
L'essor de la route africaine
Le trafic de cocaïne vers l’Europe emprunte trois grandes voies.
- La voie qui part des Caraïbes via l’archipel des Açores pour atteindre les grands ports du nord de l’Europe (Rotterdam et Anvers).
- La voie qui part d’Amérique du Sud (Venezuela), et passe par le Cap-Vert, Madère et les Canaries.
- La voie africaine, laquelle est apparue récemment.
Depuis le début des années 2000, l’Afrique de l’Ouest constitue une zone de transit pour la cocaïne destinée à l'Europe, notamment via l’Espagne, qui est la principale porte d’entrée de la cocaïne en Europe, afin de contourner les dispositifs de sécurité mis en place par l’Union européenne. L’Afrique de l’Ouest (Guinée-Bissau, Sierra Leone, Liberia) est ainsi devenue une zone de rebond et de stockage pour les trafiquants latino-américains, qui acheminent la cocaïne par bateau ou par avion. Une fois arrivée en Afrique de l’Ouest, la cocaïne est réacheminée vers l’Europe en utilisant trois grandes voies.
- La voie maritime, par le biais de flottilles commerciales (conteneurs) ou privées.
- Le trafic aérien est utilisé, notamment via les « mules », par des personnes ingérant des boulettes de cocaïne ou la transportant tout simplement dans leurs bagages.
- La voie terrestre se développe également, notamment en longeant la côte atlantique par la Mauritanie et le Maroc.
Les trafiquants de cocaïne savent profiter de la véritable zone grise que forme cette région, qui englobe l’est de la Mauritanie, le nord du Mali, le Niger et le sud de l’Algérie. Cet immense espace recouvert par le Sahel et le Sahara est une zone quasi désertique, lieu de prédilection des contrebandiers d’armes, des trafiquants d’êtres humains, voire des groupes armés. Ce territoire du chaos, s’avère propice au transit de drogues.
Le Maroc zone de transit :
Le trafic de cocaïne utilise des filières qui doivent beaucoup aux groupes de contrebandiers galiciens. Leurs réseaux, traditionnellement impliqués dans l’importation de cigarettes, puis de cannabis, se sont illustrés dans le transbordement au large de cargaisons de cocaïne chargées dans les Antilles sur des bateaux de pêche ou des porte-conteneurs. La vigilance accrue des autorités espagnoles a poussé les Galiciens à faire transiter la cocaïne par le Maroc. La drogue est transbordée sur les bateaux des trafiquants
marocains au large des îles Canaries ou du Cap-Vert, centres de ravitaillement traditionnels pour les flottilles de pêche de l’Atlantique. Le débarquement a lieu sur les côtes portugaises ou andalouses, suivant les routes habituelles du cannabis.
Plus sophistiquée est la pratique qui consiste à décharger la drogue au Maroc, dans un port quelconque de la côte atlantique, puis à la dissimuler dans un transport routier international (TIR) empruntant un ferry à destination du Portugal ou de la Galice.
La seule affaire très importante révélée à ce jour est le résultat d'une avarie d'un bateau qui a conduit à la saisie de 6 tonnes de cocaïne pure, enveloppées dans des sacs étanches rejetés par la mer entre le 23 et le 30 juin 1997. La drogue, transbordée au large de Las Palmas (îles Canaries) à partir d’un navire colombien non identifié, avait été larguée au large d’El-Jadida et de Casablanca par l’équipage d’un bateau qui n’avait pu atteindre les côtes espagnoles ou portugaises, sa destination finale, en raison d’une panne de moteur. Les commanditaires étaient des Espagnols, dont l’un sera arrêté en Galice.
L'évolution de l'infrastructure économique, la mise en place d'autoroutes de zones franches et le développement de ports à dimension internationale ouvrent aux trafiquants une multitude de moyens de faire transiter la cocaïne vers l'Europe.
L'affaire de juin 1997 :
Juin 1997 sera une date historique dans les annales du trafic
international de cocaïne pour le Maroc. En effet, cette saisie, la plus importante jamais réalisée à ce jour, aura mis le doigt sur la méthodologie utilisée dorénavant par les trafiquants de drogue pour acheminer la cocaïne vers l'Europe, mais aussi bouleversera la région entière où les ballots de cocaïne non saisis par les autorités ont été récupérés par la population locale.
Des lors le Maroc entrera dans une nouvelle ère de pays de transit mais aussi de consommation et de trafic de cocaïne. Cette affaire fut le déclencheur de la mise en place des tous premiers dealers de coke qui mettront en place leurs réseaux locaux pour la distribution. Ensuite, des filières bien plus rodées prendront le relais en important d'autres quantités de drogues.
Le 24 juin 1997, des paquets de cocaïne échouent sur les plages de l'Atlantique. Une vaste opération de ratissage est immédiatement lancée sur la côte atlantique de Sidi Rahal (Casablanca) à Safi.
La saisie est inimaginable. Des dizaines de colis soigneusement empaquetés sont trouvés, totalisant près de 06 tonnes de cocaïne pure. La marée blanche qui venait de déferler sur les côtes marocaines atteignait l’exorbitante valeur de 1,5 milliard de dollars. Un plan national est déclenché. Des investigations tous azimuts sont menées par des équipes opérationnelles spéciales aussi bien sur le plan de l'enquête que technique et scientifique.
Les enquêteurs appréhendent le commandant du bateau «Duanas», un ressortissant colombien porteur d’un passeport panaméen. À la tête d’un équipage de 4 marins d’origine espagnole, mais porteurs de passeports sud-
américains. Une panne mécanique immobilise le bateau au large des côtes marocaines et l’équipage décide de se débarrasser de la cargaison par peur des contrôles.
La cargaison de cocaïne était destinée à un ressortissant espagnol, trafiquant connu des services de lutte anti-drogue. Elle devait être acheminée vers le nord de l’Espagne, au niveau de la frontière portugaise.
Nouvelle ère
Suite à cette affaire, les quelques individus qui ont pu dissimuler des quantités de cocaïne pure se sont transformés en des dealers locaux qui, intéressés par le bénéfice qu'ils pouvaient tirer de cette aubaine, ont mis en place de petits réseaux de revente de cocaïne. Dès lors, des soirées privées étaient organisées en secret pour l'initiation, car, à ce jour, la consommation de ce type de drogue était presque inexistante.
Le relais a vite été pris par les réseaux de cannabis déjà installés dans la zone de naufrage des ballots. Ainsi, de nouveaux dealers sont apparus aux alentours des boîtes de nuit et clubs des villes les plus proches.
La grande métropole qu'est Casablanca, capitale économique, s'est vite accaparée de la majorité de la cocaïne écoulée. Les premières arrestations pour détention et consommation de cocaïne concernaient les habitués des virées nocturnes et acolytes des boîtes de nuit et cabarets.
Les enquêtes policières ont vite pu identifier les dealers et remonter à l'origine de la cocaïne qui venait de la côte de l'arrière-pays.
Ce fut là une nouvelle ère de trafic de cocaïne qui allait débuter, menant à une expansion, voire à un bouleversement de la cartographie du trafic de drogue en général, avec l'apparition de nouveaux barons.

Graphique sur l'évolution des des saisies de cocaïne au Maroc depuis 1995