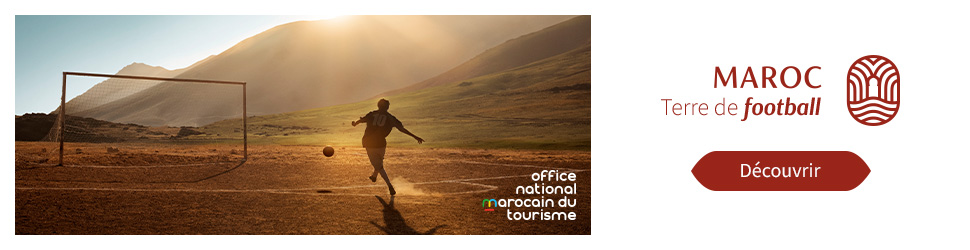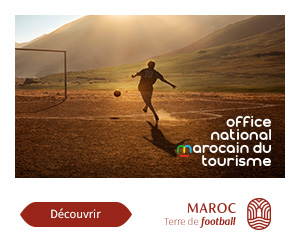Le 9 juillet 2025, la ministre de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Mme Amel Falah Seghrouchni, a annoncé la construction à Dakhla d’un centre de données de 500 mégawatts, alimenté entièrement par les énergies renouvelables. Une annonce spectaculaire, présentée comme une « révolution technologique et énergétique ». Mais en croisant cette déclaration avec les fondements d’une transformation numérique cohérente et souveraine, telle que je la développe dans mon ouvrage, des écarts flagrants apparaissent entre l’ambition affichée, les réalités du terrain et les exigences de gouvernance systémique.
Dans mon livre, je défends l’idée que la souveraineté numérique ne repose pas sur des annonces isolées, aussi ambitieuses soient-elles, mais sur un écosystème solide, articulé, inscrit dans le réel : infrastructures, compétences, normes, gouvernance, budget, ancrage territorial et transparence. L’annonce d’un centre de données de 500 MW – soit plus de 10 % de la consommation électrique nationale – sans partenaires industriels, sans documentation technique, sans budget ni articulation avec l’écosystème numérique marocain existant, met en lumière une dérive que j’ai nommée dans mes écrits : le technosloganisme, cette tentation de substituer les mots aux systèmes.
Le modèle systémique que je propose pour penser l’IA et le numérique au Maroc repose sur l’alignement entre vision politique, capacités institutionnelles, maturité technologique et attentes sociétales. Ici, nous avons un cas typique de désalignement : vision ambitieuse mais sans adossement réel à des capacités locales ; localisation géostratégique (Dakhla), mais sans logique d’intégration territoriale ou régionale explicite ; absence de feuille de route nationale sur les data centers, alors même que ce secteur est vital pour la souveraineté des données, la cybersécurité et l'économie numérique. La cohérence systémique implique que les annonces soient l’aboutissement d’un processus collectif, pas un acte isolé à visée symbolique.
Dans « L’intelligence artificielle au Maroc », je plaide pour une gouvernance numérique responsable, fondée sur la transparence, la participation, l’évaluation ex ante et ex post des projets publics. Une infrastructure d’une telle ampleur, consommant l’équivalent énergétique d’une ville moyenne, devrait être délibérée publiquement ; être adossée à une autorité de régulation numérique indépendante ; s’inscrire dans une logique de co-développement régional ; être documentée et évaluée en termes de soutenabilité, de résilience, et de gouvernance.
Construire un centre de données « vert » dans le désert ne suffit pas à propulser le Maroc dans le club des nations numériques souveraines. Sans infrastructure électrique sécurisée, sans connexion internationale robuste, sans main-d’œuvre formée localement, sans réseau d’universités et de startups en appui, un tel projet risque de rester un mirage. Comme je le rappelle dans mes travaux, le numérique n’est pas un raccourci magique vers la modernité. Il est un processus lent, systémique, exigeant, inclusif.
Il est compréhensible que Dakhla soit utilisée comme vitrine politique et diplomatique, à la croisée des enjeux sahariens et africains. Mais il serait contre-productif de réduire cet espace à une scène de mise en récit technologique, sans fondation industrielle ou humaine réelle. Le Maroc ne peut pas se permettre de sacrifier sa crédibilité stratégique au profit de coups d’éclat communicants, surtout à un moment où sa diplomatie numérique est en construction.
Le projet d’un centre de données de 500 MW à Dakhla ne peut être crédible que s’il est rattaché à une vision systémique, transparente, souveraine et inclusive du numérique. Il ne s’agit pas de freiner les ambitions. Mais de les encadrer, structurer, inscrire dans le réel. À défaut, nous risquons de confondre innovation et illusion, et de transformer un levier stratégique en simple décor de communication.
Dans mon livre, je défends l’idée que la souveraineté numérique ne repose pas sur des annonces isolées, aussi ambitieuses soient-elles, mais sur un écosystème solide, articulé, inscrit dans le réel : infrastructures, compétences, normes, gouvernance, budget, ancrage territorial et transparence. L’annonce d’un centre de données de 500 MW – soit plus de 10 % de la consommation électrique nationale – sans partenaires industriels, sans documentation technique, sans budget ni articulation avec l’écosystème numérique marocain existant, met en lumière une dérive que j’ai nommée dans mes écrits : le technosloganisme, cette tentation de substituer les mots aux systèmes.
Le modèle systémique que je propose pour penser l’IA et le numérique au Maroc repose sur l’alignement entre vision politique, capacités institutionnelles, maturité technologique et attentes sociétales. Ici, nous avons un cas typique de désalignement : vision ambitieuse mais sans adossement réel à des capacités locales ; localisation géostratégique (Dakhla), mais sans logique d’intégration territoriale ou régionale explicite ; absence de feuille de route nationale sur les data centers, alors même que ce secteur est vital pour la souveraineté des données, la cybersécurité et l'économie numérique. La cohérence systémique implique que les annonces soient l’aboutissement d’un processus collectif, pas un acte isolé à visée symbolique.
Dans « L’intelligence artificielle au Maroc », je plaide pour une gouvernance numérique responsable, fondée sur la transparence, la participation, l’évaluation ex ante et ex post des projets publics. Une infrastructure d’une telle ampleur, consommant l’équivalent énergétique d’une ville moyenne, devrait être délibérée publiquement ; être adossée à une autorité de régulation numérique indépendante ; s’inscrire dans une logique de co-développement régional ; être documentée et évaluée en termes de soutenabilité, de résilience, et de gouvernance.
Construire un centre de données « vert » dans le désert ne suffit pas à propulser le Maroc dans le club des nations numériques souveraines. Sans infrastructure électrique sécurisée, sans connexion internationale robuste, sans main-d’œuvre formée localement, sans réseau d’universités et de startups en appui, un tel projet risque de rester un mirage. Comme je le rappelle dans mes travaux, le numérique n’est pas un raccourci magique vers la modernité. Il est un processus lent, systémique, exigeant, inclusif.
Il est compréhensible que Dakhla soit utilisée comme vitrine politique et diplomatique, à la croisée des enjeux sahariens et africains. Mais il serait contre-productif de réduire cet espace à une scène de mise en récit technologique, sans fondation industrielle ou humaine réelle. Le Maroc ne peut pas se permettre de sacrifier sa crédibilité stratégique au profit de coups d’éclat communicants, surtout à un moment où sa diplomatie numérique est en construction.
Le projet d’un centre de données de 500 MW à Dakhla ne peut être crédible que s’il est rattaché à une vision systémique, transparente, souveraine et inclusive du numérique. Il ne s’agit pas de freiner les ambitions. Mais de les encadrer, structurer, inscrire dans le réel. À défaut, nous risquons de confondre innovation et illusion, et de transformer un levier stratégique en simple décor de communication.