Accessible, nutritif et apprécié même par les gourmets, le thon en conserve s’est imposé -sous nos cieux, comme ailleurs- dans l’alimentation quotidienne des familles et figure régulièrement dans les menus des cantines, notamment scolaires. Il n’est donc pas surprenant que la récente interpellation du gouvernement par un Conseiller parlementaire sur les risques de présence de métaux lourds dans les conserves de thon suscite des questions. Dans son alerte, Abderrahmane Al Ouafa, membre de la Chambre des Conseillers, s’est appuyé sur des études européennes menées par les ONG Bloom et Foodwatch qui ont révélé des teneurs de mercure dans des boîtes de thon vendues sur plusieurs marchés européens, appelant à des contrôles renforcés et à une information plus transparente du consommateur. Pour le Conseiller parlementaire, la question renvoie à un risque réel et bien documenté à l’international, celui de la bioaccumulation de métaux lourds dans les grands poissons marins prédateurs comme le thon.
Alertes internationales
Ce phénomène préoccupant, qui touche tous les écosystèmes marins du globe, impose aux autorités et aux producteurs de redoubler de vigilance pour protéger les populations vulnérables et préserver la crédibilité de toute la filière. Il convient toutefois de préciser que les campagnes menées en Europe par Bloom et Foodwatch n’ont pas spécifiquement testé de conserves marocaines : leurs analyses, publiées fin 2024, portaient sur près de 150 boîtes achetées en France, Espagne, Italie, Allemagne et Belgique et ont montré que 100% contenaient du mercure et que 10% dépassaient 1 mg/kg (seuil maximal fixé par l’UE pour le thon frais). L’absence de données marocaines récentes et accessibles sur les conserves commercialisées localement ou exportées crée donc un angle mort qui ne permet ni de confirmer ni d’infirmer l’existence d’un risque similaire au Maroc, d’où l’importance d’analyses indépendantes et d’une publication régulière des résultats par les autorités et les acteurs concernés, notamment industriels.
Cadre marocain
Le Royaume dispose cependant d’un dispositif réglementaire censé encadrer ce risque. L’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) fixe ainsi depuis plusieurs années des seuils proches des standards internationaux (1 mg/kg en teneur maximale de mercure autorisée pour les grands prédateurs marins comme le thon et 0,5 mg/kg pour les espèces non prédatrices) et réalise des contrôles sur les lots destinés au marché local et à l’export. Entre 2010 et 2016, le Centre antipoison et de pharmacovigilance a publié des données qui montrent des valeurs globalement inférieures à ces limites mais plus élevées chez les espèces prédatrices. Ces chiffres, aujourd’hui anciens, illustrent que le problème est suivi mais soulignent la nécessité d’actualiser et, surtout, de rendre publics les résultats des analyses pour que le consommateur, les opérateurs et les marchés étrangers disposent d’une image claire et actuelle de la situation.
Accès aux données
Les conserveries marocaines sont soumises à des agréments sanitaires et à des audits pour répondre aux exigences de l’Union Européenne, du Codex Alimentarius et d’autres marchés, ce qui implique des dispositifs d’autocontrôle, de traçabilité et de certification qualité. Ces mécanismes constituent un socle utile mais ne suffisent pas, à eux seuls, à garantir l’absence de risques : leur efficacité réelle dépend de contrôles publics réguliers, indépendants et transparents. En l’absence de données récentes et publiquement accessibles sur les niveaux de métaux lourds dans le thon en conserve marocain, l’alerte d’Abderrahmane Al Ouafa souligne que la priorité doit rester la santé du consommateur et la crédibilité scientifique des institutions chargées de la surveillance. Renforcer et publier les analyses, informer clairement le public et actualiser les normes constituerait un progrès essentiel, protégeant en premier lieu les Marocains et consolidant par la même occasion la confiance des marchés étrangers.
Omar ASSIF
Alertes internationales
Ce phénomène préoccupant, qui touche tous les écosystèmes marins du globe, impose aux autorités et aux producteurs de redoubler de vigilance pour protéger les populations vulnérables et préserver la crédibilité de toute la filière. Il convient toutefois de préciser que les campagnes menées en Europe par Bloom et Foodwatch n’ont pas spécifiquement testé de conserves marocaines : leurs analyses, publiées fin 2024, portaient sur près de 150 boîtes achetées en France, Espagne, Italie, Allemagne et Belgique et ont montré que 100% contenaient du mercure et que 10% dépassaient 1 mg/kg (seuil maximal fixé par l’UE pour le thon frais). L’absence de données marocaines récentes et accessibles sur les conserves commercialisées localement ou exportées crée donc un angle mort qui ne permet ni de confirmer ni d’infirmer l’existence d’un risque similaire au Maroc, d’où l’importance d’analyses indépendantes et d’une publication régulière des résultats par les autorités et les acteurs concernés, notamment industriels.
Cadre marocain
Le Royaume dispose cependant d’un dispositif réglementaire censé encadrer ce risque. L’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) fixe ainsi depuis plusieurs années des seuils proches des standards internationaux (1 mg/kg en teneur maximale de mercure autorisée pour les grands prédateurs marins comme le thon et 0,5 mg/kg pour les espèces non prédatrices) et réalise des contrôles sur les lots destinés au marché local et à l’export. Entre 2010 et 2016, le Centre antipoison et de pharmacovigilance a publié des données qui montrent des valeurs globalement inférieures à ces limites mais plus élevées chez les espèces prédatrices. Ces chiffres, aujourd’hui anciens, illustrent que le problème est suivi mais soulignent la nécessité d’actualiser et, surtout, de rendre publics les résultats des analyses pour que le consommateur, les opérateurs et les marchés étrangers disposent d’une image claire et actuelle de la situation.
Accès aux données
Les conserveries marocaines sont soumises à des agréments sanitaires et à des audits pour répondre aux exigences de l’Union Européenne, du Codex Alimentarius et d’autres marchés, ce qui implique des dispositifs d’autocontrôle, de traçabilité et de certification qualité. Ces mécanismes constituent un socle utile mais ne suffisent pas, à eux seuls, à garantir l’absence de risques : leur efficacité réelle dépend de contrôles publics réguliers, indépendants et transparents. En l’absence de données récentes et publiquement accessibles sur les niveaux de métaux lourds dans le thon en conserve marocain, l’alerte d’Abderrahmane Al Ouafa souligne que la priorité doit rester la santé du consommateur et la crédibilité scientifique des institutions chargées de la surveillance. Renforcer et publier les analyses, informer clairement le public et actualiser les normes constituerait un progrès essentiel, protégeant en premier lieu les Marocains et consolidant par la même occasion la confiance des marchés étrangers.
Omar ASSIF
3 questions à Mustapha Aksissou, biologiste marin : « L’existence d’un cadre réglementaire ne dispense pas d’analyses récurrentes et d’une diffusion transparente des résultats »
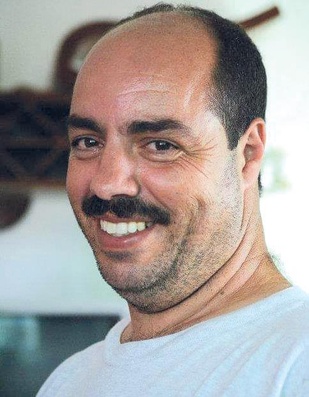
Professeur de biologie marine à l’Université Abdelmalek Essaâdi de Tétouan, Pr Mustapha Aksissou répond à nos questions sur la pollution des organismes marins par les métaux lourds.
- En 2018, vous avez publié une étude sur la présence de métaux lourds dans trois espèces de poissons du nord-est du Maroc. Quels en étaient les principaux enseignements ?
-Nous avons conduit, avec mon équipe, un travail sur trois espèces représentatives du régime alimentaire marin dans le nord-est du Maroc : bogue, sardine et chinchard. L’objectif était de quantifier neuf métaux lourds, dont le cadmium, le plomb et l’arsenic. Les résultats ont montré des concentrations généralement inférieures aux normes internationales, à l’exception de l’arsenic, au niveau du seuil fixé par l’USEPA, et des teneurs relativement élevées pour le nickel et le manganèse, pour lesquels il n’existe pas de valeurs limites réglementaires. Ces données, collectées en 2016 et publiées en 2018, constituent une photographie à un instant donné et soulignent la nécessité d’un suivi longitudinal et élargi.
- Comment situez-vous ces résultats par rapport aux données internationales les plus récentes sur le thon ?
-Un article paru début 2025 dans Food Control, fondé sur l’analyse de plus de 1.200 échantillons de thon et de merlu commercialisés en Europe, montre que des dépassements ponctuels des seuils de mercure peuvent survenir malgré un dispositif réglementaire très strict. Ce type d’étude illustre le caractère global et structurel de la bioaccumulation : les concentrations dépendent du cycle biologique des espèces, des zones de capture et des procédés de transformation. C’est un enseignement important pour le Maroc : l’existence d’un cadre réglementaire ne dispense pas d’analyses récurrentes et d’une diffusion transparente des résultats.
- Quelles priorités recommanderiez-vous pour renforcer la vigilance au Maroc ?
-Au plan scientifique, il est impératif de concevoir un programme national intégré qui articule l’effort de l’INRH, de l’ONSSA et des Universités. Il doit couvrir à la fois les espèces pélagiques majeures et les produits transformés, en appliquant des protocoles d’échantillonnage harmonisés et internationalement validés. Sur le plan institutionnel, il serait utile de systématiser la publication des résultats de manière vulgarisée et accessible, à l’image des bases de données de l’EFSA ou des rapports de la FDA. Enfin, sur le plan technique, des mesures comme la traçabilité fine des zones de pêche, l’âge des poissons capturés et l’optimisation des procédés de transformation contribuent à réduire l’exposition aux métaux lourds et à conforter la confiance des marchés étrangers.
Bioaccumulation : Pourquoi les grands poissons concentrent plus de métaux lourds
Dans l’océan, les métaux lourds comme le mercure proviennent à la fois de sources naturelles (volcans, érosion des sols) et d’émissions humaines (centrales thermiques, industrie, trafic maritime). Ces éléments se retrouvent sous forme de traces dissoutes ou fixées sur les particules et sont transformés en méthyl mercure par des micro-organismes marins. Ce composé, très toxique, s’accumule progressivement dans les tissus des animaux. À chaque maillon de la chaîne alimentaire, le prédateur absorbe non seulement ce qu’il ingère mais aussi les contaminants accumulés par ses proies : c’est la bioamplification. Plus un poisson vit longtemps, grossit et se situe haut dans la chaîne, plus sa concentration en méthyl mercure est élevée. C’est pourquoi les thonidés – comme l’albacore ou la bonite rayée – présentent en moyenne des teneurs supérieures à celles des petits poissons côtiers ou pélagiques. Cette dynamique est universelle : elle ne dépend ni du port d’attache ni de l’usine de transformation, mais du rôle écologique de l’espèce et de sa zone de migration.
International : Comment le monde contrôle les teneurs de mercure dans le thon
Aux États-Unis, au Japon ou dans l’Union Européenne, la sécurité des produits de la mer s’appuie sur des programmes réguliers de surveillance publique et sur la publication systématique des résultats. L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) alimente une base de données qui compile des milliers d’analyses de poissons frais et transformés dans tous les États membres. La Food and Drug Administration (FDA) publie des tableaux détaillant les teneurs moyennes en mercure par espèce et recommande des plafonds de consommation pour les femmes enceintes et les enfants. Au Japon, l’Agence de recherche halieutique suit chaque année le niveau de mercure dans les thons pêchés dans les eaux territoriales et diffuse des avis actualisés aux consommateurs. Ces dispositifs ont trois points communs : une méthode d’échantillonnage harmonisée, des seuils réglementaires clairs et un accès public aux résultats. Ils permettent d’anticiper les évolutions des normes internationales et d’ajuster les pratiques de pêche ou de transformation. Dans certains pays, les importateurs eux-mêmes financent des tests indépendants et publient les données pour rassurer leurs clients. Résultat : le consommateur peut consulter des informations précises sur le type de poisson, la zone de capture et la teneur moyenne en métaux lourds. Pour le Maroc, ces exemples offrent une feuille de route : capitaliser sur les compétences de l’ONSSA et de l’INRH, établir un programme national de suivi des métaux lourds dans les thonidés et publier les résultats sous forme accessible, vulgarisée et régulière.
Effet de concentration
Lorsqu’il est transformé en conserve, le thon est cuit puis stérilisé, ce qui lui fait perdre une partie de son eau. Comme le mercure est lié aux protéines musculaires et reste dans la chair, la concentration exprimée en mg/kg augmente mécaniquement. Les ONG Bloom et Foodwatch estiment que le thon en boîte peut ainsi afficher des taux apparents 2 à 3 fois supérieurs au thon frais. Ce n’est pas un ajout de mercure mais un effet de concentration lié à la cuisson et à l’égouttage, d’où l’importance de tenir compte du poids égoutté dans les comparaisons.
Thonidés en danger ?
Le mercure présent dans les océans se concentre dans les tissus des thons tout au long de leur vie, mais rien n’indique aujourd’hui qu’il menace directement la survie de leurs populations. Les principaux facteurs de déclin des thonidés restent la surpêche, la destruction d’habitats et le changement climatique. Le méthyl mercure est surtout un problème de santé publique humaine et d’image commerciale : il concerne davantage les consommateurs et les marchés que la vitalité biologique des stocks de thons eux-mêmes.














![Sécurité alimentaire : Le thon en conserve dans le collimateur ! [INTÉGRAL] Sécurité alimentaire : Le thon en conserve dans le collimateur ! [INTÉGRAL]](https://www.lopinion.ma/photo/art/grande/91139425-64124341.jpg?v=1758018012)
![Sécurité alimentaire : Le thon en conserve dans le collimateur ! [INTÉGRAL] Sécurité alimentaire : Le thon en conserve dans le collimateur ! [INTÉGRAL]](https://www.lopinion.ma/photo/art/default/91139425-64124341.jpg?v=1758018013)












